L’unité et la diversité dans le confessionnalisme
Doctrine de l’ÉglisePureté de l’ÉgliseCatéchismes et confessions de foiSamedi dernier, j’ai eu le privilège d’apporter un exposé lors de la conférence annuelle des Églises réformées baptistes du Québec. Notre thème portait sur des Églises confessionnelles pour préserver la vérité et l’unité. Le thème qui me fut attribué était l’unité et la diversité dans le confessionnalisme. Comment une Église, une union d’Églises, ou encore des chrétiens de différentes confessions peuvent-ils maintenir l’unité sans uniformité?
Pour répondre à cette question, j’ai brièvement exposé le texte de Philippiens 3.15-16 en considérant trois éléments:
- Des hommes faits
- Une même pensée
- Un autre avis
J’ai ensuite développé cinq principes pratiques pour conjuguer l’unité et la diversité pour les Églises et les chrétiens confessionnels, qui se résument en une phrase: (1) La maturité chrétienne vise l’unité doctrinale en Christ, qui (2) requiert une hiérarchie doctrinale et (3) une souscription en fonction des contextes, (4) dans un confessionnalisme qui valorise une orthodoxie diversifiée et qui (5) refuse l’esprit sectaire.
1. La maturité chrétienne vise l’unité doctrinale en Christ
Tout chrétien doit tendre vers la maturité. Celle-ci se développe grâce à l’approfondissement et à l’appropriation de la doctrine chrétienne (cf. Ép 4.11-15« 11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants.
12 Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
14 Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d’égarement.
15 Mais en disant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. »– Éphésiens 4.11-15). Être un chrétien confessionnel consiste à étudier et à garder les doctrines qui ont été consignées par l’Église dans ses confessions de foi.
La maturité d’un chrétien ne devrait pas l’amener à développer une théologie originale, mais à confesser la vérité de concert avec l’Église universelle. Bien sûr, il y a des points de divergence doctrinale importants à l’intérieur de l’Église universelle. Cependant, il y a également de nombreux points d’accord parmi les chrétiens du monde, et le meilleur moyen de préserver cette unité est l’adhésion à une confession de foi historique qui est en harmonie avec la foi universelle.
Sans le confessionnalisme, une Église évangélique risque d’être livrée à la tyrannie de "l’infaillibilité" pastorale. Carl Trueman explique en quoi cela consiste:
Imaginez une Église qui n’a “d’autre credo que la Bible”, où le pasteur est convaincu une semaine que le baptême doit être réservé aux croyants professants, et où, la semaine suivante, il change d’avis et pense que les bébés peuvent également être baptisés. Peut-on lui demander de rendre des comptes? Il semble qu’il n’y ait aucun moyen de le faire. Quelle que soit la vérité qu’il pense avoir sur un sujet donné à un moment donné, telle est la position de son Église. C’est certainement une recette pour le chaos, car elle place la congrégation complètement à la merci de l’opinion actuelle du pasteur, quelle qu’elle soit. Il dispose, en théorie, d’un pouvoir illimité, et la Bible semble signifier ce qu’il décide qu’elle signifie. [...]
Ce que le ministre croit et ce que la Bible enseigne sont fonctionnellement identiques. S’il pense qu’elle enseigne le pélagianisme un dimanche et le calvinisme le lendemain, qui peut le contredire et comment le faire? Une fois de plus, la congrégation est à la merci du pasteur.
Ainsi, l’un des avantages évidents d’une confession ouverte et publique est qu’elle rend transparent ce qui est caché en pratique par les évangéliques qui prétendent n’avoir d’autre credo que la Bible. Tout le monde a un credo! La seule différence est de savoir si l’on est prêt à être honnête et ouvert sur ce fait. En outre, ce n’est qu’une fois que vous avez reconnu ce fait et rendu votre credo public que vous pouvez mettre en place un système qui relie la confession de votre Église à l’Écriture et au gouvernement de l’Église d’une manière qui donne à votre Église, à ses responsables et à ses membres un moyen de s’assurer que la confession reste subordonnée à l’Écriture d’une manière transparente, ordonnée et publique. Paradoxalement, ce ne sont pas les confessionnalistes, mais les adeptes du “pas de credo, mais la Bible” qui exaltent leurs credos au-dessus de l’Écriture1.
2. Le confessionnalisme requiert une hiérarchie doctrinale
Une des clés pour maintenir l’unité et la diversité dans le confessionnalisme est de reconnaître que toutes les vérités confessées n’ont pas la même importance. Sans une hiérarchie doctrinale, il est impossible de maintenir l’unité dans la diversité, puisque chaque divergence est une occasion pour de se diviser. François Turretin (1623-1687) répond à la question suivante dans son Institution de théologie éléctique: Y a-t-il des sujets théologiques qui sont fondamentaux et d’autres non, et comment les distinguer?
Bien que toutes les vérités révélées dans l’Écriture doivent nécessairement être crues comme divines et infaillibles, elles ne sont pas toutes également nécessaires, et il convient ici de distinguer avec précision la portée et l’application de la foi de sa nécessité. Tout ce qui appartient à la portée de la foi n’appartient pas de ce fait à la nécessité de la foi. Toutes les vérités n’ont pas le même poids. Certaines ont un degré de nécessité plus grand, d’autres moins grand. […]
Philippiens 3.15 enseigne qu’il existe des doctrines au sujet desquelles les chrétiens peuvent diverger sans détruire la paix et l’amour. Si quelqu’un touche aux fondamentaux, il est soumis à cet anathème: “Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!” (Ga 1.8). Dans d’autres cas, la tolérance chrétienne est de mise: “Accueillez celui qui est faible dans la foi” (Rm 14.1) […]
Ainsi, certaines doctrines sont nécessaires simplement pour que la foi puisse exister, tandis que d’autres ne le sont que relativement (kata ti) et pour son bien-être; certaines sont nécessaires à la production de la foi, d’autres à sa perfection (Hé 6.1); certaines en soi et absolument à tous, qu’ils soient bébés (népiois) ou parfaits (teleiois), d’autres accidentellement seulement à ceux qui sont en pleine maturité (teleiois) et avancés (Hé 5.13, 14). Certaines doctrines sont relativement nécessaires pour l’instruction des autres. Cette nécessité est encore à prendre avec une certaine latitude, en fonction des dons, de l’instruction, de la vocation, du sexe et de l’âge, dans la mesure où les uns appartiennent au troupeau, tandis que les autres sont des pasteurs auxquels sont confiés les oracles de Dieu, dont le devoir est d’instruire (didaskein) et de convaincre les récalcitrants (Tt 1.9)2.
Une hiérarchie doctrinale implique que certaines doctrines doivent constamment être mises de l’avant, tandis que d’autres auront plus d’importance en fonction des époques et des contextes particuliers.
De plus, une méthode de tri théologique est nécessaire, car bien qu’une confession se présente dans un ordre doctrinal particulier, une confession n’indique pas le degré d’importance des doctrines qu’elle contient. Le directeur de l’Institut Biblique de Bruxelles, James Hely Hutchinson, propose de trier les convictions selon trois critères dans son ouvrage très utile Sacrés désaccords!3:
- Les doctrines constitutives de l’Évangile.
- Les doctrines directement liées à l’Évangile sans constituer l’Évangile.
- Les doctrines sans lien direct avec l’Évangile.
Classer les doctrines d’une confession de foi relève de la sagesse et de la maturité chrétienne. Tous n’auront pas le même avis, mais les chrétiens matures devraient être au moins d’accord sur le fait de classer les doctrines selon ces trois critères.
3. La souscription exigée dépend des contextes et du rôle à jouer
Dès qu’il est question d’unité et de diversité dans la vérité, la notion de souscription exigée entre en ligne de compte. Le contexte et le rôle à jouer sont déterminants pour répondre à cette question. Le degré de souscription dans le contexte d’une Église locale est beaucoup plus élevé que celui exigé dans un ministère para-ecclésial. Contentons-nous d’appliquer ce troisième principe dans le contexte de l’Église locale, où une souscription à deux vitesses est de mise. À nouveau, Carl Trueman explique le concept d’une souscription à deux vitesses:
L’une des choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière dans l’utilisation des credo et des confessions par l’Église est la fonction qu’ils ont pour les membres n’exerçant pas un office biblique. Les laïcs devraient-ils être tenus de souscrire aux normes doctrinales de l’Église au même titre qu’un ancien ou un diacre? [...]
Les presbytériens exigent le minimum pour pouvoir devenir membre à part entière d’une Église: une simple profession de foi publique et cohérente, dans le sens de Romains 10.9-10, est suffisante. [...]
Néanmoins, la Bible indique clairement que les qualifications requises pour exercer un office sont d’un ordre quelque peu différent. [...]
La façon la plus évidente de procéder est d’exiger des anciens qu’ils souscrivent à une confession de foi qui articule la complexité doctrinale nécessaire pour élaborer et défendre les principes centraux de la foi. Ce faisant, on rend ces hommes responsables de ce qu’ils croient et de ce qu’ils enseignent. Cependant, le fait de limiter cette exigence à la fonction d’ancien (et, dans de nombreux cas, au diaconat) permet d’établir un niveau différent pour les membres4.
Cela signifie-t-il que les membres d’une Église ne sont pas sous l’autorité de sa confession de foi? Aucunement! Voici comment nous exigeons une soumission sans une pleine souscription à notre confession de foi lorsqu’une personne prononce ses vœux de membriété dans l’Église où je suis pasteur. Une des questions qui est demandée publiquement aux nouveaux membres est la suivante:
Acceptes-tu de te soumettre à la Parole de Dieu telle qu’elle est confessée par cette assemblée dans la confession de foi de 1689, mise en pratique dans notre constitution et appliquée par le ministère des anciens et la discipline de cette Église?
Cette formule permet de respecter la conscience de tous et de préserver le caractère confessionnel de l’Église. Notre objectif n’est pas de faire une Église de réformés baptistes, mais de chrétiens. La préservation de la confession réformée baptiste se fait plutôt au niveau des officiers qui doivent souscrire pleinement à notre confession de foi pour pouvoir être ordonnés. Voici comment notre constitution définit une pleine souscription:
Une pleine souscription requiert l’adoption de toutes les doctrines de la confession de foi comme exprimant la saine doctrine biblique. Un officier ou un candidat pourrait avoir une divergence théologique mineure. Dans ce cas, il devra expliquer sa position devant le conseil des anciens. Ceux-ci détermineront si cette divergence est suffisamment vénielle pour ne pas compromettre l’unité doctrinale.
Lors des vœux d’ordination d’un ancien ou d’un diacre, le frère ordonné doit répondre par l’affirmative à la question suivante:
Endossez-vous pleinement la Confession de foi de cette Église, nommément la Deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689? Représente-t-elle, selon vous, le système de doctrine enseigné dans l’Écriture? Vous engagez-vous, advenant un désaccord avec l’une de ses affirmations, à le faire aussitôt savoir au Collège d’anciens?
Un ancien ou un diacre peut être ordonné tout en prenant une exception vis-à-vis d’une des doctrines de la confession de foi. Nous n’avons pas de liste des exceptions qui peuvent être autorisées. Nous fonctionnons au cas par cas en dépendant de la bonne foi et de la sagesse de nos officiers. C’est ici que la diversité devient significative dans le maintien de l’unité et requiert un quatrième principe.
4. Le confessionnalisme valorise une orthodoxie diversifiée
Un des dangers du confessionnalisme est le sectarisme et les divisions. Lorsqu’on confond l’unité avec l’uniformité, la diversité ne peut plus exister. Cependant, même au sein d’une famille confessionnelle, il existe des divergences de vues sur tel ou tel point de doctrine. Les meilleures confessions de foi ont été rédigées de manière à préserver une certaine diversité dans l’unité doctrinale. Voici comment John Fesko démontre ce fait à partir de la Confession de foi de Westminster:
Les théologiens de Westminster étaient certainement soucieux de protéger de nombreuses doctrines par des déclarations précises [...] En même temps, ces théologiens étaient tout aussi soucieux de rédiger des passages confessionnels marqués par une ambiguïté délibérée afin de faciliter une orthodoxie diversifiée5. (p. 83)
Fesko démontre ce point à partir de trois doctrines de la confession: le décret, l’alliance et l’assurance. Il utilise les procès-verbaux de l’Assemblée de Westminster pour démontrer les divergences entre les théologiens présents. Concernant le débat autour de la doctrine de l’alliance, Thomas Goodwin et Samuel Rutherford avaient un désaccord à propos de la récompense offerte dans l’alliance des œuvres.
Selon Goodwin, la récompense se limitait à une vie prolongée dans le jardin d’Éden et non à la vie éternelle. La promesse était de nature terrestre et non céleste, et s’apparentait à la vie bénie en Canaan comme dans Lévitique 18.5. De son côté, Rutherford affirmait que c’était plutôt la vie éternelle qui fut promise à Adam, et que celle-ci est implicite dans Lévitique 18.5 selon les paroles du Christ dans Luc 10.25-28 où il est question de la vie éternelle. La Confession de foi de Westminster n’a pas tranché entre ces deux options, mais a formulé la doctrine de manière à accommoder les deux points de vue:
La première alliance conclue avec l’homme a été une alliance des œuvres (Ga 3.12), dans laquelle la vie a été promise à Adam, et en lui à sa postérité (Rm 10.5; 5.12-20), sous la condition d’une obéissance parfaite et personnelle (Gn 2.17; Ga 3.10)6.
En ne précisant pas la nature de la vie comme récompense, les théologiens ont opté pour une ambiguïté délibérée qui avait pour but d’autoriser une orthodoxie diversifiée. Elle retient l’essentiel de la doctrine de l’alliance des œuvres, tout en permettant différentes moutures de cette doctrine. Voilà un exemple d’unité dans la diversité, ou encore d’orthodoxie diversifiée. Voici quelques remarques très pertinentes auxquelles Fesko arrive en conclusion:
Les confessions n’ont jamais eu pour but de confiner l’Église à une position théologique trop définie sur chaque question. Les meilleures confessions intègrent une certaine flexibilité doctrinale, afin de laisser la place à des opinions divergentes sur des sujets difficiles. En outre, le fait que les théologiens de Westminster aient été initialement réticents à joindre des textes-preuves à la confession ne révèle pas un manque d’exégèse; cela montre plutôt qu’ils n’étaient pas tous d’accord sur les meilleurs chemins scripturaires à suivre pour parvenir à diverses conclusions doctrinales. […] (p. 87)
Par conséquent, lorsqu’on interprète une confession, il faut tenir compte de trois catégories d’interprétation différentes. Les lecteurs doivent faire la distinction entre ce qui est confessionnel, contra-confessionnel et extra-confessionnel.
Dire que les Écritures enseignent l’alliance des œuvres, c’est faire une affirmation confessionnelle. L’affirmation est en harmonie avec la confession. Dire, d’autre part, que Dieu justifie les pécheurs par la foi et les bonnes œuvres, c’est faire une affirmation contra-confessionnelle. Cette affirmation est en contradiction avec l’enseignement clair de la confession. Ce sont les deux catégories les plus fréquemment utilisées par les membres du clergé. Mais la troisième est tout aussi nécessaire, à la fois historiquement et ecclésiologiquement.
Dire que Dieu n’a promis à Adam qu’une vie prolongée dans le jardin comme récompense, ou dire qu’il y a un seul décret divin plutôt que plusieurs, reviendrait à faire une affirmation extra-confessionnelle. Cela signifie que les omissions d’une confession peuvent parfois être tout aussi importantes que ses déclarations explicites. Les théologiens de Westminster ont délibérément créé un espace pour les opinions extra-confessionnelles et n’ont pas cherché à les museler. Le seul cas où une opinion extra-confessionnelle peut être censurée est celui où elle entre en conflit avec l’enseignement explicite de la confession.
Cela signifie que les confessions tracent à la fois des lignes et des cercles. Elles tracent des lignes que l’Église ne doit pas franchir pour distinguer l’orthodoxie de l’hérésie et pour préserver la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Mais elles tracent également des cercles, des espaces de liberté doctrinale où les adhérents peuvent adopter un certain nombre de positions différentes tout en restant dans les limites de l’orthodoxie. (p. 88s.)
Chercher l’unité à l’intérieur d’une orthodoxie diversifiée implique de la tolérance sur plusieurs questions sensibles et importantes. Par exemple: la fréquence idéale pour prendre le repas du Seigneur, l’utilisation de vin ou de jus de raisin, ceux qui peuvent l’administrer, l’âge approprié pour être baptisé, les anciens surveillants vs enseignants, l’ordination à vie ou à terme, le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, les instruments de musique, l’utilisation d’une chorale, la possibilité de réciter un credo dans le culte ou uniquement la Bible, la célébration des fêtes religieuses autres que le jour du Seigneur, le voile de la femme, etc. Sur ces questions, et bien d’autres encore, il faut rechercher une unité à l’intérieur d’une orthodoxie diversifiée.
5. Le confessionnalisme mûr refuse l’esprit sectaire
Le dernier principe que je veux élaborer dans cet article vient principalement de Philippiens 3.16:
Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas.
De mon point de vue, les évangéliques sont souvent trop sectaires ou trop oecuméniques. Il n’est pas facile de trouver l’équilibre dans le maintien de la paix et de l’unité par rapport aux autres confessions chrétiennes que la sienne. Mais il me semble que si on désire être fidèle à l’injonction de l’apôtre ci-dessus, nous devrons apprendre à maintenir une relation d’unité avec des frères, que nous considérons comme étant dans l’erreur sur certains points. Je mets l’accent sur le mot "frères" car on ne doit pas maintenir de communion avec ceux qui ne sont pas des frères, peu importe ce qu’ils prétendent...
Le fait de souscrire à une confession particulière ne devrait aucunement nous enorgueillir face aux chrétiens d’autres confessions. En fait, un chrétien confessionnel mature devrait être caractérisé non par le sectarisme, mais par la pensée et le caractère de Christ (cf. Ph 2.5« 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » – Philippiens 2.5, 3.15« 15 Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et, si vous êtes d’un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
16 Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction [et vivons en plein accord]. » – Philippiens 3.15).
Ainsi, j’ai appris à voir le christianisme comme un seul train avec plusieurs wagons. Il y a le wagon presbytérien où l’on chante des psaumes en buvant du Scotch et en fumant des cigares. Bien sûr, il y a aussi des wagons où il est interdit de fumer et où on ne boit que du thé. Il y a un wagon pentecôtiste où tout le monde parle bruyamment en même temps et le wagon luthérien qui voudrait bien se détacher des autres wagons. L’important cependant, c’est qu’il n’y a qu’une seule locomotive: Christ; et les mêmes rails qui portent tous les wagons: l’Évangile. Si quelqu’un a un autre Christ ou un autre Évangile, il n’est pas dans le même train et sa destination n’est pas la Nouvelle Jérusalem.
Maintenant, certains wagons ont plus de proximité entre eux. D’autres sont très éloignés. Il arrive que des passagers changent de wagon, mais ils sont toujours à bord du même train. Il est normal que nous soyons plus prêts et collaborions davantage avec ceux qui sont dans le même wagon que nous. Mais si nous refusons le sectarisme, nous refuserons de confondre notre wagon comme étant le train tout entier.
Ressources similaires
webinaire
Trouver l’Église pour moi… et y rester!
Découvre le replay de ce webinaire de James Hely Hutchinson, enregistré le 24 mai 2023. Lors de ce webinaire, James nous a aidé à réfléchir à la question de l’appartenance à une Église locale, compte tenu des différences de convictions qui existent entre nous en milieu chrétien.
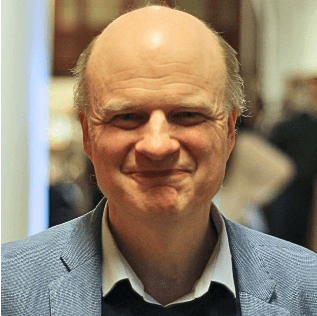
Orateurs
J. Hely Hutchinson









