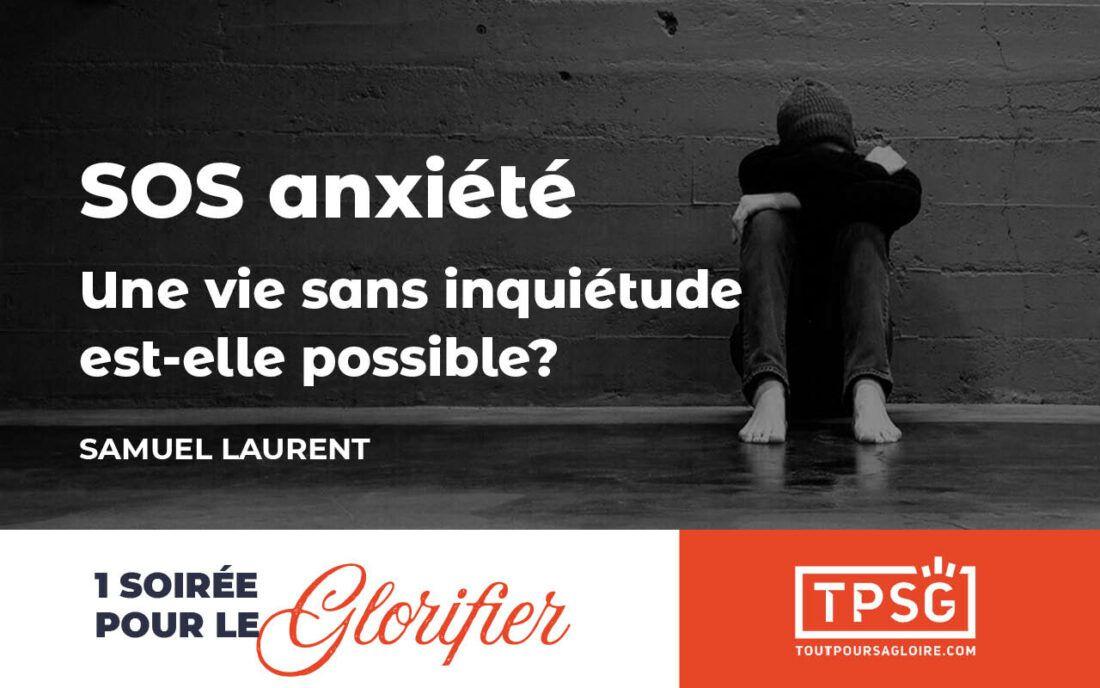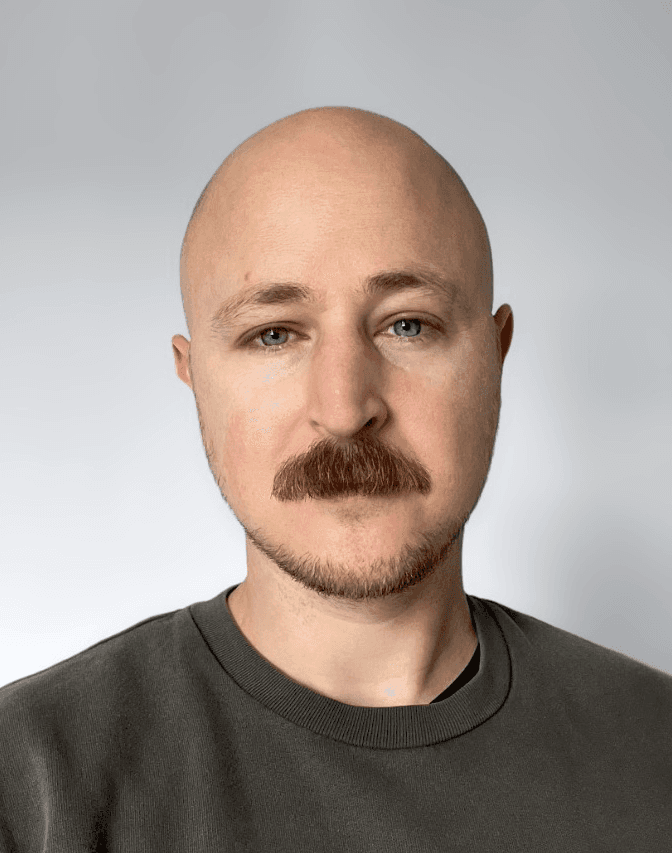Que penser des diagnostics psychiatriques?
Accompagnement bibliqueÉthiquePsychologieBipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, TOC, TDAH – ces étiquettes psychiatriques font de plus en plus partie de notre vocabulaire courant. Mais quelle devrait être l’attitude chrétienne face à ces diagnostics? Et qu’en est-il des médicaments qui sont souvent recommandés en fonction de ces étiquettes –, Ritalin, Prozac, Xanax, etc.? Devrions-nous les accepter ou nous en méfier?
Cet article est le premier d'une série de deux: avant d’aborder la question des traitements dans un second volet, nous allons d’abord nous pencher sur les diagnostics.
La première chose à reconnaître, c’est que le diagnostic est inévitable. Notre Dieu "n’est pas un Dieu de désordre" (1Co 14.33). Et, créés à son image, une partie de notre expérience humaine consiste à classer, organiser et mettre en ordre notre monde. C’est d’ailleurs ce que Dieu demande à Adam de faire, lors de la Création, en lui disant de nommer les animaux (cf. Gn 2.19-20). Et c’est ce que nous faisons tous chaque fois que nous rencontrons une nouvelle personne: nous la "classons" comme sympathique, bizarre, insensible, agréable, et ainsi de suite, selon un système de diagnostic qui nous est propre.
Depuis la Chute, bien sûr, les effets du péché se font sentir jusque dans nos diagnostics: souvent incomplets, voire complètement erronés dans certains cas, ils se révèlent parfois être des étiquettes qui enferment et peuvent ruiner une vie. Tout cela est vrai dans le domaine psychiatrique aussi. Pour ces raisons, les chrétiens devraient adopter une approche équilibrée qui n’accepte pas aveuglément et ne rejette pas catégoriquement les diagnostics psychiatriques. Nous voulons prendre au sérieux l’aide qu’ils peuvent apporter, tout en reconnaissant leurs limites.
La valeur des diagnostics dans le ministère
Les diagnostics psychiatriques sont utiles à plus d’un titre, en particulier pour toute personne engagée dans un ministère d’accompagnement dans l’Église – pasteur, conseiller, responsable jeunesse, etc. Ils permettent déjà d’identifier des schémas d’expérience, ce qui est précieux pour offrir une aide plus avisée. Par exemple, le fait de savoir que les personnes diagnostiquées avec un TOC suivent généralement un même schéma de pensée (obsessions, anxiété, compulsions, soulagement) peut nous guider pour aider de telles personnes à briser ce cercle vicieux.
Les diagnostics nous font aussi prendre conscience de luttes humaines dont nous ignorons parfois jusqu’à l’existence. Par exemple, il nous arrive à tous d’être inquiets, mais nous n’avons pas tous subi de crise de panique; il nous arrive à tous d’être découragés, mais nous n’avons pas tous vécu des mois de dépression. Être conscient des luttes plus spécifiques et intenses que d’autres vivent nous aide à avoir davantage compassion d’eux. Enfin, les diagnostics psychiatriques sont aussi précieux en ce qu’ils nous rappellent le rôle central du corps (et des phénomènes biochimiques) dans les luttes d’une personne, nous empêchant ainsi de "sur-spiritualiser" les problèmes liés aux émotions et aux pensées.
Des descriptions, non des explications
Néanmoins, les diagnostics psychiatriques comportent aussi certains pièges. Le premier d’entre eux est que le fait de poser une étiquette sur un trouble psychiatrique peut donner l’impression qu’on en connaît les causes, alors que bien souvent ce n’est pas le cas. Nous avons tendance à penser que, parce qu’une personne a été diagnostiquée bipolaire ou schizophrène, cela signifie que son trouble est principalement causé par un dysfonctionnement cérébral clair et spécifique. Or, comme l’explique le médecin Michael R. Emlet, “il y a très peu de preuves pour étayer cette hypothèse1”.
Il ajoute:
L’hypothèse d’une cause biologique ultime pour la plupart des problèmes psychiatriques est ancrée dans notre culture, même si elle n’est pas considérée comme une évidence dans la psychiatrie universitaire2.
Son conseil? Nous rappeler que “les diagnostics sont des descriptions, non des explications3” et, donc, les considérer comme moins définitifs que nous pourrions le penser.
Le surdiagnostic et la "médicalisation" du péché
Parmi les autres pièges des diagnostics psychiatriques, notons qu’ils ont le potentiel d’anormaliser la normalité par le surdiagnostic. Comme l’explique Michael R. Emlet:
La prolifération des catégories de diagnostics signifie qu’un plus grand nombre de personnes peuvent être prises dans un filet diagnostique particulier au fil du temps4.
Ce problème est intensifié par la publicité des groupes pharmaceutiques auprès des consommateurs, qui augmenterait l’autodiagnostic des patients et la pression exercée sur les médecins pour prescrire des médicaments inutilement.
Signalons encore le fait que les diagnostics tendent à "médicaliser" des comportements pécheurs. S’il est certes trop réducteur de considérer, par exemple, un trouble anxieux sévère comme un simple manque de confiance en Dieu, ou une dépression grave comme un simple manque de volonté, nous devons veiller à ce qu’un comportement pécheur ne soit pas excusé par un diagnostic particulier. Certains diagnostics transforment des questions fondamentalement morales en maladies mentales, et redéfinissent ainsi un comportement que l’Écriture qualifierait principalement de péché. C’est problématique, car si le problème médical d’une personne occulte son problème spirituel, la prise en charge de cette personne ne sera pas suffisamment globale.
Des leçons pour le ministère
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les diagnostics psychiatriques doivent être accueillis avec mesure par les chrétiens. Ils offrent une aide limitée, qui peut s’avérer utile dans certains cas. Mais ils ne doivent pas être pris comme "parole d’Évangile".
Dans son livre, Michael R. Emlet tire de cela plusieurs leçons pour le ministère:
-
La première, c’est que nous ne devrions pas nous laisser effrayer par un diagnostic. Lorsqu’une personne de notre entourage est diagnostiquée avec un trouble mental, cela génère souvent un sentiment de peur: peur de la différence, peur de ne pas être suffisamment équipé pour l’aider, etc. Le risque est alors de s’éloigner de cette personne au moment même où elle aurait le plus besoin d’être entourée!
Dans un excellent article, Edward T. Welch propose donc plusieurs façons, pour des personnes ordinaires, d’aider les personnes souffrant de problèmes psychiatriques: vous pouvez vous rapprocher de cette personne et prier avec elle, vous pouvez l’écouter avec compassion et apprendre à la connaître, vous pouvez être un ami fidèle qui lui rappelle les vérités glorieuses de l’Évangile, et ainsi de suite. Tout cela sans détenir aucune expertise médicale particulière5.
-
Une deuxième leçon importante est que nous ne devrions pas permettre au diagnostic de résumer l’identité de la personne qui lutte. Quelqu’un qui souffre de problèmes médicaux physiques ne se présente pas à une personne qu’elle rencontrerait pour la première fois en disant: “Je suis myope” ou “Je suis diabétique”. Pourquoi devrions-nous le faire avec des problèmes médicaux psychiques, et nous présenter en disant: “Je suis bipolaire” ou “Je suis TDAH”, comme si cela représentait l’ensemble de notre identité? L’accompagnant doit lui aussi veiller à ce que la présence d’un diagnostic ne restreigne pas sa vision au point d’être aveugle à d’autres aspects importants de l’identité de la personne. Comme l’explique le psychothérapeute Irvin Yalom:
Une fois que nous avons établi un diagnostic, nous avons tendance à ignorer de manière sélective les caractéristiques du patient qui ne correspondent pas à ce diagnostic particulier, ainsi qu’à accorder une attention excessive à celles, plus subtiles, qui semblent confirmer le diagnostic initiale6.
Rappelons-nous donc que les gens sont merveilleusement plus complexes qu’un diagnostic ne saurait le dire!
-
Enfin, nous devons laisser les catégories bibliques élargir notre compréhension des personnes. Une vision biblique de l’identité de l’individu ne se limite pas à ses aspects physiques et psychiques, mais prend en considération la totalité de la personne: ses espoirs, ses craintes, ses joies, ses tentations, ses péchés, etc. Alors que les diagnostics psychiatriques sont des descriptions et non des explications, qu’ils traitent des symptômes et non des causes, la Bible – elle – traite aussi des questions de causalité. Prenons le cas d’une personne souffrant de trouble anxieux. La Bible révèle que l’anxiété est alimentée par notre crainte des hommes, notre désir de réussir et d’être reconnu par autrui ainsi que la crainte d’échouer. Une fois ces craintes et ces désirs sous-jacents identifiés, nous avons dans l’Évangile de grâce la ressource ultime pour vaincre l’anxiété. En contemplant la gloire et la bonté du Christ de l’Évangile, nous apprenons à craindre Dieu davantage que les hommes et à nous reposer dans son amour inconditionnel pour nous. La Bible nous donne donc non seulement une meilleure compréhension des individus (incluant aussi les causes probables de leurs troubles), mais elle nous donne les ressources pour apporter une aide réelle.
Conclusion
En bref, notre but doit être d’apporter la rédemption de Dieu aux personnes qui luttent contre des problèmes inclus dans une description diagnostique, sans pour autant les enfermer sous cette étiquette. Cela, même des chrétiens "ordinaires" peuvent participer à le faire, s’ils agissent dans le respect de la Bible, avec soin, persévérance et amour.
Dans le prochain article, nous verrons ce que les chrétiens doivent penser des médicaments et traitements psychiatriques.
Dans la même série
Ressources similaires
webinaire
SOS anxiété: Une vie sans inquiétude est-elle possible?
Découvre le replay du webinaire de Samuel Laurent, enregistré le 29 novembre 2022.
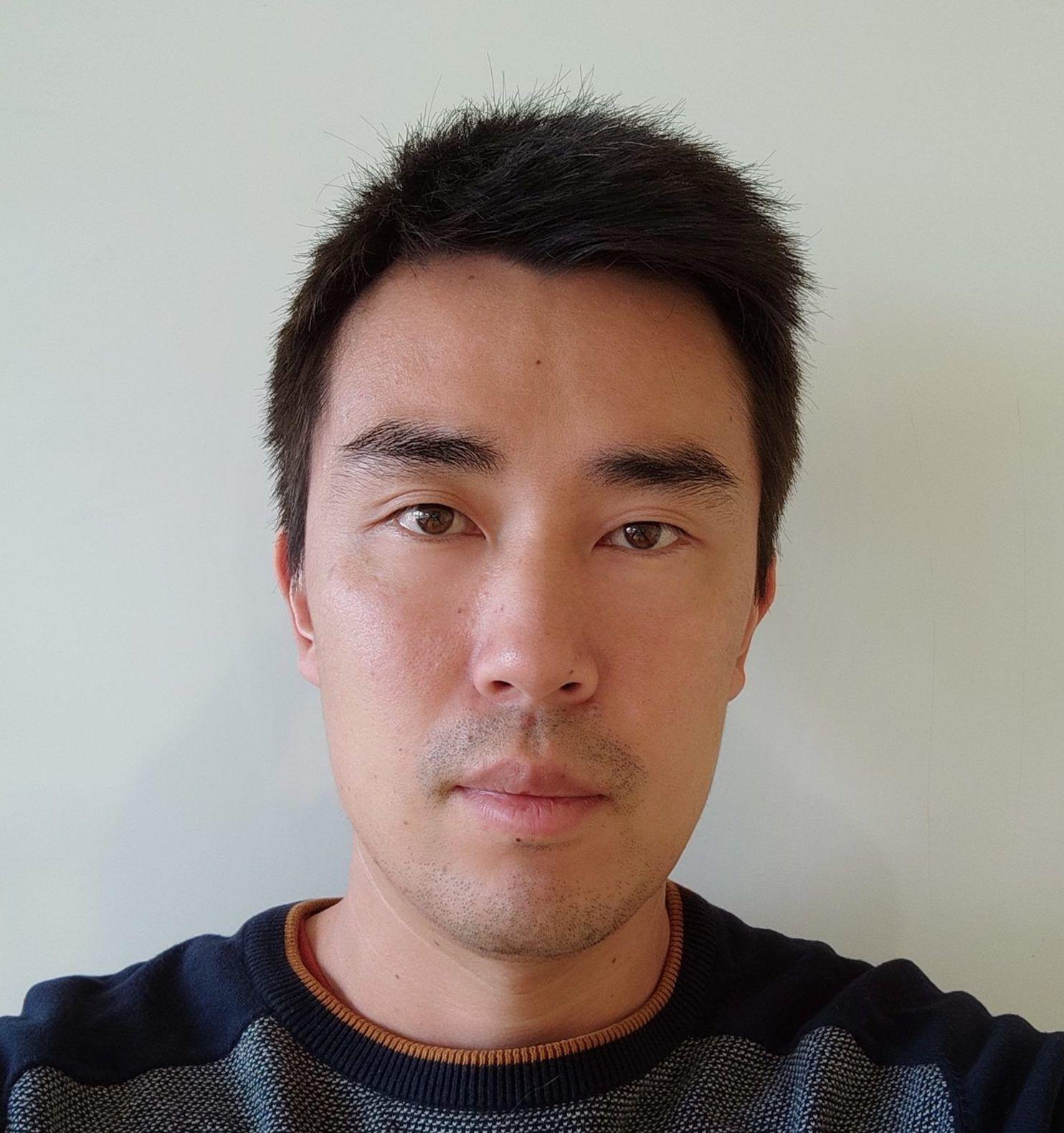
Orateurs
S. Laurent