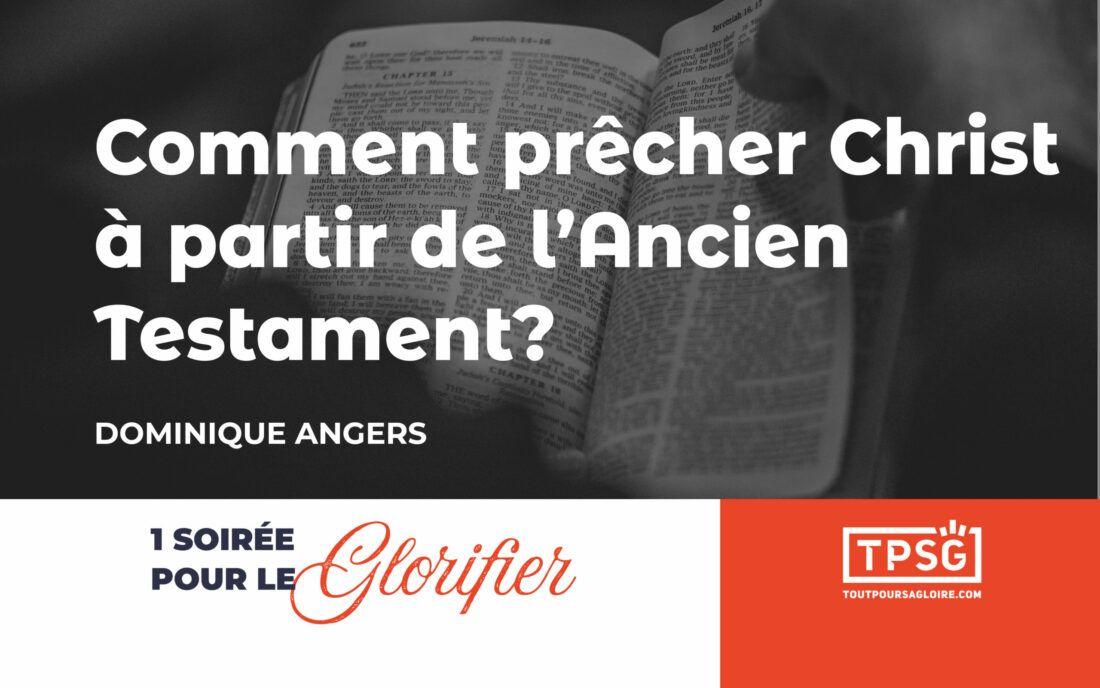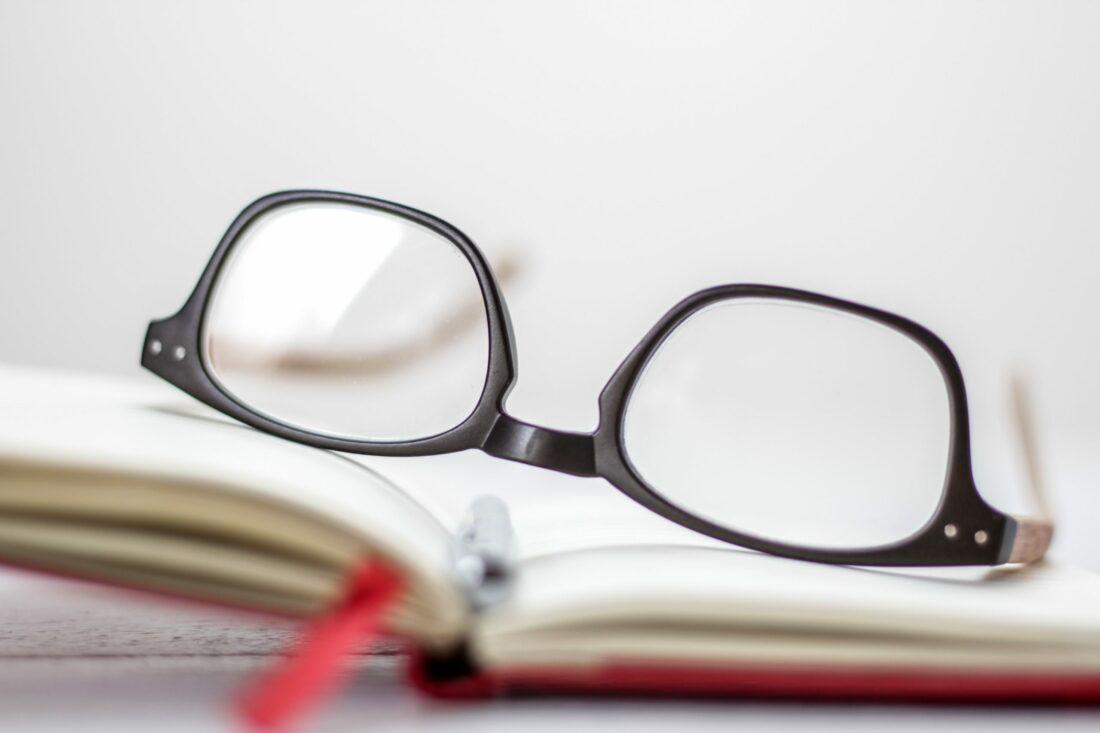Comprendre la structure: un pas essentiel dans l’interprétation de la Bible
HerméneutiqueLecture de la BiblePrédication et enseignementEn mars de cette année, j’ai eu le plaisir de prendre la parole lors de la formation annuelle de SOLA: Femmes Scriptura, consacrée à l’enseignement de la Bible. Alors que nous explorions ces principes dans le livre d’Habakuk, j’ai enseigné aux 125 femmes présentes comment identifier la structure d’un passage dans ce petit livre prophétique – car tout texte a une structure. Cette structure révèle une idée centrale, qui doit façonner notre message.
La structure: la carte pour découvrir le sens d’un texte
Je suis assez âgée pour me souvenir de l’époque où il fallait utiliser une carte en papier ou un atlas des rues pour se repérer. Dans les années 90, nous sommes passés à MapQuest, qui nous permettait de rechercher notre destination en ligne et d’imprimer les itinéraires. Puis, les plus chics d’entre nous ont investi dans un GPS, qui donnait des indications en temps réel au fur et à mesure que l’on conduisait. Nous nous sentions comme des pilotes de combat, luttant contre le trafic avec notre appareil exclusif et inédit! Enfin, avec l’avènement du smartphone, la démocratisation de la cartographie est née. Aujourd’hui, toute personne disposant d’une application de navigation peut trouver son chemin d’un point A à un point B sans se perdre.
Lorsqu’il s’agit de la Parole de Dieu, nous disposons également d’un outil qui nous aide à déterminer où l’auteur d’un texte donné nous conduit. Tout comme une carte routière indique les routes, les virages et les points de repère nécessaires pour atteindre une destination, la structure d’un passage révèle les thèmes clés, les transitions et le flux logique qui nous guident vers le message voulu par les auteurs humains et divins. Autrement dit, si l’on ne comprend pas la structure d’un passage, l’interpréter et l’enseigner revient à conduire sans carte: on risque de se perdre ou de passer à côté de l’essentiel.
Le parcours de la préparation
Dans un article précédent, j’ai évoqué l’importance de suivre le parcours de la préparation pour parvenir à la signification d’un texte pour nous aujourd’hui. La première étape de ce parcours consiste à identifier la structure d’un passage.
Le point central du passage
Lorsque nous étudions la structure d’un passage, nous devons identifier l’idée principale qu’il cherche à transmettre. Car nous voulons laisser la Bible parler d’elle-même, plutôt que d’imposer notre propre sens au texte.
La première étape pour identifier la structure d’un passage consiste à déterminer son type de texte et son genre littéraire.
Les genres bibliques sont les suivants
- la loi: le Pentateuque
- livres historiques: Josué – Néhémie
- livres de sagesse: Job – Cantique des cantiques
- livres prophétiques: Ésaïe – Malachie
- évangiles et Actes: Matthieu – Actes
- épîtres: Romains – 3 Jean
- apocalyptique: Apocalypse
Souvent, ces différents genres contiennent plus d’un type de texte.
Les types de texte
Les trois types de textes que l’on trouve dans l’Écriture sont les suivants:
- récit: histoires avec des personnages, des lieux, des intrigues et d’autres caractéristiques littéraires.
- discours: arguments linéaires et logiques présentés par un seul auteur.
- poésie: langage soigneusement élaboré, chargé de sentiments, qui explore le lien entre l’humanité et Dieu.
Stratégies universelles
Nous pouvons appliquer certaines stratégies universelles à n’importe quel type de texte. Il s’agit notamment des stratégies suivantes:
- la répétition de mots, de phrases et d’idées
- les comparaisons
- les mots-clés
- les changements de locuteur et d’interlocuteur
- première personne du singulier ("je")
- première personne du pluriel ("nous")
- deuxième personne du singulier ("tu")
- deuxième personne du pluriel ("vous")
- Termes de transition: "donc, ainsi, c’est pourquoi, mais"
- Inclusions: les serre-livres qui entourent une section en répétant un thème majeur.
Examinons maintenant d’autres caractéristiques communes à la poésie hébraïque.
Stratégies communes à la poésie
1. Le parallélisme
Le parallélisme consiste à répéter ou à opposer des idées dans des lignes successives. La façon dont les lignes sont reliées les unes aux autres (par paires ou par triplets) permet souvent de marquer la division des strophes.
Le parallélisme synonymique: répétition d’une idée
Regardez parmi les nations, et voyez! Soyez saisis d’étonnement et d’épouvante!
Habakuk 1.5
Parallélisme antithétique: opposition d’une idée
Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui; mais le juste vivra par sa foi.
Habakuk 2.4
Le parallélisme synthétique: développement d’une idée
L’Éternel, le Seigneur, est ma force; il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs.
Habakuk 3.19
2. La répétition
Il s’agit de la répétition délibérée de mots, de phrases, de sons ou d’idées, utilisée pour souligner des concepts clés. Les répétitions marquent souvent les limites d’une strophe (et montrent ce que l’auteur cherche à mettre en avant).
- Habakuk 1.7-9 utilise à plusieurs reprises l’image de différents animaux féroces pour souligner la force des armées chaldéennes qui envahissent le pays.
3. Imagerie et métaphore
Il s’agit de l’utilisation d’un langage imagé ou figuratif pour représenter des objets, des actions ou des idées, en faisant appel aux sens du lecteur et en créant des images mentales. Les changements dans l’imagerie ou la métaphore peuvent indiquer une nouvelle strophe.
- Dans Habakuk 3.17-18, l’imagerie agricole répétée crée une tension, ce qui conduit à un changement au verset 18 où Habakuk exprime sa foi malgré les difficultés. Cela marque une rupture de strophe claire.
Le chiasme et l’acrostiche sont deux autres méthodes plus ardues à utiliser, mais qui peuvent s’avérer utiles.
4. Chiasme
Le chiasme est la disposition des idées en miroir (souvent ABB’A’ ou ABCB’A’). Cet outil est important parce qu’il relie des idées – des lignes jumelées (A avec A’, B avec B’). Elles permettent d’expliquer, de développer ou de contraster le sens. Les chiasmes révèlent également l’orientation de notre unité littéraire, car le centre d’un chiasme met généralement en évidence l’idée clé. Dans ce cas, nous devons nous demander comment le centre façonne l’ensemble du passage.
5. Acrostiche
On parle d’acrostiche lorsque la première lettre, syllabe ou mot de chaque ligne, strophe ou paragraphe épelle un mot, un message ou l’alphabet. L’exemple le plus connu d’acrostiche est le psaume 119.
Conclusion
Une fois que nous avons identifié la structure d’un passage, notre travail ne fait que commencer. Dans le prochain article de cette série, nous discuterons de l’importance d’identifier nos grilles d’interprétation pour arriver à juste titre au point principal d’un passage.
Dans la même série
Ressources similaires
webinaire
Comment prêcher Christ à partir de l’Ancien Testament?
Ce replay du webinaire Dominique Angers a été enregistré le 20 novembre 2019.

Orateurs
D. Angers