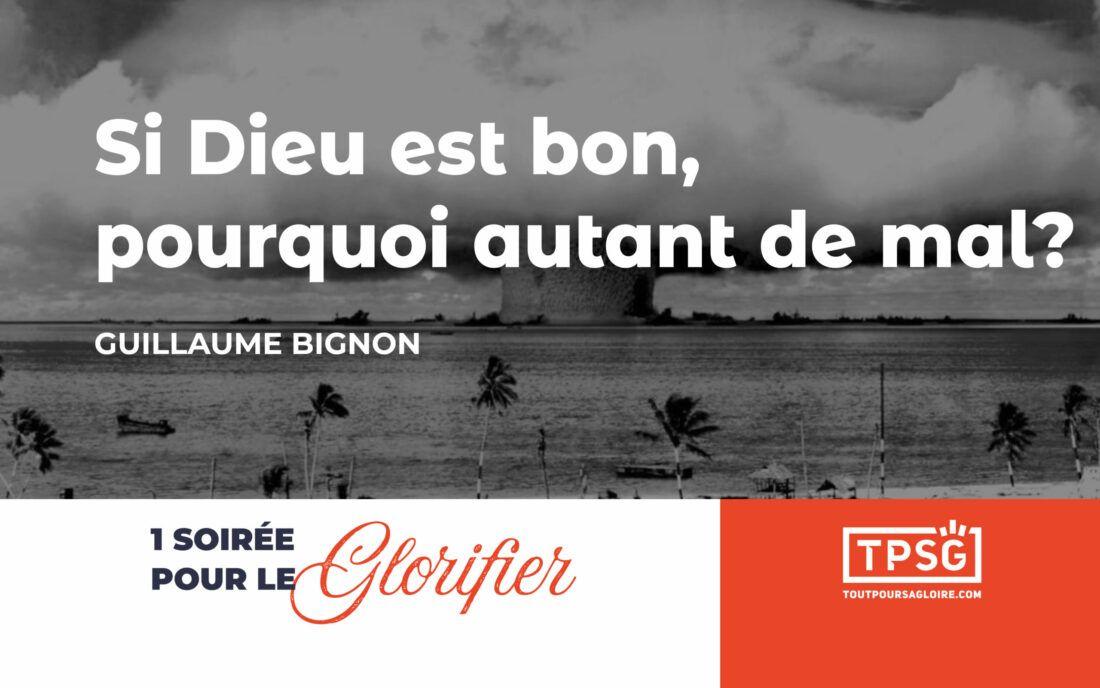La colère et la révolte provoquée par la souffrance
ColèreSouffranceLes médecins qui travaillent auprès de personnes endeuillées ont remarqué que l’être humain traverse en général cinq phases dans son processus de deuil: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation.¹
La colère. Chez beaucoup d’entre nous, la souffrance provoque à la fois de la colère et un sentiment de révolte.
D’où vient notre colère?
Il est naturel de se mettre en colère quand une tragédie éclate dans nos vies ou dans celle de ceux que nous aimons. Il est naturel de se mettre en colère quand nous expérimentons le deuil ou la déception. C’est une réaction profondément humaine. D’un côté, c’est une réaction juste et appropriée.
Ne devrions-nous pas nous mettre en colère lorsque des hommes, des femmes et des enfants précieux meurent brûlés vifs dans un immeuble de Londres?
Si tous les êtres humains sont porteurs de l’image de Dieu, alors se mettre en colère face à la souffrance est plus qu’une réaction normale, c’est une réaction légitime.
Il arrive que des croyants bien intentionnés cherchent à éviter de se mettre en colère par crainte de cette émotion, comme si elle devait forcément les éloigner de Dieu. Mais la Bible donne la parole aux personnes qui souffrent. Elle leur offre la liberté d’exprimer leur frustration, leur chagrin, leur colère et leur déception, et parfois même de protester violemment contre Dieu.
Dieu désire être en relation avec nous. Il veut nous côtoyer tels que nous sommes vraiment. Les Écritures semblent nous dire que Dieu ne nous reproche pas nos doutes à son égard, ni même notre colère contre lui. La Bible nous dit que nous pouvons lui exprimer notre souffrance.
Quand nous souffrons ou que nous sommes en colère, il vaut mieux être honnêtes avec Dieu plutôt que de prendre de la distance en brandissant le poing ou de penser qu’il faut être calmes ou ouverts pour pouvoir s’adresser à lui. Puisque Dieu accorde une immense valeur à la vie humaine, alors il est logique de penser que la colère est une façon légitime, et même saine, de gérer notre souffrance.
Notre indignation face à l’injustice, la mort, la maladie et la violence n’a de sens que parce qu’au fond de nous, nous avons l’intuition que les choses ne sont pas telles qu’elles devraient être.
Mais cette intuition est-elle vraiment rationnelle? Concorde-t-elle avec notre vision du monde et de Dieu? Si notre vie ne trouve pas son origine chez un être transcendant et si nous ne sommes qu’une masse d’atomes qui a appris à penser, d’où vient l’indignation de l’être humain face au mal et à la souffrance?
Après la publication du livre de Charles Darwin, L’Origine des espèces, un économiste britannique, Herbert Spencer, popularise l’expression “survie du plus apte” pour résumer le concept de sélection naturelle élaboré par Darwin. Spencer applique la théorie de Darwin à ses propres principes économiques.
L'idée principale de ce concept, c’est que les formes de vie les mieux adaptées à leur environnement survivent aux autres et que, sur le long terme, l’espèce se débarrasse de ses caractéristiques les moins utiles.
Associée à une vision matérialiste de l’univers (“Dieu n’a pas créé le monde et tout n’est que matière”), cette théorie fait de l’être humain le produit du hasard en lutte perpétuelle pour sa survie et son progrès personnel. Cela nous mène immanquablement à la conclusion que chaque être humain place toujours ses propres intérêts avant ceux des autres.
Après tout, le monde ne tourne-t-il pas autour de moi et de moi seul?
Ayn Rand est philosophe et écrivaine athée, membre de l’élite américaine. Elle est décédée en 1983. Mais ses livres continuent de se vendre par centaines de milliers chaque année. Elle croyait qu’un athée devait forcément être égoïste:
L’honnête homme vit pour lui-même. Tout homme digne d’être appelé un homme vit pour lui-même. Celui qui ne vit pas pour lui-même… ne vit tout simplement pas².
Le grand philosophe allemand Friedrich Nietzsche, athée lui aussi, avait déjà une pensée similaire:
Je pose en fait que l’égoïsme appartient à l’essence des âmes nobles […] d’autres êtres doivent être soumis, d’autres êtres doivent se sacrifier³.
L'athéisme nous dit donc que je privilégierai toujours mes propres intérêts et que si d’autres personnes se dressent sur ma route, je devrai sans doute les sacrifier sur l’autel de mes priorités.
Cette façon de voir les choses pourrait justifier l’indignation que je ressens lorsque je souffre ou lorsqu’un membre de ma famille souffre. Mais elle n’explique pas la colère plus générale qui nous envahit quand des personnes avec qui nous n’avons aucun lien de parenté ou qui ne sont aucunement nécessaires à notre survie traversent des moments douloureux.
Un choix radical
Le christianisme est né dans une société régie par l’égocentrisme. En se développant, il a peu à peu remis en question cette vision de la vie.
Jésus est né dans un pays occupé par les Romains. Les autorités étaient impitoyables et régnaient avec une poigne de fer. Mais le christianisme a fini par conquérir l’Empire romain avec une arme plus puissante: la bonté.
Les premiers chrétiens avaient rencontré un Dieu qui les aimait et avait fait preuve de miséricorde envers eux. En acceptant de suivre Jésus, ceux qui avaient été pardonnés par lui s’engageaient donc à pardonner aussi aux autres. Les chrétiens n’essayaient pas d’ignorer la cruauté, celle qui les touchait personnellement comme celle qui touchait des inconnus.
Au contraire, ils la déjouaient en prenant soin des faibles et des marginaux, des veuves et des orphelins. Ils tendaient la main à ceux qui souffraient. Et il considéraient que tous les êtres humains étaient égaux. Ce mode de vie était absolument unique et allait à contre-courant de la société romaine.
Nous sommes tellement habitués à l’action des Églises et aux représentations populaires du christianisme que nous ignorons sans doute comment tout a commencé et combien ces actions étaient radicales dans le contexte de l’époque.
Lors d’un débat organisé par le magazine The New Statesman, Rowan Williams, ancien archevêque de Cantorbéry, a pu discuter avec John Gray, un philosophe britannique athée très en vogue. Gray a reconnu que les valeurs de compassion ou de refus de la cruauté présentes en Occident aujourd’hui provenaient de la foi chrétienne. Il dit:
Le christianisme nous a fait don de cette valeur spécifique […] Si vous regardez l’Empire romain dans l’Antiquité, vous verrez que c’est le christianisme qui a introduit l’idée que les êtres humains, qui reflètent le dieu des chrétiens, avaient la responsabilité de ne pas se comporter avec cruauté envers les autres, ni même de tolérer la cruauté⁴.
Dans le monde antique, s’opposer à la cruauté était une caractéristique des chrétiens.
Bien sûr, les athées comme les agnostiques ressentent la même colère et la même indignation que les chrétiens face à la souffrance. Mais voici ma question: comment expliquer cette colère?
Si, comme le croient les chrétiens, les êtres humains sont faits à l’image de Dieu, alors l’indignation et la colère nous animent tous, qu’importe ce en quoi nous croyons. Si la vie humaine est d’une manière ou d’une autre sacrée, cette vérité se manifestera à nous de plusieurs manières.
J’ai moi-même constaté cette vérité au pied des ruines fumantes de la tour Grenfell. J’ai pu observer cela dans le regard et les actes de gens que je ne connaissais pas et qui ne se seraient pas qualifiés de religieux. Dans la fumée, les décombres et l’angoisse, nous savions que les vies perdues dans cet incendie étaient indéniablement précieuses. Et cette perte, en plus de nous bouleverser et de nous mettre en colère, nous remplissait de compassion.
Je crois que ce qui explique le mieux cela, c’est la foi chrétienne et cette idée fondamentale selon laquelle la vie humaine est précieuse parce que les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu.
Où est Dieu dans nos souffrances?
Il est ce pour quoi notre amour et notre vie sont sacrés. Et lorsqu’une vie est détruite ou quand une personne que nous aimons est brisée, c’est vers lui que nous dirigeons spontanément notre colère.
Dans les sociétés libérales occidentales, la religion est fréquemment considérée comme terne et ennuyeuse. Notre culture véhicule bien souvent l’idée qu’un homme ou une femme de foi ne doit jamais se mettre en colère et que l’Église est réservée aux philosophes ratés ou aux insensibles.
Mais en lisant la Bible, nous découvrons que son enseignement n’a rien à voir avec cette religion traditionnelle et stéréotypée qui rabâche l’importance des bonnes actions.
Des livres entiers de la Bible sont consacrés à réclamer la justice sociale pour les opprimés. Des chants, des poèmes et des récits sont dédiés à l’expression non seulement de la douleur et du chagrin humain, mais aussi à la colère et à l’indignation divine face à l’injustice et à la souffrance.
La foi chrétienne ne met pas en sourdine notre rage devant la violence et l’injustice de ce monde. Au contraire, elle l’explique. Cette colère a toute sa place dans la foi du chrétien. L’appel de notre cœur à la justice et au jugement fait écho aux fondements mêmes du récit biblique.
Peut-être les croyants sont-ils à vos yeux de dociles faiseurs de bonnes actions un peu déconnectés de la réalité. Si c’est le cas, vous serez sans doute surpris d’apprendre que la Bible laisse une grande place à l’expression de la douleur, de la confusion et des grandes questions que ces émotions suscitent. Dans le livre des Psaumes, l’un des auteurs écrit:
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? Pourquoi t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je ne trouve pas de repos.
Psaume 22.2-3
Jésus lui-même a cité ces versets lorsqu’il a été crucifié. Dans un autre psaume, le poète formule ses questions avec honnêteté et sans mâcher ses mots. Il demande à Dieu pourquoi il a permis la souffrance qu’il est en train de subir:
Je dis à Dieu, mon rocher: “Pourquoi m’as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l’oppression de l’ennemi?” Mes os se brisent quand mes persécuteurs m’insultent et me disent sans cesse: “Où est ton Dieu?”
Psaume 42.10-11
Le livre de Job nous raconte l’histoire d’un homme qui, à la fin de sa vie, sera reconnu par tous pour sa droiture. Pourtant, il devra d’abord traverser de terribles souffrances. Voici ce que dit Job lors de cette terrible épreuve:
Prends-tu plaisir [Dieu] à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants?
Job 10.3
Le prophète Habaquq, lui, demande combien de temps il va encore devoir crier à Dieu au sujet de la violence, de la souffrance et de l’injustice. Alors que Dieu, lui, ne semble pas s’en préoccuper.
Jusqu’à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n’écoutes pas. J’ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas!
Habakuk 1.2
L’indignation que nous ressentons face à la souffrance — celle que nous vivons ou dont nous sommes témoins — prouve qu’au fond de nous, nous savons que les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être. Lorsque nous voyons toutes les horreurs qui nous entourent, nous avons l’intuition que la souffrance ruine un monde créé pour être bon.
Mais pourquoi ressentirions-nous de l’indignation si ce monde matériel n’est que physique, biologique et chimique? Pourquoi serions-nous écœurés ou furieux à l’idée que des enfants sont exploités à l’autre bout de la planète si nous ne sommes que le résultat d’un processus hasardeux suivi d’une lutte acharnée pour la survie du plus apte? Pourquoi notre souffrance ou celle des autres aurait-elle de l’importance?
Pourtant, cette colère-là a toute sa place dans la foi chrétienne — une place qui exprime et explique ce que nous ressentons au plus profond de nous. Notre appel à la justice, et même au jugement, reflète l’histoire biblique. Si nous sommes faits pour aimer — si la vie a une origine transcendante, si la parfaite image de Dieu caractérise chaque individu et si nous avons tout gâché en faisant les mauvais choix — il n’est pas étonnant que le mal nous mette en colère et nous indigne.
Les choses ne devraient pas être ainsi. Face au mal et à la souffrance, nous nous demandons souvent: “Combien de temps devrai-je encore supporter ça?”
Mais si notre monde n’a ni sens ni conscience et si nous ne sommes qu’une masse d’atomes organisés, alors tout ce bruit et toute cette fureur, toutes nos questions, ne veulent plus rien dire.
Comme nous l’avons vu, la Bible nous présente des hommes et des femmes déçues et en souffrance qui se posent ces mêmes questions. Nous ne sommes pas les seuls à exprimer notre colère et notre frustration à Dieu: “Combien de temps permettras-tu encore cela?”, “Pourquoi es-tu si loin?”, “Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne m’aides-tu pas?”
Le Dieu de la Bible ne reste pas silencieux. Les Écritures nous donnent une réponse qui fait sens avec ce que nous vivons. Elle légitime notre indignation et nous promet que nous n’aurons pas à nous débattre seuls avec notre souffrance.