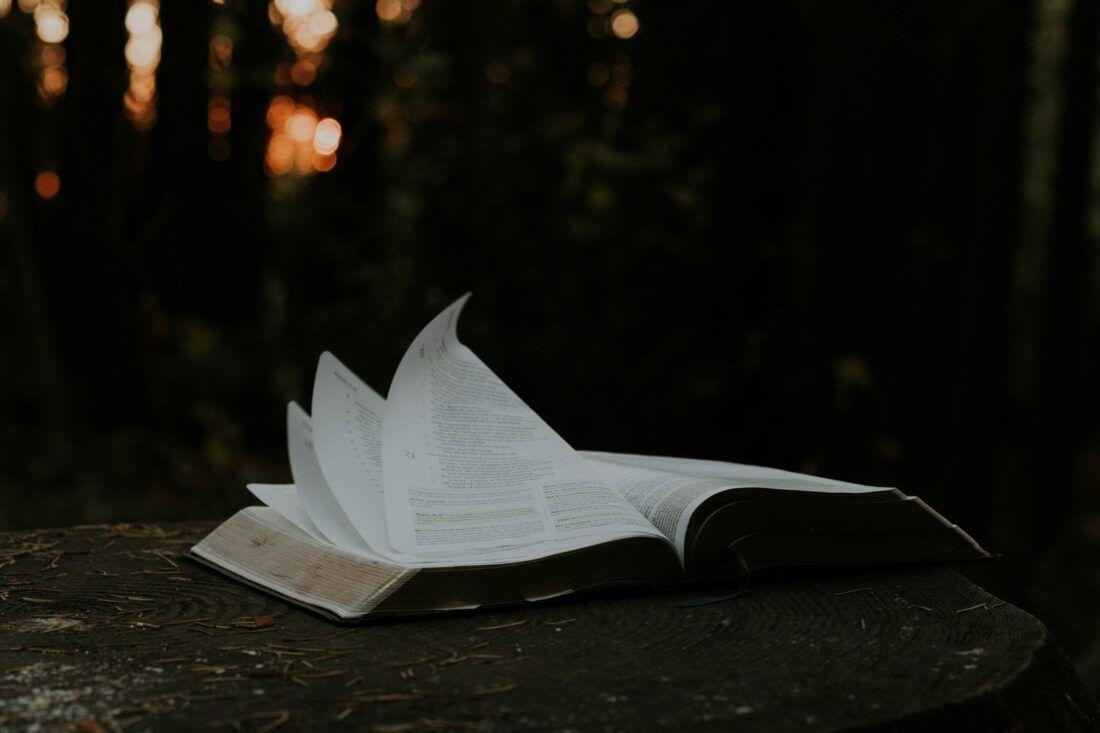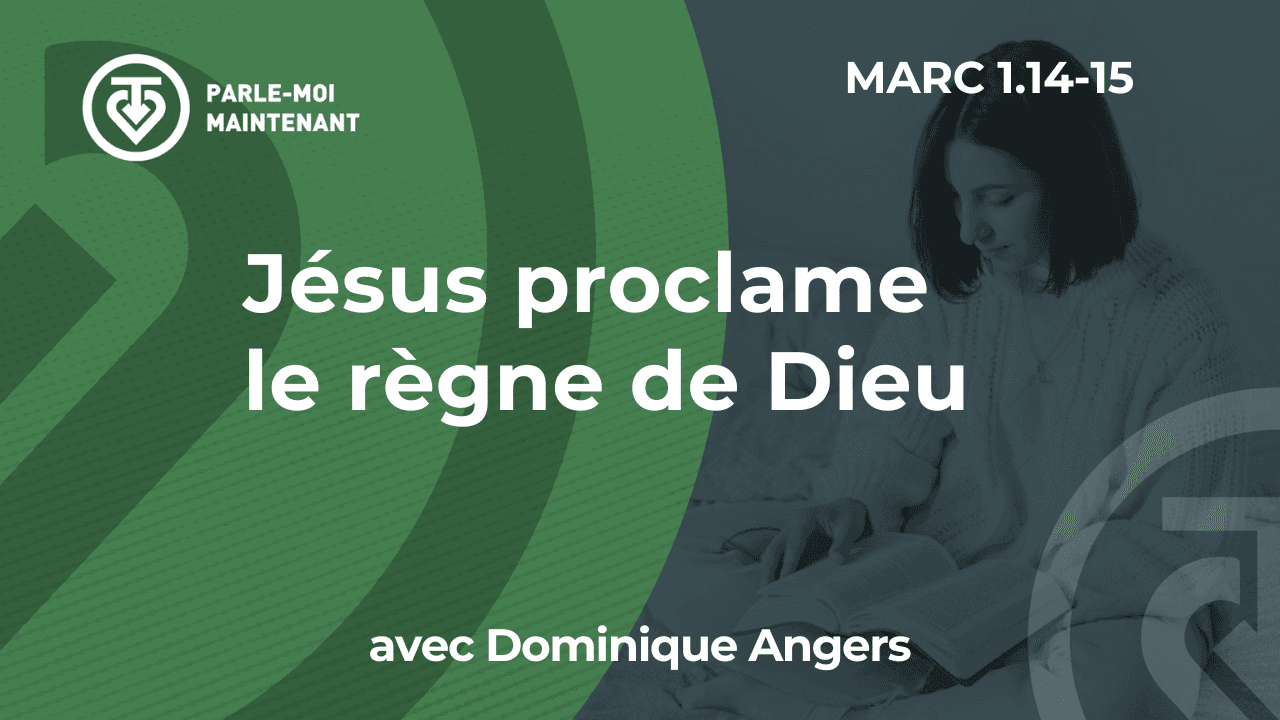Psaume 1 - L’arbre planté et la paille dissipée
HerméneutiquePsaumesLe premier psaume distingue l’humanité en deux catégories – le croyant et l’incroyant – que le texte désigne par les adjectifs "le juste" et "le méchant". Afin de respecter le lexique du texte, notre exposé utilisera les catégories morales de juste et de méchant pour désigner implicitement celles de croyant et d'incroyant. Généralement, dans le quotidien apparent des gens, cette distinction s’estompe. Vus de l’extérieur, le juste et le méchant se ressemblent souvent. Si Dieu l’autorisait, seule une intrusion réciproque dans l’intériorité de chacun leur permettrait d’être absolument sûrs de la catégorie à laquelle l’autre appartient.
1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2 mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: tout ce qu’il fait lui réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes; 6 car l’Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Psaumes 1
Le texte révèle de manière imagée combien le croyant diffère intérieurement de l’incroyant. D’une part, la relation intime que Dieu offre au premier s’illustre par l’enracinement d’un arbre planté près d’un courant d’eau, sécurisé quant aux ressources fondamentales à son foisonnement. D’autre part, l’égarement qui caractérise le second est illustré par la paille que le vent dissipe, coupée des éléments nécessaires à la vie.
L’image de l’arbre et celle de la paille renvoient en dernière instance aux deux destinations éternelles vers lesquelles chaque être humain est engagé. Le thème de ces destinations fait également l’objet d’une exhortation de la part de Christ, dans son Sermon sur la montagne:
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Matthieu 7.14
Nous développerons notre étude du premier psaume selon la distinction qu’il contient déjà: celle qui différencie la voie du juste de la voie du méchant.
La voie du juste
La voie du juste est présentée dans les trois versets initiaux qui présentent respectivement: l’abstinence du juste (v. 1), sa consécration (v. 2) et les fruits qui découlent de celles-ci (v. 3).
Le texte ne précise pas comment quelqu’un devient juste devant Dieu. C’est l’apôtre Paul qui nous a transmis de manière explicite la doctrine de la justification dans son Épître aux Romains. Assurément, David possédait déjà une intuition de cette vérité, mais à l’étape de l’écriture du premier psaume, il se contente de brosser un portrait distinctif du juste.
D'après les Écritures, les critères de la justice des hommes ne sont que relatifs. Cette justice relative peut se manifester, par exemple, lorsqu’un philanthrope offre son aide aux gens dans le besoin. La Bible encourage les œuvres de justice relative, mais elle enseigne que les critères de la justice de Dieu sont absolus. D’après ces critères, hormis Jésus-Christ, aucun être vivant ayant foulé la terre n’a été et ne sera capable d’une telle justice, “selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, pas même un seul” (Romains 3.10). Face au jugement divin, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle, même pour le philanthrope.
La Bonne Nouvelle, qui est aussi appelée l’Évangile, c’est que la justice parfaite de Christ est imputée gratuitement sur le compte moral de ceux qui la reçoivent au moyen de la foi: “car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi” (Romains 3.28).
Comme l’explique le pasteur Armand de Mestral dans son Commentaire sur le livre des Psaumes (1861):
L’expression le juste (en hébreu tsadik), qui se rencontre si fréquemment dans l’Ancien Testament, n’implique de la part des auteurs sacrés aucune idée de propre justice. Les plus éminents d’entre les fidèles ne se confiaient nullement en leurs œuvres, mais en la miséricorde de Dieu; ils regardaient par la foi au Sauveur qui devait venir, ils croyaient aux promesses de Dieu et leur foi leur était "imputée à justice" (Genèse 15.6; Romains 4.3, 6)1.
La justification que Christ procure ne saurait servir de prétexte pour mener une vie de désordre. Au contraire, quiconque investit sa confiance dans cette justification s’efforcera inévitablement d’en témoigner par sa conduite. Certes, la conduite suscitée par cette justification s’avérera toujours insuffisante pour satisfaire les critères absolus de la justice divine, mais quiconque est justifié par Christ, mû par une profonde gratitude envers son Sauveur, sera incité à lui obéir toujours davantage, le reconnaissant à juste titre comme Maître de sa vie.
L’abstinence du juste (v. 1)
Examinons d’abord ce que le juste rejette. Comme le souligne le théologien R. C. Sproul, dans une conférence qu'il a intitulée Un roseau brisé (2002), l’adhésion aux vérités fondamentales du christianisme exige la réfutation de ce qui s’en écarte2.
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs.
Psaumes 1.1
Le psalmiste décrit ce dont le juste s’abstient. Cette abstinence concerne d’abord son esprit. La confiance que le juste investit dans l’autorité de la Parole de Dieu lui sert de rempart contre l’influence des discours idéologiques. Ces discours opèrent “selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air [c’est-à-dire le diable], de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion” (Éphésiens 2.2). Les Écritures révèlent que, par nature, tous les descendants d’Adam sont rebelles à Dieu et à sa Parole. L’esprit humain peut être envisagé comme un territoire que des discours rivaux se disputent.
Dans le verset initial du premier psaume, la succession des verbes "marcher", "s’arrêter" et "s’asseoir" rend compte d’une corruption spirituelle progressive. La personne qui commence par subir l’influence des discours idéologiques court le danger de finir par s’asseoir délibérément parmi ceux qui blasphèment Dieu. Le juste, sans éviter de manière phobique la présence des méchants, ne s’y trouve plus comme dans son élément naturel. Plutôt que de se laisser séduire par leurs discours, il se tient toujours prêt à leur répondre de l’espérance qui l’habite (cf. 1 Pierre 3.15).
La consécration du juste (v. 2)
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit!
Psaumes 1.2
Le deuxième verset du premier psaume décrit ce à quoi le juste se consacre. Sur le plan de la réflexion, le juste est libre de méditer sur tous les sujets susceptibles de l’édifier. Il ne prétend pourtant pas à la même sorte de liberté de réflexion que celle dont se prévalent les philosophes. La valeur des méditations du juste réside précisément en sa disposition à recevoir la révélation de Dieu. On pourrait objecter à cela qu’il serait extrêmement présomptueux pour une simple créature de croire qu’elle peut recevoir la révélation du Créateur du ciel et de la terre. Cette croyance témoigne pourtant d’une humilité envers l’autorité de la Parole de Dieu. Cette humilité entre en contraste avec la posture des philosophes, qui ont l’arrogance de croire qu’ils peuvent atteindre la vérité en la bâtissant sur des fondements qu’ils établissent selon l’autorité qu’ils octroient à leur propre convenance.
Il y a une manière cavalière de s’intéresser aux Écritures, qui caractérise l’attitude qu’adoptent les philosophes prétendument "libres-penseurs". Ils abordent la Bible comme un simple artefact qui rendrait compte de conceptions primitives, dont les progrès de la modernité les auraient affranchis. Ces philosophes peuvent admettre que les Écritures véhiculent une certaine sagesse, sans pour autant en reconnaître l’autorité plénière. Cette approche pervertit la relation normative que les auteurs bibliques entretenaient avec leurs propres écrits. En vertu de son inspiration divine, le contenu de la Bible établit les critères d’acceptabilité de celui qui s’y plonge. Les prétendus libres-penseurs s’imaginent néanmoins que ce sont leurs propres critères qui doivent déterminer l’acceptabilité du contenu biblique. Lors de leurs explorations des Écritures, ces philosophes peuvent en ressortir intellectuellement stimulés ou esthétiquement touchés, mais ils demeurent existentiellement inchangés.
Tout individu un tant soit peu disposé à entendre le retentissement de la Parole de Dieu dans sa vie subit un anéantissement identitaire. La conversion survient de cette mort à soi-même, lorsqu’une nouvelle identité en émerge, “régénéré[e] non d’une semence corruptible, mais d’une semence incorruptible: par la parole vivante et permanente de Dieu” (1 Pierre 1.23). Au verset 2, “la loi de l’Éternel” ne concerne pas exclusivement ses commandements pris isolément, mais plutôt l’intégralité du conseil divin. Pour le fidèle authentique, aucun livre n’a de valeur égale à la Bible. Il tient les Écritures en révérence, s’appliquant à soumettre sa pensée, ses affections et sa conduite à ce qu’elles indiquent et prescrivent.
Les fruits qui en découlent (v. 3)
Avant de poursuivre notre exposé, rebroussons chemin pour considérer l’adjectif initial du premier psaume: le tout premier mot du psautier: "Heureux." Celui-ci traduit de l’hébreu Ašrê. Cet adjectif anticipe celui qui ouvre les Béatitudes que prononce Christ, dont voici la première:
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
Matthieu 5.3
Le bonheur biblique diffère de celui que le monde préconise. Il ne se définit ni par le passage d’émotions plaisantes ni par celui de circonstances favorables. Dans le psautier, David ne cache pas qu’il traverse des périodes d’extrême affliction. Paradoxalement, nous relevons son état intérieur de béatitude, en présumant que l’adjectif "heureux" le concerne personnellement. Le bonheur de David s’explique par l’assurance dont il jouit d’être éternellement aimé de Dieu, quoiqu’il advienne. La suite de notre exposé du livre des Psaumes rendra sensible que cette affliction et ce bonheur simultanés agissent comme des préfigurations de la mort abjecte et de la résurrection glorieuse de Christ.
Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: tout ce qu’il fait lui réussit.
Psaumes 1.3
L’image de l’arbre verdoyant portant du fruit agit comme une métaphore de la condition éternelle du juste. Une semblable image paradisiaque se donne à lire dans le premier livre de la Bible (cf. Genèse 2.9) et se trouve aussi dans le dernier livre de la Bible:
Au milieu de la place de la ville […], il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Apocalypse 22.2
L’image de l’arbre verdoyant portant du fruit parcourt l’entièreté du récit biblique. Elle renvoie à la sécurité éternelle du juste, fondé dans l’amour de Dieu.
La voie du méchant
Après avoir examiné la voie du juste, nous tournons maintenant notre attention vers celle du méchant. Les trois derniers versets du premier Psaume traitent de l’agitation du méchant (v. 4), du jugement auquel il fera face (v. 5), et de sa ruine éternelle (v. 6).
La Parole de Dieu pose un diagnostic sans concession envers tous les descendants d’Adam, dont le “cœur est tortueux et […] méchant” (Jérémie 17.9). Cette qualification de "méchant" ne se limite pas aux transgresseurs des lois civiles. Au regard des critères absolus de la justice de Dieu, même un citoyen exemplaire, contribuable honnête et père de famille attentionné, demeure "méchant". Face à la perfection divine, tous sont coupables (Romains 3.19).
La Bible confronte son lecteur à l’humiliation radicale de reconnaître que, d’après les critères absolus de la justice divine, ce qu’il pourrait subjectivement considérer comme "un péché mignon" revient objectivement à de la méchanceté. Martin Luther donne cet avertissement:
Quand l’Écriture parle des méchants, prends garde de ne penser qu’aux Juifs, aux païens ou à d’autres; mais considère que cette parole te concerne aussi et qu’elle doit t’inspirer un effroi salutaire3.
Une promesse extraordinaire est offerte au méchant qui reconnaît sa condition. À l’inverse, les Écritures sont muettes pour celui qui rejette ce diagnostic. Le méchant a beau évaluer sa vie en ignorant l’autorité divine, il a beau tenter de s’appuyer sur la validation de ses pairs pour anesthésier sa conscience, celle-ci ne l’en accuse pas moins. Au plus profond de son cœur, l’idée d’un Dieu juste et omniscient le tétanise d’effroi. Écrasé sous le fardeau de la culpabilité, il reconnaîtra de son vivant son besoin d’amour criant, ou il le rejettera orgueilleusement jusqu’à la mort. Quoi qu’il en soit, la Parole de Dieu promet que de gré ou de force, “tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu” (Romains 14.11).
L’agitation du méchant (v. 4)
Il n’en est pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le vent dissipe.
Psaumes 1.4
L’adjectif "méchant", traduit de l’hébreu rāšā, évoque l’agitation d’une conscience coupable. Le prophète Ésaïe l’illustre:
Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n’y a point de paix pour les méchants.
Ésaïe 57.20-21
Cette turbulence du méchant apparaît ici comme la paille que le vent dissipe. Cette image contraste avec celle de l’enracinement de l’arbre planté près d’un courant d’eau, au verset précédent. Au jour du jugement, le méchant devra rendre compte seul de sa vie. La vérité s’imposera alors à sa conscience dans toute son horreur:
[Toute ma] justice est comme un vêtement souillé; [je suis flétri] comme une feuille, [et mes crimes m’]emportent comme le vent.
Ésaïe 64.5
Le jugement auquel le méchant fera face (v. 5)
C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes.
Psaumes 1.5
L’image de la paille que le vent dissipe et celle du méchant emporté par ses crimes chez Ésaïe s’inscrivent dans une continuité historique dont témoigne aussi le verset 5. Les institutions judiciaires d’Israël anticipaient déjà le jugement eschatologique. Cette réalité future se reflète aussi dans l’exercice chrétien de la discipline ecclésiale. Les méchants éprouvent un malaise dans l’assemblée des justes. Soit qu’ils s’y convertissent, soit qu’ils s’en éloignent naturellement, soit que l’Église les excommunie, en raison de leur endurcissement.
La ruine éternelle du méchant (v. 6)
Car l’Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Psaumes 1.6
Aussi pénible que puisse parfois paraître la vie temporelle du juste, son horizon est ouvert à la gloire éternelle. À l’inverse, aussi florissante que puisse parfois sembler la vie temporelle du méchant, sa destination l’enferme dans une ruine éternelle. Cependant, le bonheur et le malheur temporels du juste et du méchant ne sont pas nécessairement inversement proportionnels à leur condition éternelle. Le dernier verset aboutit sur une parole d’encouragement pour l’un et sur un terrible verdict pour l’autre. Le terme "ruine" qui traduit l’hébreu ābad partage sa racine étymologique avec un nom propre désignant le diable, au dernier livre de la Bible: “l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon” (Apocalypse 9.11). Cette parenté linguistique dévoile un lien spirituel entre la destination éternelle des méchants et celle du prince des ténèbres.
Tout individu se trouve à la croisée de deux chemins inconciliables. D’une part, le chemin sur lequel le juste est engagé l’ouvre à une gloire perpétuelle, puisqu’il s’est soumis à juste titre à la seigneurie de son Sauveur Jésus-Christ. D’autre part, le chemin sur lequel le méchant est engagé, quand bien même il s’imagine être libre, le mène à une ruine éternelle, puisqu’il est soumis à la seigneurie d’Abaddon, le prince des ténèbres.
Conclusion
Dans le premier psaume, David emploie des images temporelles pour nous instruire au sujet d’enjeux éternels. Ces enjeux sont réels et ils concernent tous les hommes, car ils sont universels. Cette instruction prophétique est comme “une lampe qui brille dans un lieu obscur” (2 Pierre 1.19), celui qui la prend au sérieux fait preuve de sagesse, mais “[c]elui qui [la] néglige […] se méprise lui-même” (Proverbes 15.32).
→ Clique ici pour consulter tous les articles de cette série.
Ressources similaires
webinaire
1h pour comprendre 1 & 2 Samuel
Cet épisode de 1h pour comprendre un livre biblique, avec Frédéric Bican, enregistré le 27 novembre 2019, te fait (re)découvrir les livres de 1 & 2 Samuel. Laisse-toi surprendre par la cohérence, la profondeur et la richesse de la Parole de Dieu. L'objectif, c’est que tu puisses comprendre l’ensemble pour mieux vivre l’essentiel.
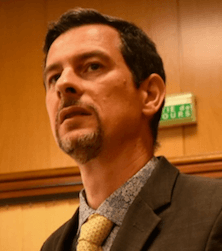
Orateurs
F. Bican