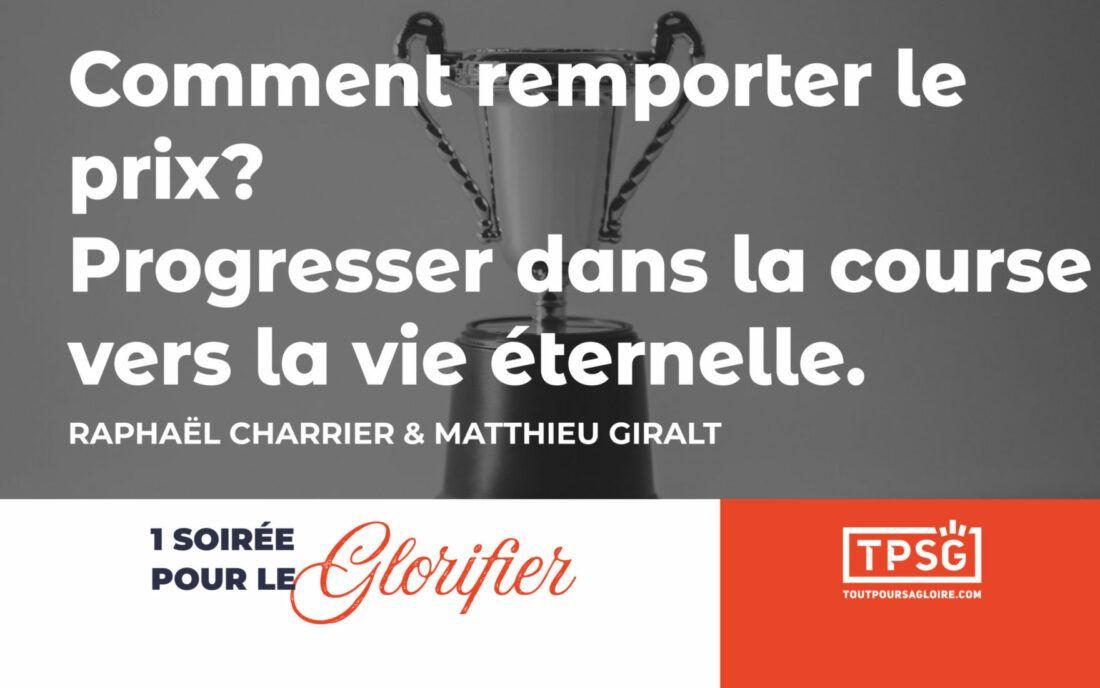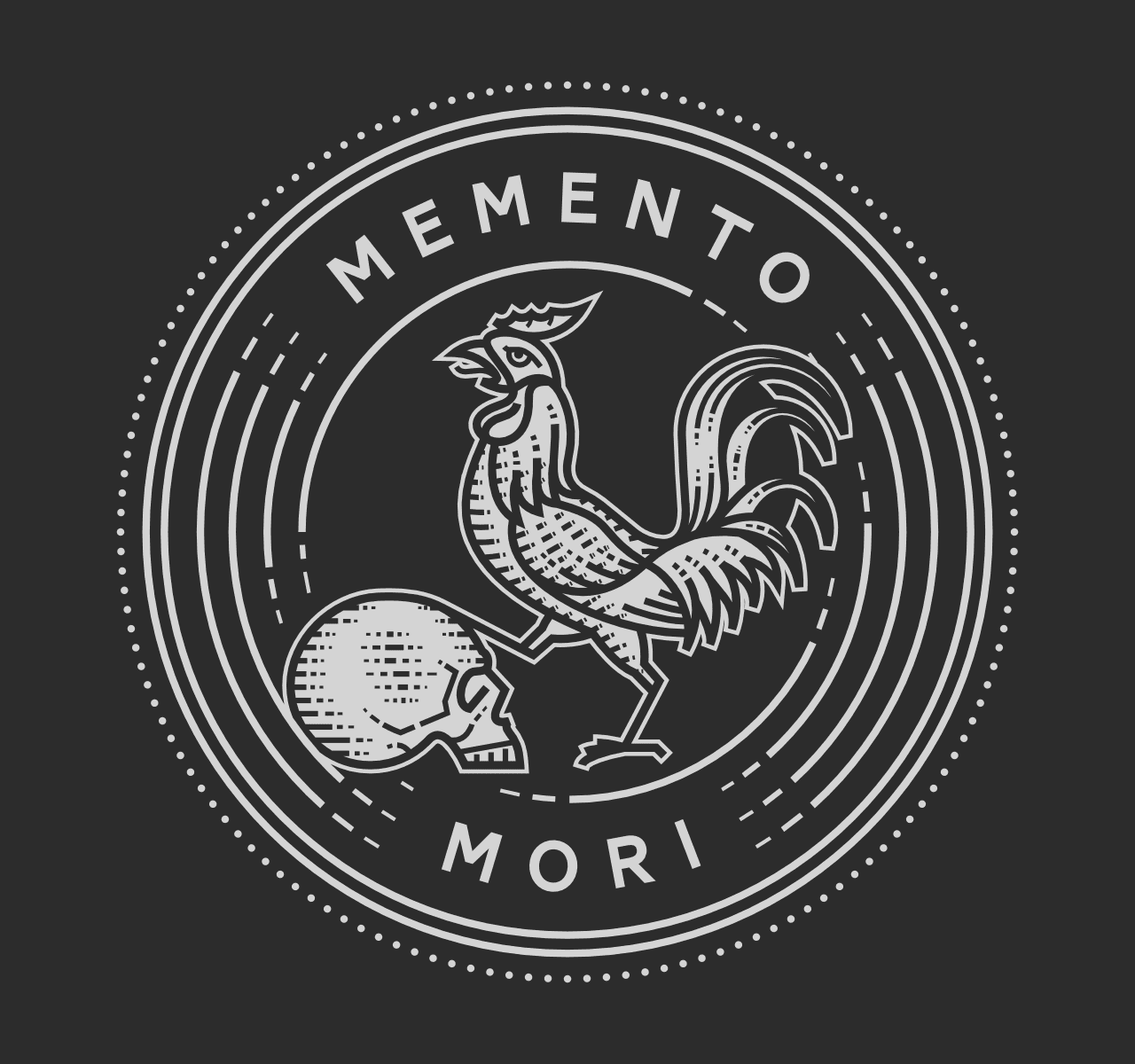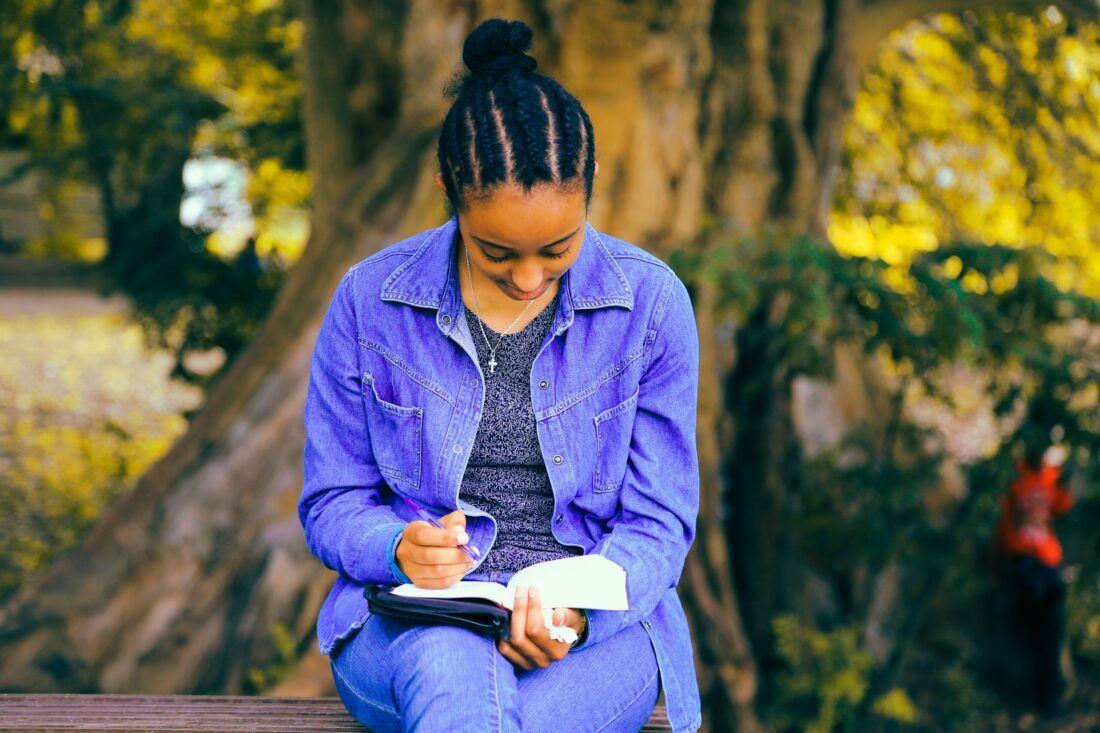Pourquoi faut-il être baptisé pour participer à la cène?
Vie chrétienneBaptêmeCèneCet article explore le lien entre le baptême et la sainte cène, afin de délimiter qui devrait être invité à la table du Seigneur.
Qui devrait prendre la cène? Peut-être que pour vous, la réponse à cette question est évidente: toute personne qui a la foi en Jésus-Christ! Cet article vise à montrer que la réponse doit être plus précise que ça. La profession de foi en Jésus-Christ est nécessaire, mais pas suffisante, comme condition pour participer au repas du Seigneur. Le baptême devrait aussi délimiter qui peut prendre la cène1.
Avant d’expliquer les raisons bibliques de cette position, j’aimerais soulever deux points importants.
Deuxièmement, cet article émerge d’une conviction que certaines pratiques en matière de sainte cène sont meilleures et plus bibliques que d’autres. Pourtant, je reconnais que d’autres chrétiens qui aiment le Seigneur peuvent penser différemment que moi. Cela ne m’empêche pas d’être en communion avec eux et d’exprimer cette fraternité. Cela n’empêche pas non plus d’exprimer nos désaccords, d’échanger nos arguments respectifs, afin d’arriver à la vérité2. C’est dans ce but que j’ai écrit cet article.
Comme cet article est long, en voici un sommaire:
I. Un sujet d’unanimité dans l’histoire?
Je n’ai pas de statistiques sur les pratiques actuelles des Églises évangéliques. Mon impression (qui vaut ce qu’elle vaut!) est cependant qu’il est largement accepté d’ouvrir la cène à toute personne qui se dit chrétienne, qu’elle soit baptisée ou non. Dans le contexte actuel, restreindre la cène à ceux qui sont baptisés semble manquer de charité chrétienne.
Pourtant, c’est la pratique historique des chrétiens depuis les premiers siècles. Nous voyons déjà cela dans la Didachè, l’un des premiers écrits chrétiens que nous possédons, qui date probablement de la fin du 1ᵉʳ siècle:
Que personne ne mange et ne boive de votre eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur […]3.
Nous retrouvons cela également dans les écrits de Justin Martyr (2ᵉ siècle)4 et de Cyprien de Carthage (3ᵉ siècle)5. Plus loin, et dans la tradition baptiste, cela se retrouve de manière explicite dans la Première Confession de Foi Baptiste de Londres (1646)6, ainsi que dans la Confession de Foi de New Hampshire (1833), dont l’article XIV dit que le baptême est “un prérequis pour […] le repas du Seigneur7”. Bref, c’est l’un des sujets sur lequel, historiquement, la plupart des grandes confessions chrétiennes sont d‘accord: il faut être baptisé pour pouvoir participer à la cène8.
En tant qu’évangéliques, nous répondons rapidement à de telles données en disant: “Ce n’est pas la tradition qui définit ce que nous croyons!” Il est vrai que l’Écriture seule est infaillible: elle contient toute la vérité que Dieu a voulu révéler à son peuple. Nos convictions théologiques et notre pratique doivent donc reposer sur ce que la Bible enseigne. Le but du reste de cet article est justement de présenter les bases bibliques d’une telle position.
Cependant, nous devrions également être lents à rejeter une pratique sur laquelle il y a eu une unité parmi plusieurs traditions chrétiennes pendant des siècles d’histoire. Une telle unité ne prouve pas la véracité de la pratique en question. Mais cela devrait nous forcer à avancer des arguments bibliques solides pour la rejeter. Il revient donc à ceux qui voudraient accepter des personnes non-baptisées au repas du Seigneur de donner les raisons bibliques pour lesquelles les chrétiens devraient changer d’avis sur cette question.
II. Quatre raisons bibliques de placer le baptême avant la cène
Il y a cependant bel et bien des raisons bibliques, en plus des raisons historiques, de placer le baptême avant la cène. En voici quatre, avant de répondre à quelques objections.
1. La signification du baptême et de la cène détermine leur ordre
Nous disons souvent que les ordonnances (le baptême et la cène) sont des signes visibles d’une réalité invisible. Ils symbolisent quelque chose. C’est en s’intéressant à ce qu’ils symbolisent que l’on comprend qu’il y a un ordre aux ordonnances: l’un vient logiquement avant l’autre. En d’autres termes, “leur signification détermine leur ordre9”.
Le baptême est le signe d’entrée dans la vie chrétienne. Le baptême pointe vers notre union avec Christ: nous sommes morts et ressuscités avec lui, ce qui convient au début de l’expérience chrétienne (Rm 6.3-4). Dans la pensée du Nouveau Testament, le baptême n’est pas un acte à part, détaché du salut chrétien. C’est plutôt un acte qui symbolise ce salut (Rm 6.3-4; Col 2.12; Ga 3.27; 1P 3.21). C’est pour cela qu’il y a une grande proximité entre le baptême et le salut dans le Nouveau Testament, d’une telle manière que Pierre peut utiliser le baptême comme métonymie pour parler de l’expérience du salut dans son ensemble (1P 3.21). Le symbole décrit la réalité, à savoir l’entrée dans la Nouvelle Alliance, l’intégration au peuple de Dieu.
La cène est également un symbole lié à la Nouvelle Alliance (Mt 26.28; Lc 22.20; 1Co 11.25). C’est un signe de communion, avec Christ et avec son corps – l’Église – ceux qui sont dans cette alliance (1Co 10.16-17). On pourrait dire que c’est le repas de l’alliance, pris en communion par les membres de cette alliance.
Ainsi, les réalités vers lesquelles pointent le baptême et la cène déterminent un certain ordre: le baptême signifie l’entrée dans l’alliance, alors que la cène est le repas de cette alliance. Logiquement, le baptême vient donc avant la cène.
Bobby Jamieson résume ces deux réalités ainsi:
Le baptême est la porte d’entrée de la maison, et le repas du Seigneur est le repas de famille10.
On ne peut pas avoir l’un sans l’autre, dans cet ordre.
2. Le parallèle avec l’Ancien Testament
Cette même logique est déjà présente dans l’Ancien Testament, avec le repas de la Pâque. Dans Exode 12, il est mentionné très clairement qu’il fallait être circoncis pour pouvoir participer à la Pâque (Ex 12.43-49). L’immigrant et l’esclave pouvaient y participer, mais à condition qu’ils soient circoncis. La Pâque était un repas d’alliance, qui devait être pris par ceux qui étaient passés par le signe d’entrée dans l’alliance, la circoncision. Il y a donc un ordre à respecter: d’abord le signe d’entrée, puis le "repas de famille".
Il est également intéressant de remarquer le langage que Paul utilise dans 1 Corinthiens 10.1-4, en parlant des Israélites dans le désert. Paul rapporte leur expérience en utilisant des symboles chrétiens11. Et ce n’est pas anodin de noter que Paul place le baptême avant la cène: les Israélites ont d’abord été "baptisés en Moïse" (v. 2), puis ils ont "mangé" et "bu" l’aliment et le breuvage spirituel (v. 3-4). C’est d’abord le baptême, puis la cène.
3. Le baptême identifie les chrétiens
Aux points présentés ci-dessus, quelqu’un pourrait soulever l’objection suivante:
“Oui, la cène est le repas de la Nouvelle Alliance, qui s’adresse à ceux qui font partie de cette alliance. Cependant, le critère pour y participer n’est pas le baptême, mais de faire partie de l’alliance. Il suffit donc que quelqu’un professe la foi en Jésus pour qu’il participe à la cène.”
Il est vrai que la cène est réservée aux chrétiens, à ceux qui font partie de la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus. Cependant, comment savoir qui sont ces chrétiens? Comment savoir qui fait partie de l’alliance?
Le baptême sert de marqueur d’identification pour représenter de manière visible ceux qui sont chrétiens. Le baptême est ce qui permet de reconnaître un croyant, et ce qui permet à un croyant de s’identifier avec le peuple de Dieu12.
C’est pour cela que Paul peut écrire aux chrétiens de Rome, sans forcément les connaître, en partant du principe qu’ils sont tous baptisés (comme on le voit dans Romains 6).
Ailleurs, Paul écrit aux Galates en disant:
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ13.
Galates 3.27
Par le baptême, on revêt Christ. On s’identifie publiquement à lui. On porte le facteur d’identification.
C’est un peu comme un joueur de foot qui porte le maillot de son équipe. Ce n’est pas le fait de porter le maillot qui fait de lui un joueur. Il est déjà joueur de cette équipe. Mais porter le maillot l’identifie comme tel. Il revêt les couleurs de son équipe, en montrant publiquement son appartenance à l’équipe.
De la même manière, ce n’est pas le baptême qui fait de quelqu’un un croyant: le baptême n’est pas cause de salut. Cependant, le baptême sert de marqueur public qui délimite ceux qui font partie de l’alliance et ceux qui n’en font pas partie.
Il est donc légitime que le repas de l’alliance soit pris uniquement par ceux qui se sont identifiés comme appartenant à cette alliance, par le baptême.
4. C’est par le baptême que l’on rejoint l’Église
Il est courant de penser que la cène vise à manifester l’unité de tous les chrétiens. Il y a effectivement un aspect communautaire essentiel à la cène, mais cette notion communautaire concerne premièrement l’Église locale.
J’ai tenté d’expliquer cela dans un précédent article TPSG à partir de 1 Corinthiens 10-12. Je vous laisse lire l’article si cela vous intéresse, pour éviter de répéter les arguments et que cet article soit trop long. Ce qui est important, c’est de comprendre que la sainte cène est un acte d’Église, que l’on fait en Église. Comme l’écrit Bobby Jamieson:
Le repas du Seigneur n’est pas simplement quelque chose que nous faisons avec l’Église, mais quelque chose que nous faisons en tant qu’Église14.
C’est important, car c’est cela qui explique la nécessité du baptême pour prendre la cène. La cène est liée à l’unité du corps local qu’est l’Église: la cène nous forme en "un seul corps" (1Co 10.17). La cène trace donc une limite entre ceux qui font partie de ce corps et ceux qui n’en font pas partie. La limite entre ceux du dedans et ceux du dehors (voir 1Co 5.12) est rendue visible par la cène. La question se pose cependant: comment rejoint-on ce corps?
C’est là que le baptême intervient. Comme Paul le montre dans 1 Corinthiens 12, la manière de rejoindre ce corps qu’est l’Église locale est le baptême (1 Corinthiens 12.27 ainsi que le contexte montrent bien qu’il s’agit d’Église locale).
Dans 1 Corinthiens 12, Paul veut mettre en avant l’unité de ce corps. Les Corinthiens sont composés de plusieurs membres, et pourtant ils sont un (v. 12). Il y a de l’unité malgré la diversité. Il est cependant important de relever ce qui crée cette unité, avec le verset qui suit:
Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
1 Corinthiens 12.13
Ici, Paul met en avant le fait que c’est le baptême qui a créé cette unité15. Parce que vous avez été baptisés, alors vous faites partie du même corps, malgré ce qui vous distingue. Ou pour le dire autrement, ceux qui font partie du corps, ce sont ceux qui ont été baptisés.
C’est la même idée qui se retrouve dans Actes 2.38-41: certains croient, ils sont baptisés, puis ils sont "ajoutés" à l’Église. On rejoint l’Église visible par le baptême.
C’est pour cela que le baptême est nécessaire pour prendre la cène. La cène manifeste l’unité du corps qu’est l’Église locale. La manière de rejoindre le corps, de prendre part à cette unité, c’est le baptême16.
III. Réponses aux objections
“C’est empêcher de vrais chrétiens de recevoir les privilèges de la cène.”
Le privilège de la cène est lié à l’unité du corps qu’est l’Église (cf. 1Co 10.17). Ainsi, ce n’est pas nous qui leur interdisons ce privilège, c’est plutôt eux qui s’en privent, en n’étant pas baptisés.
Il faut aussi se rappeler que le baptême n’est pas optionnel: c’est un commandement du Seigneur Jésus (Mt 28.16-20). Si quelqu’un veut prendre la cène, pourquoi donc ne se fait-il pas baptiser? C’est cette question qui doit être réglée premièrement, et ensuite viendra la cène.
“La personne ne peut pas être baptisée, mais elle peut prendre la cène entre temps.”
Chaque situation est unique et mériterait une conversation pastorale, plutôt que quelques remarques dans un article de blog. Cependant, si la personne ne peut pas être baptisée, il faut se demander pourquoi.
Est-ce en raison de critères trop élevés pour le baptême, pensant que le baptême ne doit être donné qu’à ceux qui sont vraiment matures? Il faudrait alors se rappeler que le critère du baptême n’est pas la maturité, mais la foi17.
Il y a cependant de bonnes raisons de retarder le baptême, par exemple pour s’assurer de la validité d’une profession de foi. Mais si l’on retarde le baptême pour des raisons légitimes, alors pourquoi encourager à prendre la cène en attendant? Les critères et avertissements concernant la cène sont explicites dans 1 Corinthiens 11, et ils ne sont pas moindres que les critères pour être baptisés (au contraire). Si donc on préfère attendre pour baptiser quelqu’un, afin de s’assurer de la légitimité de sa foi, il faudrait aussi logiquement attendre pour que cette personne participe à la cène. Ou alors, il faudrait expliquer comment quelqu’un pourrait être prêt à prendre la cène, selon les termes de 1 Corinthiens 11, sans être en même temps prêt à être baptisé.
“C’est la table du Seigneur, nous n’avons pas le droit d’empêcher quelqu’un d’y participer.”
Chaque Église pose des limites concernant la participation à la cène. Est-ce que l’on servirait la cène à quelqu’un qui vit ouvertement dans le péché, sans signe de repentance? À quelqu’un qui renie des aspects importants de l’Évangile tout en se disant chrétien? Probablement que non. La question n’est donc pas de savoir s’il y a des limites à la cène, mais plutôt de déterminer quelles sont ces limites. La première limite, comme cela a été argumenté, est une profession de foi crédible qui se manifeste par le baptême.
De plus, le Seigneur Jésus a confié à son Église, non seulement le privilège de la cène, mais aussi l’exercice de la discipline (Mt 18.15-20; 1Co 5), qui a nécessairement des implications sur la participation à la cène. La cène permet de tracer les contours du corps, de démarquer ceux qui sont "du dedans" et ceux qui sont "du dehors" (1Co 5.12). Lorsque l’Église exerce la discipline, cela va donc forcément impliquer une restriction au niveau du repas du Seigneur: la personne en question est considérée comme étant "hors du corps", et donc de la communion de l’Église. L’Église n’a pas seulement le droit, mais aussi le devoir, de protéger la table du Seigneur, qui manifeste l’unité du corps de Christ.
“Le seul critère pour participer à la cène est simplement d’avoir une relation personnelle avec le Seigneur.”
Dire cela revient à oublier que la cène n’a pas pour but de symboliser uniquement notre relation individuelle avec le Seigneur: c’est un "repas de famille". Il y a un aspect communautaire qui est essentiel à la cène. Dans 1 Corinthiens 10.16-17, Paul montre que par la cène, nous sommes en communion avec Christ et les uns avec les autres. Il y a une dimension verticale, mais il y a aussi une dimension horizontale, et les deux vont ensemble.
De plus, la dimension horizontale (communautaire) est indispensable. C’est pour cela que Paul reprend les Corinthiens dans 1 Corinthiens 11.18-34: le repas qui était censé symboliser leur unité mettait en avant leurs divisions! Paul va jusqu’à dire que ce n’est même plus le repas du Seigneur qu’ils prennent (1Co 11.20), tellement ils le font de manière égoïste et individualiste. Si l’on retire l’aspect communautaire de la cène, on perd l’un des buts essentiels de la cène.
Quelqu’un pourrait dire que, parce qu’il a la foi, alors il fait partie de la famille. Mais si quelqu’un a la foi, alors il devrait poursuivre le baptême, afin de rejoindre de manière visible la famille. Refuser cela, c’est mépriser l’Église, le corps de Christ. Comme quelqu’un le disait, on ne peut pas prendre le corps de Christ (la cène) tout en méprisant le corps de Christ (l’Église).
“Ce qui compte, c’est l’appartenance à l’Église universelle.”
Le Nouveau Testament met beaucoup plus l’accent sur l’Église locale que sur l’Église universelle, car l’Église locale est la manifestation "miniature" de l’Église universelle. Paul pouvait dire à l’Église de Corinthe: “Vous êtes le corps de Christ” (1Co 12.27) – non pas une partie du corps de Christ, mais le corps de Christ lui-même.
De plus, le baptême signifie l’intégration au corps de Christ dans son expression locale, c’est-à-dire à l’Église (Ac 2.41; 1Co 12.13). Concernant la cène, quelqu’un pourrait répondre que Jésus l’a instituée alors que l’Église locale n’existait pas. Pourtant, la suite du Nouveau Testament montre les premiers chrétiens prendre la cène dans un contexte bel et bien local.
Il ne peut donc pas y avoir d’appartenance à l’Église universelle qui ne se manifeste par une appartenance à l’Église locale. Cela reviendrait à séparer ce que Dieu a uni.
“Il n’y a pas un verset qui dit cela explicitement.”
Une des erreurs évangéliques modernes est d’exiger un "verset preuve" pour toute doctrine ou pratique. Tant que ce n’est pas écrit de toute lettre et sans que cela exige une réflexion de notre part, nous restons sceptiques! C’est une triste attitude. Si l’on appliquait cette logique à d’autres vérités de notre foi, nous aurions bien du mal à les prouver (par exemple la Trinité, ou le fait que la vie humaine démarre à la conception).
Bien sûr, notre doctrine et notre pratique reposent sur l’Écriture, et pas les spéculations humaines. Mais cela implique, non seulement ce que l’Écriture enseigne de manière explicite ("en toute lettre"!), mais aussi les "conséquences bonnes et nécessaires" qui proviennent de ce que l’Écriture enseigne de manière explicite, comme le dit la confession de foi de Westminster. Si l’Écriture enseigne A et enseigne B de manière explicite, et que A et B ensemble impliquent nécessairement C, alors on peut dire que C est un enseignement biblique, tout autant que A et B.
Il faudrait un article à part pour développer cette idée. En tout cas, ce qu’il faut se demander n’est pas: “Quel est le verset preuve?!” mais plutôt: “Est-ce ce que l’Écriture, prise dans son ensemble, m’amène à croire?”18.
IV. Comment faire dans la pratique?
Vous vous demandez peut-être à quoi cela ressemble dans la pratique d’exiger le baptême pour participer à la cène. Plusieurs chrétiens qui partagent cette même conviction pourraient la mettre en place différemment.
Il me semble que la manière de protéger la table du Seigneur se fait par l’avertissement verbal. Le responsable qui conduit la cène devrait expliquer ce que la cène représente et à qui cela s’adresse dans des termes clairs. Ensuite, c’est à chacun dans l’assemblée d’écouter ces paroles et d’agir en conséquence, selon sa conscience.
Par exemple, après avoir rappelé brièvement le but de la cène et la vérité de l’Évangile, celui qui conduit la cène peut dire ceci:
“Si vous croyez en cet Évangile et que vous avez été baptisés, vous êtes les bienvenus de participer en vous mettant debout. Si vous êtes en visite chez nous et que vous faites partie d’une Église qui prêche le même Évangile que le nôtre, vous êtes également les bienvenus de participer. Sinon, on vous encourage à rester assis et à méditer sur les vérités que vous avez entendues. Ce sont des promesses que vous pouvez également saisir.”
Ce n’est qu’un exemple, qui mériterait d’être amélioré. D’une certaine manière, c’est exclusif. Mais il y a de la beauté dans l’exclusivité. C’est un moyen de rappeler aux gens de manière visible la limite entre ceux qui font partie du corps et ceux qui n’en font pas partie, les invitant à se saisir des promesses de Dieu, afin de passer de l’extérieur à l’intérieur.
Voici ce que Gaëtan Jones, pasteur de l’Église de la Trinité à Lille, m’a transmis (ils incluent ce texte dans leur livret de culte):
Nous invitons chaleureusement tous ceux qui sont baptisés, qui dépendent de Jésus-Christ seul pour leur salut, et qui sont membres en règle d'une Église évangélique fidèle à participer au repas du Seigneur.
Si ce n'est pas votre cas, ou vous avez un doute à ce sujet, surtout ne sentez-vous pas gêné de ne pas participer, et de rester à votre place – nous sommes ravis que vous soyez présent parmi nous aujourd'hui — et nous vous invitons à en parler avec le pasteur.
Dans ce texte, j’apprécie particulièrement le mot plein de douceur qui est adressé à ceux qui ne participent pas à la cène.
V. Trois précisions pour conclure
Il y a toujours le risque d’être mal compris avec un tel article. J’offre donc trois précisions en guise de conclusion.
Premièrement, je ne suis pas en train d’encourager à considérer le baptême à la légère, suggérant qu’il faudrait baptiser automatiquement toute personne qui voudrait prendre la cène.
Deuxièmement, j’encourage à parler de ces choses avec grâce, compréhension, et compassion. L’article a été écrit pour une réflexion intellectuelle sur le sujet. Dans une conversation un à un, j’aurais probablement des mots et un ton différent. Sans que cela change les conclusions de cet article, il faut distinguer la discussion théologique et la conversation pastorale.
Troisièmement, la vie est souvent plus complexe qu’on ne le pense. Un article de blog sera toujours incapable de tout dire. Mon but a simplement été de montrer qu’il n’est pas permis bibliquement de séparer le baptême et la cène: les deux sont liés, dans un ordre particulier.
En tout ceci, que le Seigneur nous donne de la sagesse pour réfléchir à ces sujets et les appliquer à nos Églises, pour sa gloire19.