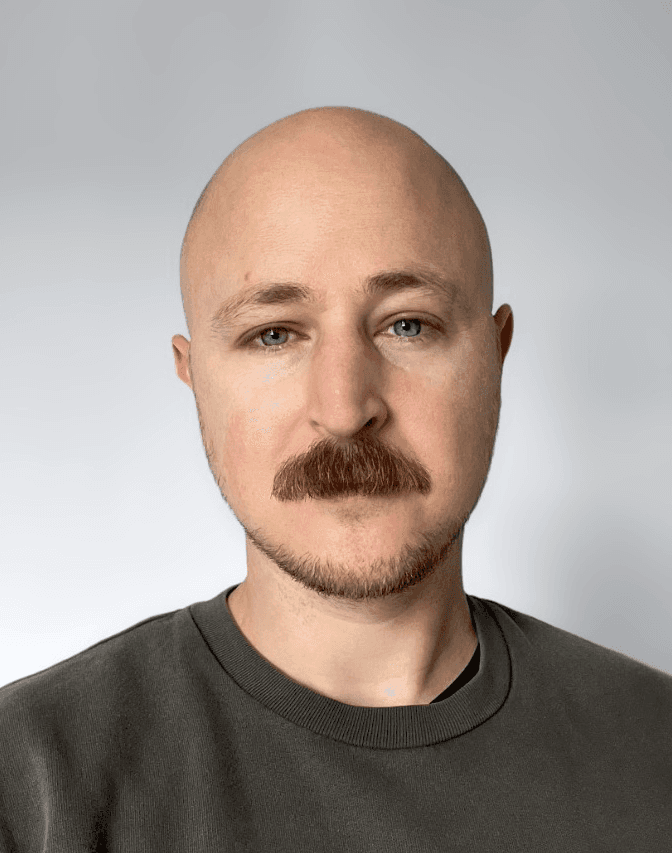Bilan de mon stage à CHBC
Actualité persoDifficile de résumer cinq mois aussi riches. Mon stage pastoral à Capitol Hill Baptist Church, à Washington D. C., a été une période profondément formatrice, à la fois pour moi et pour ma famille. Nous avons été ressourcés, encouragés et édifiés. Ce temps de recul m’a permis de réfléchir à l’Église, au ministère et à la place décisive de l’Évangile dans la vie de l’Église locale.
J’ai été particulièrement reconnaissant pour l’équipe de stagiaires, avec laquelle j’ai partagé mes journées, ainsi que pour les relations vécues au sein de l’Église, au cœur du quartier résidentiel de Capitol Hill, à seulement 800 mètres du Capitole.
Ce que j’ai fait
Tout au long de ce stage intensif, quatre axes ont structuré mon apprentissage: la lecture, l’écriture, l’observation et la discussion.
1. Lecture
L’un des piliers du stage a été la lecture. En l’espace de cinq mois, nous avons lu plus de quarante livres, en plus d’un grand nombre de chapitres et d’articles — soit plus de 9 000 pages au total.
Parmi les ouvrages abordés, certains portaient sur des doctrines (la théologie biblique, l’ecclésiologie, la conscience chrétienne, la doctrine de l’Église). D’autres exploraient des questions pratiques liées au ministère (le leadership, la prédication, le discipulat, la membriété, la discipline ecclésiale, la gestion du budget, l’organisation du culte). D’autres encore nous confrontaient à des enjeux historiques ou contemporains (l’histoire de la Réforme, l’histoire de l’évangélisme, la mission, l’évangélisation, le baptême, la cène, le rapport à la politique, au racisme, ou encore les dérives de la théologie de la prospérité).
Chaque lecture nous confrontait à des questions concrètes: Qu’est-ce qu’une Église saine? Comment la conduire? Comment la protéger? Comment la faire grandir dans la vérité et l’amour?
2. Écriture
À partir de nos lectures, nous devions rédiger un devoir de réflexion. Au total, j’ai rédigé cinquante devoirs. Ces devoirs visaient à mobiliser ce que nous lisions, et surtout à faire le lien entre la théologie et les réalités du ministère. Qu’est-ce que ce livre m’apprend pour la prédication? Pour la formation des anciens? Pour l’organisation de la vie d’Église? Pour la discipline? Pour les relations entre Églises? Chaque devoir devenait ainsi un espace de maturation théologique et pastorale.
Loin d’être un simple exercice académique, ce travail d’écriture m’a aidé à réfléchir, à décanter et à appliquer ce que je lisais. Cette discipline d’écriture m’a aidé à formuler plus clairement mes convictions et à continuer d’affiner ma vision pastorale.
3. Observation
Un des aspects les plus formateurs du stage a été l’observation. Pendant cinq mois, nous avons été plongés dans la vie quotidienne de l’Église, et notamment dans celle des pasteurs. Nous assistions à toutes les réunions possibles: les cultes, bien sûr, mais aussi les réunions d’anciens, les entretiens des futurs membres, les réunions de préparation de culte, les études bibliques…
→ Voir mon article: "Une semaine dans ma vie de stagiaire à CHBC".
Mais au-delà des réunions, c’est en vivant la vie de l’Église que j’ai le plus appris. En observant les pasteurs dans leur quotidien, dans leur manière de prendre soin des membres, de prier ensemble, de prendre des décisions, de s’encourager mutuellement, de porter la charge. En voyant comment les membres s’aiment, se reprennent et se soutiennent. En écoutant les conversations à la sortie du culte, autour d’un repas. Toute l’Église nous a fait grandir.
J’ai vu ce que cela signifie d’aimer l’Église, d’en prendre soin, de l’écouter, de la diriger avec humilité et fidélité. Cette expérience a probablement été le facteur de formation le plus puissant de tout le stage.
4. Discussions
Tous les soirs à 17h, dans le bureau de Mark, nous pouvions lui poser des questions sur nos lectures ou sur tout autre sujet. Le jeudi matin, lors de la "discussion des stagiaires", nous échangions autour des lectures de la semaine, des devoirs écrits ou à propos des questions pastorales soulevées par les uns ou les autres.
Mais je dois dire que les échanges les plus stimulants avaient lieu dans le bureau des stagiaires, où nous débattions souvent de sujets controversés ou critiquions librement nos lectures.
Ce qui m’a marqué
1. La prépondérance de l’Évangile
La première chose qui ressort avec évidence à CHBC, c’est la place absolument centrale de l’Évangile dans la vie de l’Église. Ce n’est pas un thème parmi d’autres ni une simple base doctrinale. C’est ce qui détermine l’essence, l’unité et la mission de l’Église.
Mark Dever aime comparer l’Église à un écrin. Elle existe pour protéger, faire briller et promouvoir le diamant qu’est l’Évangile. Ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ — sa vie parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse, son ascension, son règne et son retour à venir — est ce que l’Église veut proclamer, défendre et incarner. L’Église existe pour glorifier la personne et l’œuvre de Christ.
Cette conviction se traduit concrètement. Chaque dimanche, matin et soir, l’Évangile est annoncé de manière claire, directe et fidèle lors des cultes. Mais l’annonce de l’Évangile ne se limite pas à la prédication. L’ordre même du culte le raconte: Dieu est saint, nous sommes pécheurs, Christ est Sauveur, Dieu nous appelle à répondre par la foi et la repentance, et à nous réjouir de sa grâce. L’Évangile structure le déroulement du culte.
L’Évangile est aussi présent dans les études bibliques, les groupes de maison, les discussions informelles. En réalité, chaque fois que l’Église se réunit, l’Évangile est rappelé. Il est la bonne nouvelle que les croyants ne se lassent pas d’entendre et que les responsables ne cessent d’annoncer.
2. La beauté et la profondeur des chants
Un autre aspect marquant de la vie de l’Église à CHBC est la place du chant, et plus encore, sa richesse. Non seulement on y chante beaucoup, mais on y chante bien. Le dimanche matin, on chante neuf chants. Le soir, six. Le chant, à CHBC, est une forme d’enseignement collectif autant qu’une expression de la louange de l’assemblée.
La plupart du temps, les chants sont chantés presque a cappella. Il y a un piano et une guitare, mais ils accompagnent avec discrétion le millier de personnes présentes le dimanche matin. Cela donne à l’assemblée toute sa place: on entend les voix.
Les paroles sont d’une grande richesse. L’Église chante de très nombreux hymnes, souvent issus du XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle. Des textes riches sur le plan théologique, mais aussi touchants. Ils nourrissent la pensée autant que les affections. Ils forment, consolent, instruisent et encouragent les membres. Ils permettent à l’assemblée d’exprimer sa foi, sa joie, sa tristesse, sa repentance et son espérance.
Les chants sont choisis avec soin, intégrés dans un ordre de culte cohérent, et ils contribuent à forger la théologie de l’Église.
3. La prévalence de la prière
Ce qui m’a aussi profondément marqué au cours de ces cinq mois à CHBC, c’est l’omniprésence de la prière dans la vie de l’Église. Elle n’est pas périphérique ni occasionnelle. Elle est partout: dans les cultes, dans les réunions du staff, dans les relations entre membres. C’est une Église qui prie. Et qui prie bien.
Cela commence dès les réunions du staff pastoral. Chaque rencontre débute par la prière, et pas seulement une courte invocation formelle. Il s’agit d’un temps intentionnel durant lequel les pasteurs prient pour les membres de l’Église à partir du répertoire des membres.
Dans les cultes aussi, la prière occupe une place importante. Le matin, plusieurs types de prières rythment le culte: une prière d’adoration, une prière de confession, une prière pastorale de pétition (souvent assez longue) et une prière de reconnaissance. Ces prières sont préparées avec soin.
Le soir, un moment est également consacré à la prière communautaire. Une dizaine de sujets de prière est présentée à l’assemblée, puis plusieurs membres désignés prient à voix haute. Ces sujets sont variés: actualité mondiale, besoins missionnaires, membres malades ou en difficulté, événements à venir. Et l’on sent que ce n’est pas une routine: c’est un exercice spirituel central pour la vie de l’Église. Les prières sont bibliques, précises, profondes, nourries de l’Évangile.
Pourquoi les gens prient-ils aussi bien? À mon avis, c’est parce qu’ils sont formés par les prières qu’ils entendent le dimanche matin, semaine après semaine. Être exposé chaque semaine à des prières mûrement réfléchies, bien articulées, riches en contenu biblique, a une influence formatrice. Les prières que nous entendons nous enseignent à prier.
4. Le sérieux et le dévouement des pasteurs (staff et laïcs)
Ce qui m’a également profondément marqué, ce sont les pasteurs — qu’ils soient membres du staff ou anciens laïcs.
J’ai été particulièrement frappé par la disponibilité du staff pastoral. Non seulement ils prennent soin des membres de l’Église avec sérieux, mais ils ont aussi pris soin de nous et nous ont consacré du temps. Chaque stagiaire avait un mentor attitré. Il n’était pas rare de partager un repas avec un membre du staff en semaine.
Ce qui m’a aussi interpellé, c’est leur professionnalisme. On entend souvent — à juste titre — que les pasteurs ne sont pas des professionnels dans le sens où le ministère ne s’accomplit pas comme un métier ordinaire, mais dans une dépendance constante à l’Esprit. Et pourtant, ces pasteurs travaillent comme pour le Seigneur, avec sérieux, rigueur et recherche d’excellence. Ils ne se contentent pas de faire leur travail: ils cherchent sans cesse à mieux le faire. Comment mieux accompagner les membres? Comment être plus fidèles à l’Écriture?
Leur humilité m’a marqué. De manière générale, la crainte des hommes est traquée et mise à mort. Je me souviens d’une discussion où un des pasteurs nous partageait ses manquements et son besoin de grandir sur un point en particulier.
J’ai aussi été impressionné par les anciens laïcs. Bien qu’ayant un emploi à plein temps, souvent extrêmement prenant, ils prennent leur charge pastorale avec un grand sérieux. Pour chaque réunion d’anciens, un dossier complet est préparé. Ils prennent le temps de le lire, de s’y préparer, et de réfléchir aux enjeux en amont. Ils arrivent équipés, prêts à exercer leur autorité et leur responsabilité.
5. La maturité des membres
Un des éléments les plus encourageants que j’ai observés à CHBC, c’est la maturité spirituelle des membres de l’Église.
Ce qui m’a frappé, c’est la manière spontanée avec laquelle les membres prennent soin les uns des autres. Les échanges sont souvent nourris de la Parole de Dieu: ce n’est pas rare de voir quelqu’un ouvrir sa Bible pour répondre à une question, orienter une décision ou apporter une consolation.
Cette maturité est aussi portée par la qualité de l’enseignement dispensé dans l’Église. Ce souci de former des croyants solides est omniprésent, que ce soit le dimanche, dans les classes de formation ou dans les entretiens personnels.
Le processus pour devenir membre en témoigne aussi. Il ne s’agit pas d’un formulaire à signer, mais d’un véritable parcours. Six cours intitulés "Membership matters" présentent les fondements bibliques de la membriété, la vision de l’Église locale et les attentes mutuelles entre membres et responsables. Ensuite, chaque candidat passe un entretien avec un pasteur, pour vérifier son témoignage, son engagement, sa compréhension de l’Évangile et sa volonté de vivre en communion avec l’assemblée.
À cela s’ajoute un document essentiel dans la vie de l’Église: l’alliance d’Église. C’est un texte historique, rédigé à la fondation de l’assemblée (comme c’était courant à l’époque), et qui sert encore aujourd’hui de base à l’engagement des membres. Il est lu régulièrement pendant les cultes et au début de chaque réunion de membres, ce qui permet de rappeler les engagements pris mutuellement.
Enfin, cette maturité spirituelle est voulue, encouragée et cultivée par les anciens. Ils visent activement à ce que les membres croissent en discernement et en maturité, parce que ce sont les membres — et non seulement les anciens — qui sont responsables collectivement de promouvoir et défendre l’Évangile dans l’Église. Ce sont les membres qui admettent de nouveaux membres. Ce sont eux qui exercent la discipline. Ce sont eux qui élisent les anciens.
J’ai été profondément encouragé par cette vision: une Église où les membres ne sont pas consommateurs, mais gardiens les uns des autres et du témoignage de l’Évangile. Une Église où l’on ne délègue pas la responsabilité spirituelle aux seuls pasteurs, mais où l’on forme tout un peuple à discerner, à enseigner, à prier, à aimer. C’est une Église vivante, mûre, enracinée dans la vérité et animée par la grâce.
6. La générosité de l’Église
Un dernier aspect que je retiens avec reconnaissance de ces cinq mois, c’est la générosité remarquable de CHBC.
Nous avons, en tant que famille, été les premiers bénéficiaires de cette générosité. Bien sûr, il y a la générosité: nous avons été hébergés pendant 5 mois et avons reçu une bourse pour notre stage. Mais c’est plus que cela. Dès notre arrivée, plusieurs membres de l’Église ont pris le temps de nous rencontrer et de venir nous saluer. Les pasteurs ont également été disponibles, malgré leur charge. On sent que cette générosité est naturelle, enracinée dans l’Évangile et largement partagée au sein de l’Église.
Cette générosité se manifeste aussi de manière très concrète dans la manière dont l’Église utilise son argent: 20 % du budget de CHBC est consacré à la mission. Ce choix n’est pas marginal. Il reflète une conviction profonde: l’Église locale n’est pas seulement appelée à exister pour elle-même, mais à participer activement à l’avancement de l’Évangile dans le monde.
Mais la générosité de CHBC ne se limite pas à l’accueil ou au financement. Elle se voit aussi dans l’investissement massif dans la formation et l’envoi de pasteurs et de missionnaires. Le programme de stage pastoral en est un exemple, mais il s’inscrit dans une vision beaucoup plus large: faire de l’Église un centre de formation, de maturation et d’envoi. De nombreux pasteurs et missionnaires ont été formés à CHBC, puis envoyés pour implanter, reprendre ou revitaliser des Églises locales, aux États-Unis ou à l’étranger.
Et ce qui est frappant, c’est que CHBC ne cherche pas à garder ses meilleurs éléments. Elle les envoie. C’est une Église qui forme pour donner, pas pour conserver. Une Église qui croit en la reproduction et qui se réjouit de voir d’autres communautés bénies à travers le monde grâce à ceux qu’elle a formés. Cela témoigne d’une vision biblique du Royaume de Dieu: ce n’est pas notre royaume qui doit grandir, mais le sien.
Cette générosité est le fruit d’une saine théologie de la grâce: Dieu a tout donné en Christ, et cela produit une Église qui donne à son tour. J’en ai été témoin. Et je repars avec le désir de cultiver, dans mon propre ministère et dans mon Église, ce même esprit de générosité.
Conclusion
CHBC m’a frappé par l’équilibre qu’elle incarne: une Église à la fois solidement organisée et profondément organique. L’ordre de culte est structuré, les documents sont clairs, les responsabilités bien définies. Et pourtant, jamais la rigueur ne prend le pas sur la joie ou sur la vie. C’est une Église qui prie, qui accueille et qui partage.
Je repars profondément encouragé par ce que j’ai vu. Certaines pratiques m’ont inspiré, d’autres m’ont corrigé. Et ce que j’ai reçu me donne encore plus d’estime pour l’Église d’Étupes, que je considère avec reconnaissance comme une Église saine, que j’ai le privilège de servir.
Au terme de ces cinq mois, je repars reconnaissant, corrigé et inspiré. Mon amour pour Christ s’est approfondi. Mon attachement à son Église s’est renforcé. Mon affection pour l’Église d’Étupes s’est renouvelée. Je rentre avec le désir de poursuivre un ministère simple, fidèle, centré sur la Parole, l’Évangile et la prière.
Et surtout, je rends grâce à Dieu pour ce temps: un cadeau précieux, que je veux mettre au service de ce qu’il m’a confié.