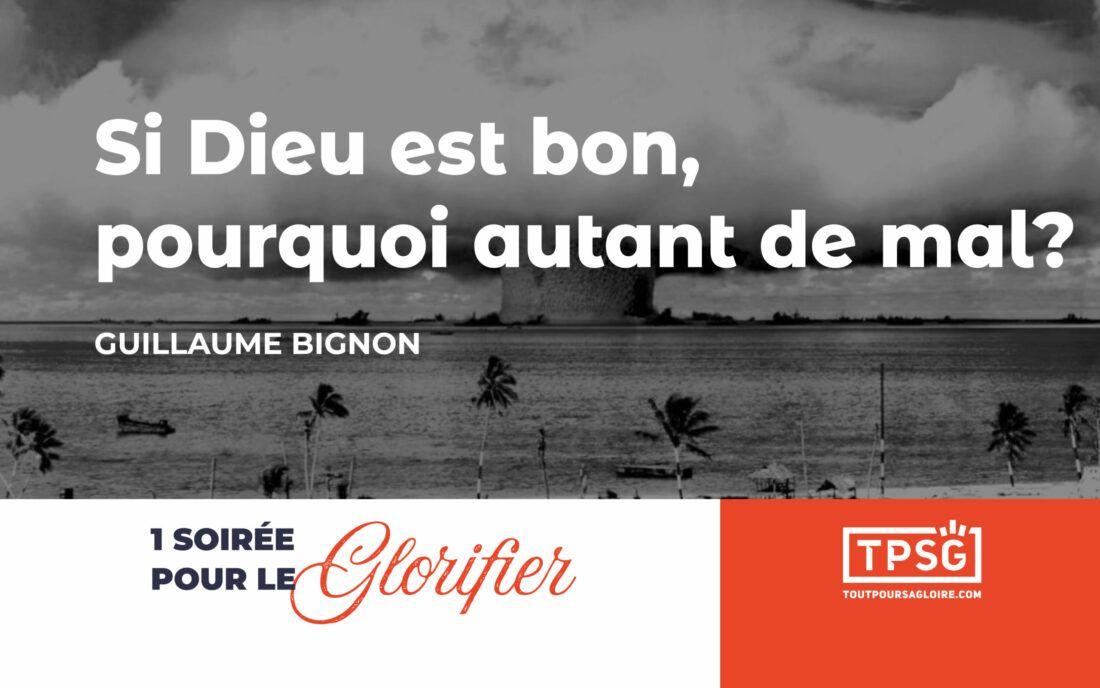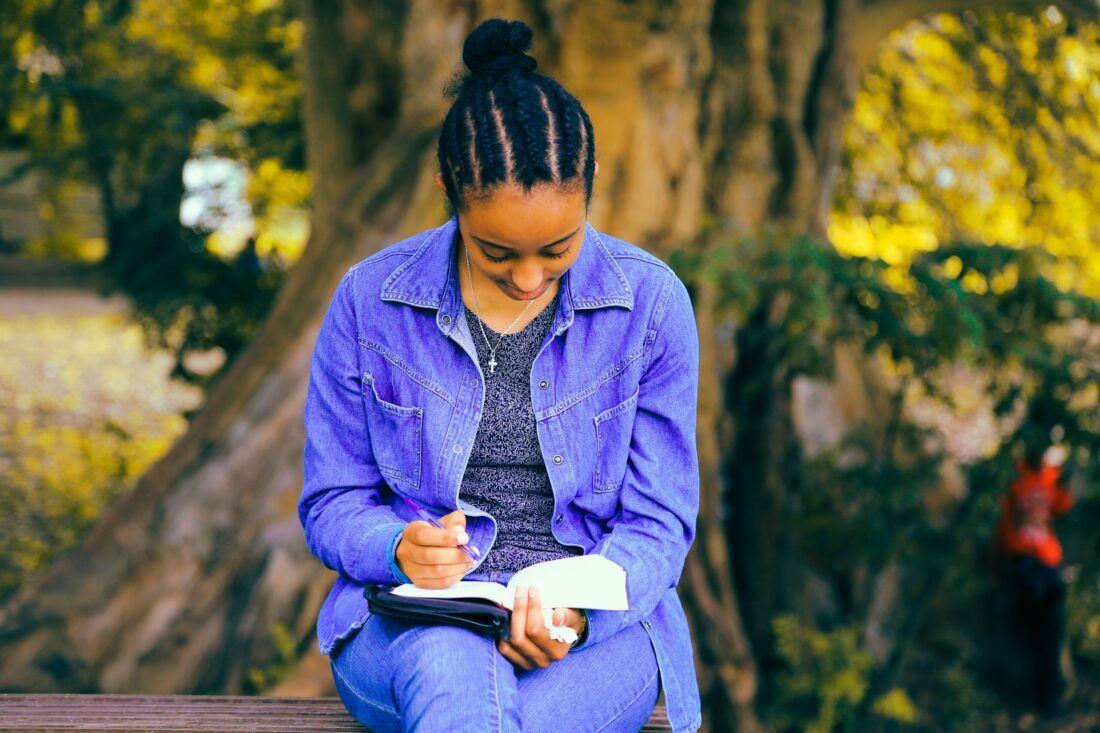Soins médicaux en fin de vie: 4 principes à ne pas oublier
SouffranceÉthiqueFin de vie et euthanasieQuelle attitude adopter, en tant que chrétien, face aux soins médicaux en fin de vie? Croire en la valeur sacrée de la vie humaine signifie-t-il qu’il faut tout tenter, à tout prix? Cet article propose quatre principes bibliques à garder en tête pour éclairer nos décisions dans ces moments délicats.
Chaque vie humaine est précieuse, et notre instinct nous pousse à vouloir tout tenter pour prolonger celle des personnes que nous aimons. Pourtant, les traitements médicaux peuvent être douloureux, et certaines interventions destinées à maintenir la vie peuvent, paradoxalement, infliger des souffrances à ceux que nous voulons protéger.
Pour une approche équilibrée des soins médicaux en fin de vie, quatre principes bibliques doivent guider notre réflexion simultanément et en tout temps.
La souveraineté de Dieu
Premièrement, la Bible affirme que Dieu est le seul maître de notre vie.
C’est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses.
Actes 17.25
Et c’est pourquoi lui seul peut donner et ôter la vie aux hommes. Ce principe fondamental est exprimé de manière éclatante dans Deutéronome 32.39, où Dieu déclare:
Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a pas d’autres dieux [avec] moi; c’est moi qui fais mourir et qui fais vivre.
Ainsi, dire que Dieu est souverain, c’est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre vie ni de celle de nos semblables, et que nous n’avons pas le droit d’y mettre fin. C’est d’ailleurs pour cela que l’euthanasie ou le suicide assisté constituent des crimes si affreux: c’est qu’en les pratiquant, on ne fait pas qu’ôter la vie, mais on se place au-dessus de Dieu!
La dignité de l’homme
Le deuxième principe à retenir est que la vie humaine a une valeur inestimable pour Dieu. La Bible interdit de tuer et appelle à protéger la vie humaine, car, créé “à l’image de Dieu”, l’homme occupe une place unique au sein de la Création. Selon Genèse 9.5, c’est précisément pour cette raison que le sang des animaux peut être versé, mais pas celui de l’homme. Dieu dit en effet:
Je réclamerai à chaque homme la vie de l’homme qui est son frère, car Dieu a fait l’homme à son image .
Genèse 9.5 (voir aussi Exode 20.13)
Ce qui est particulièrement important à saisir sur le plan éthique, c’est que la dignité de l’homme ne dépend donc pas de ce qu’il fait, mais de ce qu’il est: il est “image de Dieu”. Autrement dit, la valeur d’une personne ne se mesure ni à sa capacité d’interagir avec d’autres personnes, ni à son autonomie, ni même à sa faculté de raisonner. Non: l’être humain est digne de respect par ce qu’il est, et non par ce qu’il fait. Voilà pourquoi toute existence humaine, aussi fragile ou diminuée soit-elle, doit être protégée, de la conception jusqu’à la mort.
Aussi essentiels soient-ils, ces deux principes – la souveraineté de Dieu et la dignité de l’homme – ne suffisent pas à eux seuls. Pris isolément, ils risquent d’être compris comme une injonction à s’acharner pour maintenir une personne en vie à tout prix. Kathryn Butler, médecin chrétienne ayant travaillé en soins intensifs dans un grand hôpital, explique que c’est précisément ce qui arrive chez certains croyants bien intentionnés:
[Beaucoup de] patients et [leurs] proches interprètent le "caractère sacré de la vie" comme signifiant "tout tenter à tout prix".
Elle souligne que les sondages montrent que les personnes "religieuses" – c’est-à-dire celles qui adhèrent à ces deux principes – ont généralement tendance à demander des soins plus agressifs en fin de vie, même lorsqu’il s’agit d’une maladie en phase terminale. Elle écrit:
D’après mon expérience, une telle entreprise découle souvent d'une conviction bien intentionnée quant au "caractère sacré de la vie" mais appliqué sans discernement.
Elle ajoute que les technologies et les interventions de "soutien aux organes" (comme la réanimation cardiaque ou la respiration artificielle) infligent souvent de grosses souffrances, sans qu’il y ait toujours de réelle perspective de guérison. Elle en conclut:
Une approche aveugle et dogmatique des interventions du maintien de vie menace d'infliger des dommages aux personnes même que nous cherchons à protéger. Prudence, donc, car en nous efforçant de préserver la vie que Dieu a créée, nos efforts ne prolongent pas [toujours] la vie, mais [ne font parfois que prolonger] le douloureux processus de mort1.
C’est pourquoi il ne suffit pas de s’en tenir à ces deux principes: il faut les compléter par deux autres pour penser et agir avec discernement.
La compassion du Christ
Le troisième principe est que nous devons aimer les autres comme Christ nous a aimés (Jn 13.34; 15.12-13; 1Jn 3.16-18). En tant que disciples du Christ, nous avons la responsabilité de montrer la même compassion que lui envers ceux qui souffrent. L’Évangile nous rapporte que, face à des lépreux ou des aveugles souffrant de leur condition, Jésus était “ému de compassion” (Mt 20.34; Mc 1.41). On lit aussi:
Jésus vit une grande foule; il en eut compassion et guérit leurs malades.
Matthieu 14.14
Comme le montre ce texte, la compassion de Jésus le poussait à guérir et, donc, à prolonger la vie des personnes souffrantes. Aujourd’hui encore, prolonger la vie reste un des principaux objectifs de la médecine. Mais soigner ne se limite pas à cela: il s’agit aussi de soulager la souffrance. Ces deux objectifs vont souvent de pair, mais ils peuvent parfois se heurter. Certains traitements destinés à réduire la douleur peuvent, par exemple, raccourcir la vie de certains patients. Il faut donc trouver un équilibre, en évaluant soigneusement ces exigences opposées.
Comme le souligne Kathryn Butler, lorsqu’un patient est en fin de vie, il est légitime de privilégier le soulagement de la souffrance plutôt que le prolongement de la vie. Car dans ce contexte, prolonger la vie ne fait qu’étirer en vain le processus de la mort. Elle écrit:
Quand la détresse et la douleur sont infligées inutilement, nous manquons à notre mandat d’aimer notre prochain, et ce, malgré nos bonnes intentions. La compassion ne justifie pas l’euthanasie ou le suicide assisté. Mais elle nous éloigne certainement des interventions agressives et douloureuses si de telles mesures sont futiles, ou si le supplice qu’elles infligent dépasse le bénéfice escompté2.
L’espérance de la résurrection
Le dernier principe repose sur notre conviction que Christ a vaincu la mort et que, unis à lui par la foi, nous ressusciterons, nous aussi, pour une vie glorieuse et éternelle (Jn 11.25-26; 1Co 15.20-23). L’apôtre Paul l’exprime ainsi:
Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés.
1 Thessaloniciens 4.14
Cette espérance nous aide à accepter notre condition mortelle et à faire face à la mort de nos proches croyants. Dis autrement, elle nous permet de refuser certaines interventions médicales agressives quand il n’y a aucune promesse de guérison. La douleur de voir un proche s’éteindre ou la peur de rester seul pourrait, en effet, nous pousser à lutter contre la mort coûte que coûte. Mais puisque nous savons qu’elle n’est pas la fin et que, par notre foi en Jésus, nous serons réunis à la résurrection, nous n’avons pas besoin de nous acharner contre elle.
En résumé, une approche chrétienne des soins en fin de vie repose sur quatre principes: la souveraineté de Dieu, la dignité humaine, la compassion du Christ et l’espérance de la résurrection. Ensemble, ils nous enseignent à rechercher la guérison en utilisant les moyens médicaux disponibles, mais aussi à accepter la mort lorsqu’elle survient, en privilégiant le soulagement de la souffrance plutôt que le maintien en vie à tout prix. Pour le dire autrement, ces principes bibliques nous invitent à rejeter toute démarche qui vise à mettre fin à la vie, tout en discernant avec sagesse le moment où il est juste de mettre fin à un traitement.
Comme l’explique Kathryn Butler, la question fondamentale est donc la suivante:
Le maintien de la vie dans cette situation constitue-t-il une préservation de la vie, ou un report de la mort et une prolongation de souffrances inutiles?3
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que les mesures de maintien de la vie, notamment en soins intensifs, sont des mesures de soutien, et non des traitements curatifs. Qu’il s’agisse de la respiration artificielle, des sondes d’alimentation, des médicaments pour maintenir la pression artérielle, de la dialyse ou d’autres techniques, aucune de ces interventions ne guérit la maladie: elles permettent seulement de gagner du temps. Leur but est de soutenir les fonctions vitales assez longtemps pour traiter la maladie sous-jacente… mais elles peuvent aussi infliger de grandes souffrances!
Si la maladie est réversible et qu’il existe un espoir de guérison, ces mesures extrêmes (et souvent douloureuses) se justifient. Mais lorsque la maladie est irréversible et qu’aucune guérison n’est possible, ces interventions ne font que retarder la mort, parfois au prix d’une souffrance accrue.
Notre véritable défi consiste donc à discerner le moment où l’on ne préserve plus vraiment la vie, mais où l’on se contente de repousser la mort. Nous devons constamment nous demander: cela relève-t-il encore d’une volonté de guérir, ou d’un acharnement thérapeutique retardant l’inéluctable? Prolonge-t-on réellement la vie, ou ne fait-on que différer une mort certaine en ajoutant de nouvelles souffrances?
Pour cela, nous devons demander à Dieu la sagesse nécessaire afin d’orienter notre réflexion à la lumière des quatre principes évoqués plus haut.