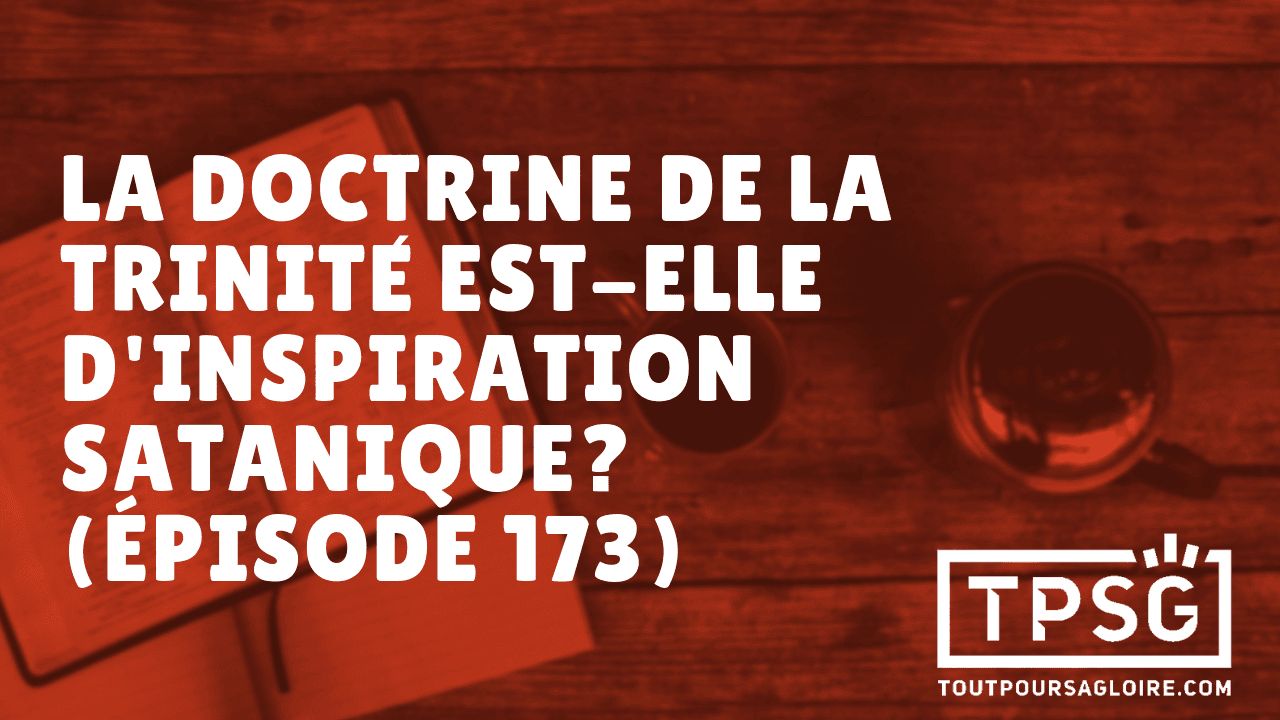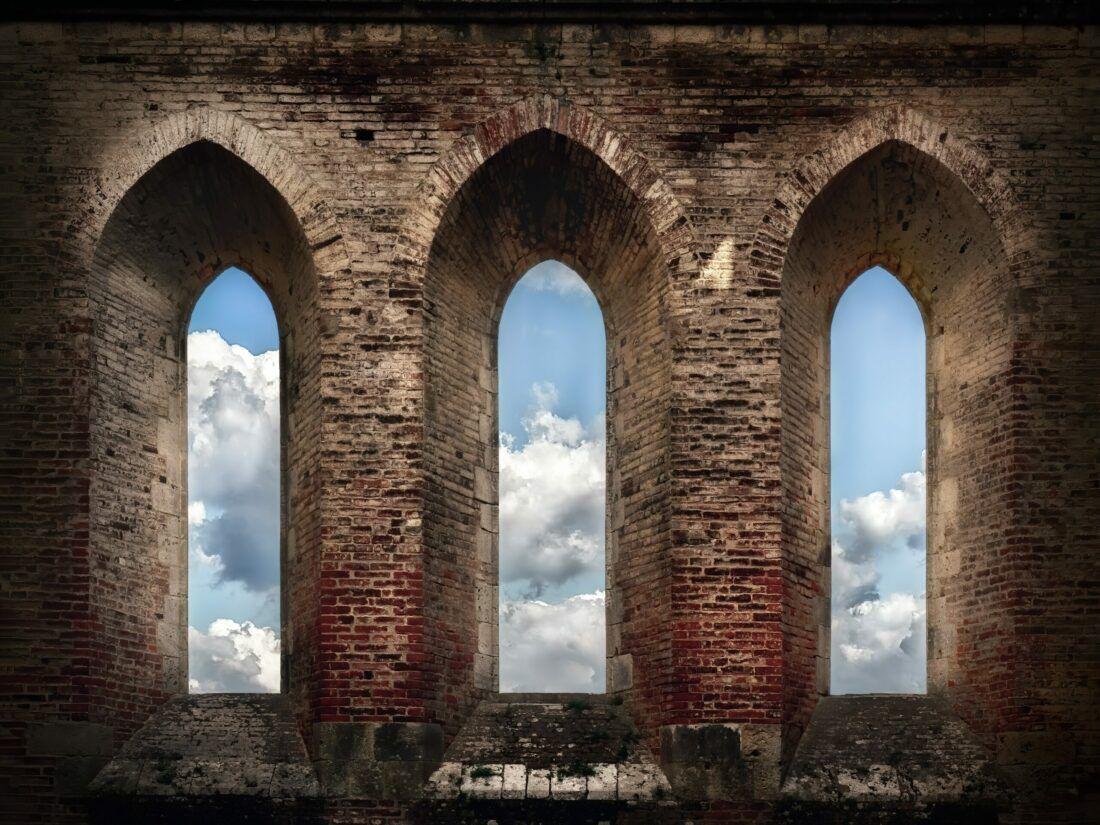Quel est le rapport entre l’éternité et le temps dans la Bible?
Doctrine de DieuUnion hypostatiqueLe temps. Il façonne chacune de nos journées, régit nos agendas, altère nos souvenirs et semble même repousser nos espoirs. Tantôt trop court, tantôt trop long, il nous presse, nous lasse, nous file entre les doigts.
Nos contemporains font de la productivité et de la gestion du temps, mais ne réfléchissent pas à sa nature, à son sens. Il ne serait qu’une mesure neutre qu’il faudrait rentabiliser.
Le temps nous est familier… jusqu’à ce qu’on y pense vraiment. Sitôt que nous tentons de comprendre ce qu’il est, nous vacillons.
Sa nature reste profondément mystérieuse. La physique moderne, notamment la théorie de la relativité, nous montre un temps bien plus souple, étrange et dynamique que nous ne l’imaginons.
La Bible, elle, ne cherche pas à expliquer le temps en termes scientifiques. Elle nous invite à le méditer à partir de son créateur.
Elle révèle un Dieu qui a créé le temps, qui le soutient, qui y entre et qui l’ordonne vers un but glorieux. Méditer sur le temps, loin d’être une spéculation abstraite, devient alors un motif d’adoration. C’est contempler la sagesse, la souveraineté et la bonté de Dieu à l’œuvre dans l’histoire.
Dans cet article, je vous propose de survoler les fondations théologiques de la temporalité: Dieu comme Créateur du temps, l’éternité comme attribut divin, et l’incarnation comme point de jonction entre le céleste et le terrestre. Pour mieux habiter le temps, il faut d’abord le regarder à travers les yeux de Dieu.
Dieu, Créateur du temps
La Bible affirme que rien dans le cosmos n’existe simplement. Tout ce qui est, existe parce que Dieu l’a appelé à l’existence pour sa gloire (Gn 1; Ps 8; Ac 17). La création repose entièrement sur sa providence: il n’y a rien que Dieu n’ait lui-même voulu, façonné et soutenu. Même le temps.
Les récits de Genèse 1-2 montrent comment Dieu structure le monde dans le cadre d’une semaine. Ce cadre littéraire, tout en étant enraciné dans une réalité temporelle, symbolise aussi l’organisation du temps: les luminaires créés au quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles, président aux cycles cosmiques, aux rythmes de la vie, aux saisons. Le temps devient ainsi un instrument mis au service de la vie créée, un cadre à travers lequel Dieu accomplit ses desseins.
Ce temps, dont l’essence reste mystérieuse à nos yeux, rend la vie et l’histoire possibles. Sans lui, pas d’avant, pas d’après, donc pas de commencement, pas de déroulement, pas de narration. Le temps permet l’histoire, et l’histoire révèle la direction du temps.
Le septième jour, Dieu se repose. Ce repos marque l’achèvement, la complétude, la satisfaction et le règne de Dieu. Le sabbat devient un repère créationnel fondamental: il inscrit dans le tissu du temps une orientation vers la communion avec Dieu, l’adoration et le repos.
Ce jour de repos introduit déjà une dimension eschatologique à la création. Elle tend vers un but, un telos: le repos final en Dieu. Le cycle de sept jours devient ainsi le rythme sacré de la création, un rappel de l’alliance entre Dieu et son peuple (Ex 20.8-11; Dt 5.12-15), et une anticipation du repos éternel.
Le Dieu immuable crée et soutient un monde ordonné, cohérent, harmonieux. La création témoigne de sa sagesse, de sa puissance et de son intentionnalité.
Dieu seul est l’Éternel
Henri Blocher, dans son article "Hier, aujourd’hui, éternellement" (Dieu et sa Parole, Excelsis, 2022), s’appuie sur la définition classique de l’éternité, souvent attribuée à Boèce et reprise par Thomas d’Aquin:
La possession simultanée et parfaite d’une vie sans fin.
Dieu est l’Être absolu. Il est celui qui EST (Ex 3.14). Il est l’Éternel, immuable, indépendant, celui qui tient son être de lui-même — ce que la théologie appelle son aséité. Dieu n’est ni soumis au temps ni affecté par le changement.
Il transcende toute sa création, en tant que Créateur distinct et souverain (Gn 1.1; És 40.22), au-dessus d’elle (Ps 115.3; És 46.9-10), et non limité par ses lois ni par ses dimensions (1R 8.27; Jb 38-41; Ps 90.4; cf. 2P 3.6). Il soutient tout le cosmos par sa Parole puissante (Hé 1.3).
Notre monde n’est pas une émanation de Dieu, comme le rayon de lumière qui jaillit du soleil. Dieu ne diffuse pas son être: il agit. Il parle — et une réalité autre que lui surgit. Il pose la création hors de lui, dans une altérité réelle.
Il existe ainsi une différence métaphysique radicale entre Dieu et sa création. Dieu est l’Être absolu, la source de tout ce qui est. La création, elle, est contingente, dépendante, dérivée. Elle existe parce que Dieu l’appelle continuellement à exister, par sa Parole.
Il n’y a aucune zone intermédiaire entre Dieu et le créé. Même le monde spirituel (anges, trônes, puissances invisibles) n’est pas "un peu" divin. Il n’y a pas d’échelle vers Dieu. Tout ce qui n’est pas Dieu est création.
La Bible affirme donc une distinction absolue entre Dieu et sa création, tout en soulignant la dépendance totale de cette dernière. Dieu seul est. Dieu seul est l’Éternel.
Quel est le rapport entre l’éternité et le temps?
La Bible ne nous livre pas une théorie scientifique du temps, mais une révélation théologique de son sens. Elle distingue clairement entre Dieu, éternel et immuable, et sa création, soumise au devenir.
Pour éclairer ce rapport entre éternité et temporalité, Henri Blocher s’appuie avec prudence sur le mystère de la Trinité. De même que l’unité et la pluralité coexistent en Dieu sans contradiction, l’éternité et le temps peuvent être comprises comme des réalités distinctes, mais non opposées.
Ce n’est pas parce que Dieu est éternel qu’il est étranger au temps: c’est justement parce qu’il le transcende qu’il peut le gouverner.
Dieu utilise le temps comme un outil providentiel pour accomplir ses desseins (Ép 1.11; Ec 3.15). Il soutient toute chose par sa Parole (Hé 1.3), y demeure présent et actif sans jamais en dépendre (Ac 17.24-25). C’est la tension féconde entre sa transcendance (il est distinct de sa création) et son immanence (il agit dans sa création).
Certaines actions ponctuelles, comme la crucifixion et la résurrection du Christ, bien qu’éphémères dans leur déroulement, produisent des effets éternels. Elles révèlent comment temps et éternité s’entrelacent dans l’économie du salut. Le temps devient le théâtre où s’accomplissent les décrets éternels et synchroniques. Un texte bien connu nous le présente:
Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi: c’est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Il n’y a pas de différence: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.
C’est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.
Romains 3.21-26
Paul met bien en lien l’action passée unique de Dieu en Christ, l’effet rétroactif couvrant les péchés passés commis au temps de sa patience, et la réalité actuelle et continue de la justification accordée à ceux qui croient après la mort de Christ.
Il y a donc une dépendance ontologique du temps à l’éternité. Le temps trouve son origine, son sens et sa finalité en Dieu. Et si certains aspects de cette relation échappent à notre compréhension, cela ne témoigne pas d’une contradiction interne, mais de notre finitude.
Le Qohélet se confronte à ce mystère: sous le ciel, Dieu donne à l’homme de vivre un temps pour tout (Ec 1-9). L’homme ne peut ni se soustraire à ces temps, ni les contrôler. Dieu est au contrôle des temps:
Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé.
Ecclésiaste 3.15
Cependant:
Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l’éternité, bien qu’ils ne puissent comprendre l’œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin.
Ecclésiaste 3.11
Dieu est-il hors du temps?
Beaucoup imaginent Dieu comme un être "hors du temps", ou présent simultanément dans le passé, le présent et le futur, ou comme s’il se baladait librement sur la frise chronologique. Mais cette représentation ne correspond pas à la théologie biblique.
Henri Blocher critique cette vision d’un Dieu "immobile", observateur de la ligne temporelle. Elle affirme au contraire que l’éternité de Dieu est ce qui rend possible sa souveraineté sur le temps. Dieu n’est pas contraint par la succession des instants, mais les ordonne.
Il détermine l’avenir en gouvernant le présent. Il agit dans le temps sans en être prisonnier.
Ses décrets, éternels et parfaits, s’accomplissent à travers sa providence, selon un ordre qu’il maîtrise (Ép 1.11). Il intègre la succession temporelle dans son dessein éternel.
Les faits historiques ne sont pas des métaphores. L’incarnation, la résurrection, le renouvellement quotidien de ses bontés sont les manifestations réelles d’un Dieu éternel agissant dans nos vies.
Loin d’annuler l’histoire, l’éternité divine lui donne son poids, sa valeur, son orientation. Le Dieu immuable se rend présent dans le changement, sans se transformer. Il agit, il parle, il sauve, dans le temps.
Le temps et l’éternité se rencontrent en Christ
Dieu, en ordonnant la durée des temps (Ac 17.26), établit un cadre temporel dans lequel se déroulent ses plans éternels.
James K. A. Smith, dans How to inhabit time (Brazos Press, 2022), montre que l’incarnation de Jésus-Christ est le point où le temps et l’éternité s’unissent de manière ultime. Toute l’histoire humaine converge vers ce moment:
Mais, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils…
Galates 4.4
Dieu n’entre pas dans le temps comme un visiteur externe à lui: il y vient en chair et en os.
En Christ, deux natures cohabitent sans confusion ni séparation: la nature divine et la nature humaine. Cette union personnelle du Créateur et de la créature, de l’éternel et du temporel, accomplit la grande récapitulation énoncée par Paul:
Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Éphésiens 1.10; cf. Col 1.20
Le temps est créé pour révéler la gloire éternelle de Christ, le Verbe incarné, celui “qui était, qui est et qui vient” (Ap 1.8). Il est l’Alpha et l’Oméga (Ap 22.13), le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui soutient l’univers par sa Parole puissante (Hé 1.1-3).
Le temps se révèle être le lieu du salut. Il ne se dissout pas dans l’éternité: il est transfiguré par elle. En Jésus-Christ, Dieu rend son dessein éternel accessible à des créatures temporelles. Il nous rejoint là où nous sommes, pour nous faire entrer dans ce qui lui appartient: l’éternité.
Si Dieu a créé le temps et y entre pour accomplir ses desseins, alors notre manière de l’habiter ne peut pas rester neutre.
Dans un second article, nous verrons comment la foi et l’espérance chrétiennes transforment notre rapport au temps.
Abonnez-vous à ma newsletter pour ne pas rater mon prochain article!