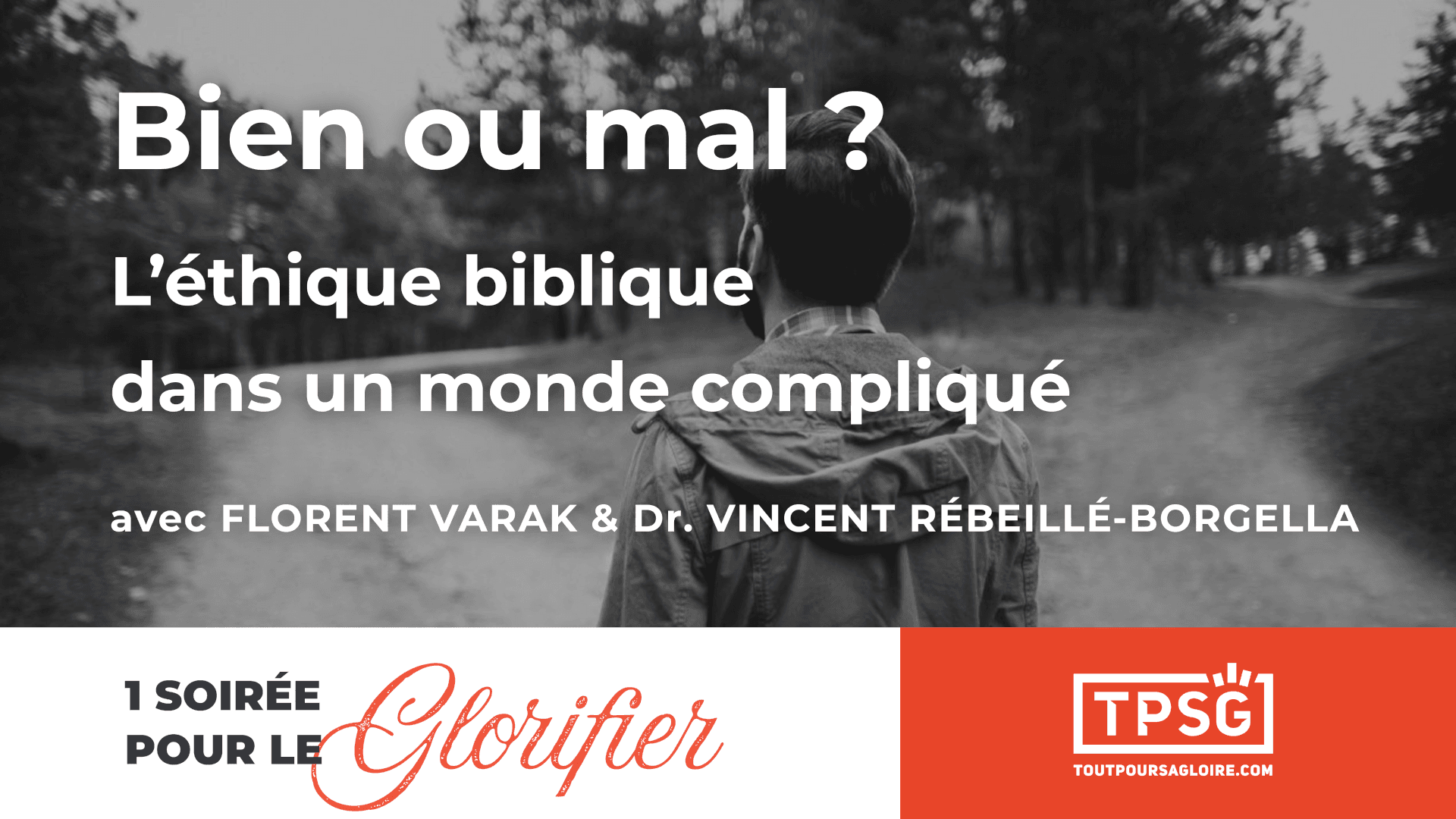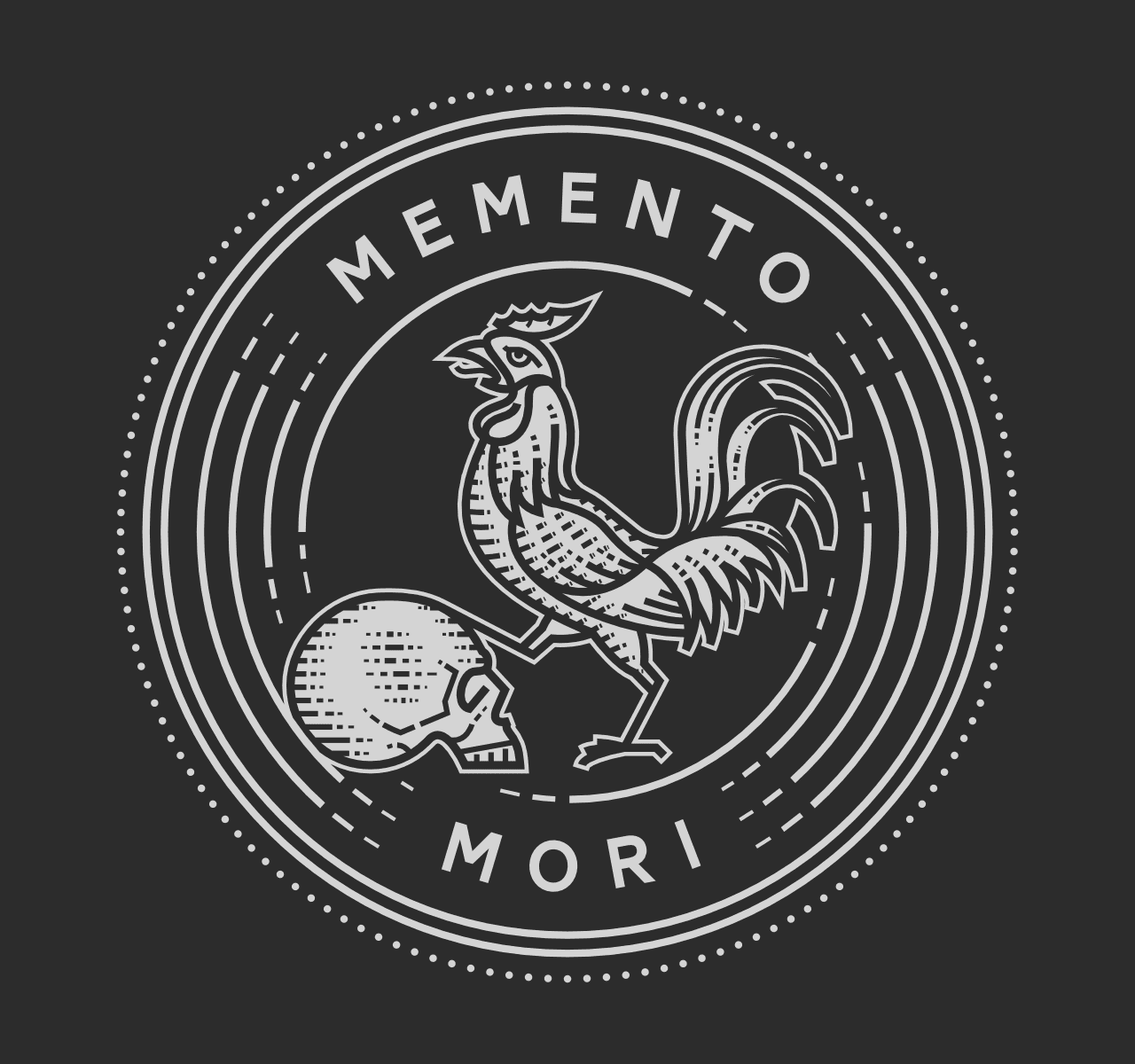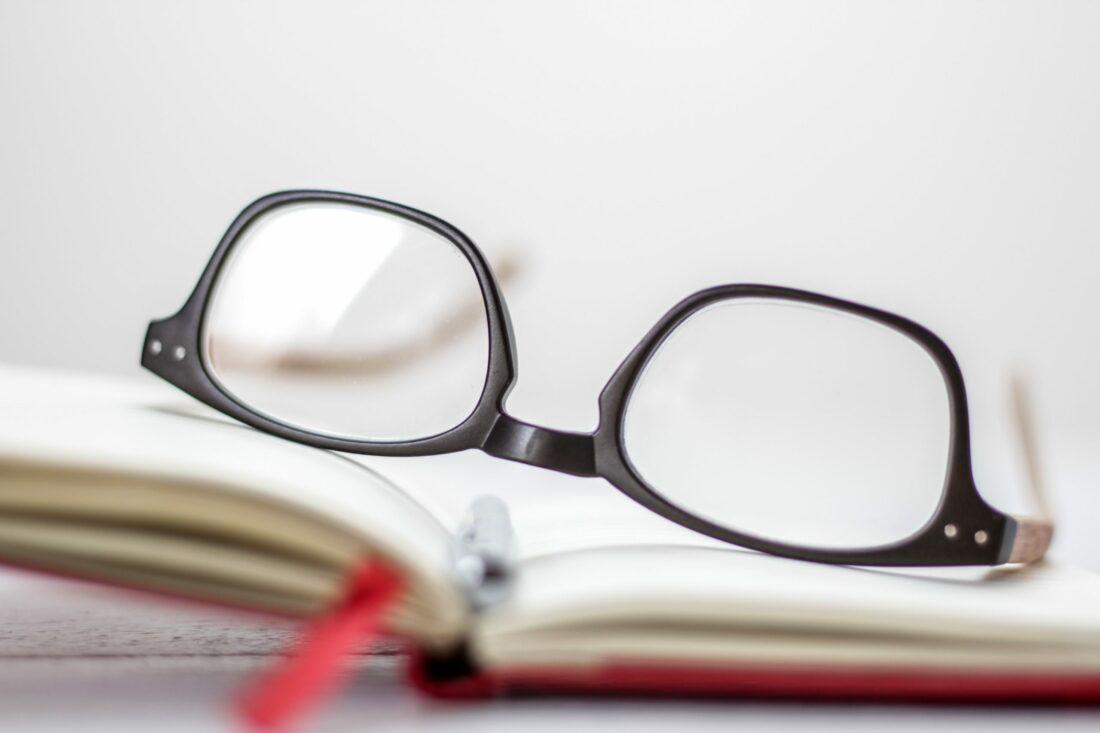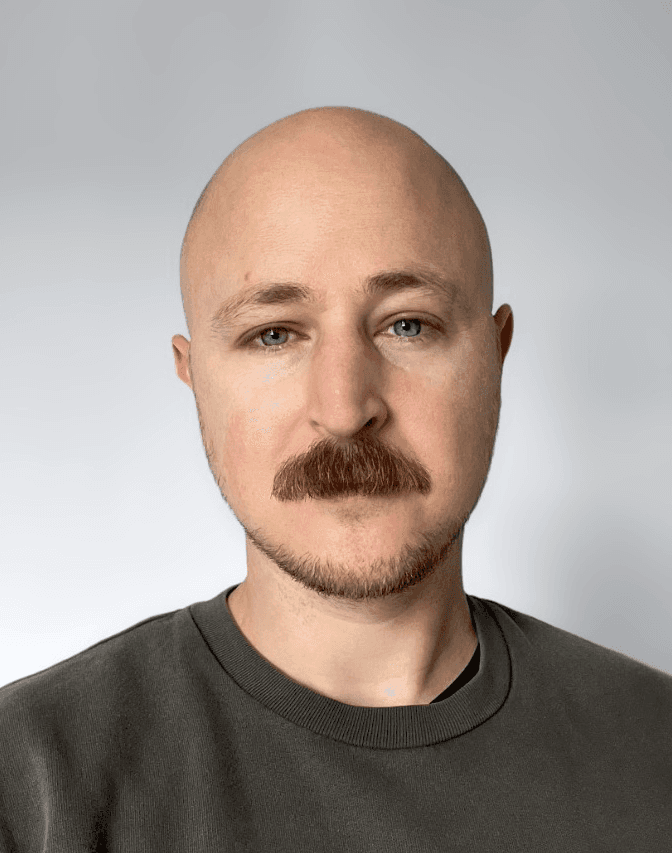Outils et sagesse chrétienne : quatre balises pour habiter un monde technologique
Mandat culturelTechnologie et médiasVision du monde chrétienneEn novembre 2022, le grand public a découvert les LLM avec ChatGPT. En quelques mois, la génération d’images et de vidéos a progressé sans relâche. Après l’essor des réseaux sociaux dans les années 2010, l’IA constitue sans doute le bouleversement techno-culturel le plus marquant de notre époque. Cet article n’est ni un guide technique ni une alarme. Il propose quatre balises bibliques et pratiques pour discerner et exercer la sagesse face aux outils qui amplifient nos aspirations, bénissent un monde déchu, tentent nos cœurs et forment notre caractère.
Définir culture, technologie et outil
Notre réflexion sur la technologie doit s’inscrire dans notre compréhension de la culture.
Lorsque l’on évoque la culture, on pense souvent aux toiles des grands maîtres ou aux symphonies de compositeurs tels que Bach ou Mozart. Pourtant, la culture est, en réalité, la transformation de la nature par l’être humain. Autrement dit, la culture est ce qui résulte lorsque l’homme transforme la nature.
Par technologie, j’entends l’ensemble des moyens par lesquels nous concevons et utilisons des outils pour accomplir cette vocation. Dans son livre From the Garden to the City, John Dyer définit la technologie comme “l’activité humaine qui emploie des outils pour transformer la création de Dieu à des fins pratiques1”. Un outil est l’instrument concret qui médie notre action sur le monde.
Dans la Bible, la première forme de culture, c’est l’agri-culture : l’homme travaille la terre pour qu’elle produise du fruit. Couper une branche et la transformer en bâton de marche, c’est un acte culturel. Faire un café, c’est un acte culturel. Ou plutôt une succession d’actes culturels : il faut le faire pousser, le récolter, le transporter, le torréfier, le moudre, etc.
La technologie, c’est ce qui nous permet de construire les outils qui vont nous permettre de transformer la nature. L’agriculture est un acte culturel, mais elle nécessite des outils pour cultiver la terre, la retourner, etc.
Dans cet article, j’aimerais montrer que chaque outil est :
- Une amplification de nos aspirations
- Une bénédiction dans un monde déchu
- Une tentation pour nos cœurs tordus
- Une formation de notre caractère et de notre comportement
Nos outils amplifient nos aspirations
Dans le même ouvrage, John Dyer explique :
À travers nos outils, nous imaginons le monde tel qu’il pourrait être. (p. 39)
Un outil technologique fait office de pont entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’il pourrait être.
Dans cette perspective, chaque outil est eschatologique : il reflète nos aspirations. Il constitue un jalon vers le monde idéal que nous souhaitons voir advenir. Chaque outil s’ajoute à la boîte à outils qui nous permet de façonner ce monde idéal.
Parce qu’elle s’inscrit dans la vocation culturelle de l’homme, la technologie porte un discours. De la culture, le théologien Ken Myers dit :
Culture is what we make of the world2.
L’auteur introduit un double sens : la culture est ce que nous faisons (make) du monde, au sens de la transformation. Mais l’expression “what we make of the world” peut aussi signifier “le sens que nous donnons au monde”.
La culture est donc une activité de construction du sens. Autrement dit, la culture conjugue transformation et compréhension. Elle nous aide à comprendre en même temps que nous formons, et inversement.
Tout produit culturel est une déclaration : il construit un discours, explicite ou implicite, intentionnel ou non. Chaque outil technologique dit quelque chose du monde idéal auquel nous aspirons. Ainsi, chaque outil révèle notre vision du monde.
Questions de diagnostic :
- À quelle aspiration cet outil vient-il répondre ? Quel désir profond cet outil amplifie-t-il ?
- Que dit cet outil à propos du monde tel qu’il est : quel est le manque qu’il prétend combler ? Quel est le diagnostic implicite porté sur la réalité présente ?
- Que dit cet outil à propos du monde idéal : quelles possibilités nouvelles cet outil vient-il créer ? Quel monde idéal dessine-t-il ?
Nos outils sont une bénédiction dans un monde déchu
La culture relève d’une vocation créationnelle : Dieu confie à l’homme de poursuivre son œuvre d’ordonner et de remplir la création dès l’origine (Gn 1.26-28). Ainsi, le développement de la culture et de la technologie n’est pas une conséquence de la chute, mais une dimension constitutive de l’activité humaine voulue par Dieu.
Après la chute, les outils technologiques reçoivent, par la grâce commune, une dimension rédemptrice. Ils contribuent à redresser ce que le péché a courbé. Bien sûr, ils ne peuvent pas remettre parfaitement droit ce que le péché a tordu. C’est la fausse prétention d’une vision du monde qui ferait de la technologie la solution au problème du péché. Néanmoins, Dieu se sert de la technologie pour restreindre les effets du péché dans le monde. Au-delà de ses arômes délicieux, un bon café vient aussi infléchir les effets de la fatigue en vertu de la caféine qu’il contient.
On pense spontanément à la médecine en général. Dieu utilise les médicaments et les traitements pour nous guérir. Les lunettes corrigent une vue défaillante, des implants remplacent une dent manquante, une prothèse pallie une articulation abîmée, etc.
Mais une limite s’impose : la technologie ne nous permet jamais d’échapper à la vanité de ce monde. Aucun de nos outils ne peut vraiment nous délivrer de la vanité. Pourquoi ? Parce qu’aucun de nos outils ne peut ôter le péché. On peut en atténuer les effets, mais on ne peut pas l’éradiquer.
Non seulement nos outils ne peuvent pas éradiquer le péché dans le monde, mais aucun d’eux ne peut vraiment étancher notre soif. Tous reflètent nos aspirations les plus profondes, mais aucun n’a le pouvoir d’y répondre. Seul Dieu peut répondre à nos aspirations.
Déjà en 1908, le théologien Herman Bavinck disait :
Bien que de nombreux résultats brillants aient été obtenus dans le domaine des sciences naturelles, de la culture et de la technologie, le cœur humain est resté insatisfait3.
Questions de diagnostic :
- Quelles courbures dues au péché cet outil entend-il redresser ?
- Que dit cet outil du monde tel qu’il ne devrait pas être ? Quel “problème” empêche l’homme d’être vraiment heureux ? Quelle est l’espérance proposée ?
- Quelles limites cet outil ne pourra-t-il jamais franchir (et quels effets risque-t-il d’aggraver) ?
Nos outils deviennent une tentation pour nos cœurs tordus
Parce que la technologie exprime l’aspiration de notre cœur, elle manifeste aussi nos aspirations pécheresses. De plus, elle devient un piège pour nos cœurs idolâtres. Prenons les choses l’une après l’autre.
Un cœur idolâtre engendre des outils idolâtres. Par la grâce commune de Dieu, l’homme demeure capable de bien et ce qu’il veut, bien que marqué par le péché, n’est pas entièrement mauvais. Ainsi, la plupart de nos outils ne sont pas totalement mauvais. Mais ne nous leurrons pas : chaque outil reflète notre cœur et notre vision du monde.
Ainsi, une vision du monde humaniste tendra à produire des outils qui placent l’homme et sa gloire au centre. Dans sa déclinaison technologique, cela engendrera une technologie cherchant à s’affranchir des effets du péché sans Dieu. Plus encore, on cherchera à repousser les limites humaines. Dans cette vision du monde, celle des transhumanistes par exemple, la mort est l’ennemi à abattre par la technologie, tout comme les limites de l’être humain en tant que créature. C’est au rang de Dieu que l’homme ambitionne de se hisser. Rien de nouveau sous le soleil.
Une vision du monde capitaliste fera du gain l’objectif suprême. Les finalités de la technologie, même louables en elles-mêmes, seront subordonnées à la capacité de générer des profits pour ceux qui y investissent. Cela signifie qu’il ne faut pas seulement interroger l’outil lui-même, ni les intentions de ses concepteurs, mais aussi l’économie dans laquelle ils s’inscrivent. L’objectif second peut être louable, mais l’objectif premier est souvent mauvais.
Deuxième problème : nous nous rendons compte que nos outils deviennent un piège pour notre cœur. Non seulement ils révèlent des aspirations mauvaises, mais ils viennent aussi les nourrir. Par exemple, les réseaux sociaux dévoilent notre peur des hommes, notre désir de trouver chez les autres des raisons d’exister, d’être heureux, rassurés et valorisés. Mais les réseaux sociaux alimentent également cette peur des hommes. Plus je fréquente les réseaux sociaux, plus ils me façonnent.
Nos outils sont ce que nous concevons pour façonner le monde, mais ils finissent toujours, inexorablement, par nous façonner.
Questions de diagnostic :
- Quelle idole risque-t-il d’alimenter (affirmation de soi, contrôle, confort, approbation, pouvoir, plaisir, savoir) ?
- Puis-je y renoncer sans détresse ? Si non, qu’est-ce que cela révèle de mon cœur ?
Nos outils transforment notre comportement et notre caractère
Nous façonnons le monde avec nos outils, mais en les utilisant, ces outils nous façonnent à leur tour. Au-delà de leur action sur notre environnement, chaque outil exerce une influence qui nous transforme.
John Dyer prend l’exemple de la pelle. Avec une pelle, je peux creuser des trous et modifier le monde. Mais la pelle me transforme aussi : si je l’utilise longtemps, mes muscles vont se développer, mon dos tirera probablement, et je finirai par avoir des ampoules aux mains. Comme la pelle est conçue pour un usage en extérieur, l’environnement dans lequel je m’en sers contribue également à me façonner : la pluie, le soleil, les moustiques, etc.
En 1882, la vue de Friedrich Nietzsche décline. Il n’arrive plus à fixer longtemps son attention sur une page : l’effort est trop grand et la douleur trop vive. Il est sur le point de renoncer à écrire. Il se procure alors une machine à écrire, une “Malling-Hansen Writing Ball”, celle que l’on voit à l’écran. Il apprend à taper à la machine, ce qui lui permet d’écrire sans regarder la feuille. Les mots peuvent de nouveau couler librement de son esprit jusqu’à la page.
Cependant, l’instrument exerce sur son travail une influence plus subtile. L’un de ses amis, compositeur, relève une évolution de son style. Sa prose, déjà dense, devient encore plus concise, plus télégraphique. Il lui écrit : “Peut-être que, grâce à ce nouvel instrument, tu vas même obtenir un nouveau langage”, ajoutant que, pour sa part, ses “pensées sur la musique et le langage dépendaient souvent de la qualité de son stylo et du papier”.
Nietzsche lui répond : “Tu as raison, nos outils d’écriture participent à l’éclosion de nos pensées.” Un spécialiste allemand des médias observe lui aussi que, depuis qu’il utilise la machine, “l’écriture de Nietzsche est passée des arguments aux aphorismes, des pensées aux jeux de mots, de la rhétorique au style télégraphique4”.
En somme, le changement d’outil a entraîné un changement dans sa manière d’écrire. Pourquoi ? Parce que sa manière de penser s’est transformée elle aussi.
Nos outils influencent notre comportement et façonnent notre caractère.
Questions de diagnostic :
- Que fait cet outil à mon attention (concentration, distraction, profondeur) ? Quel est son impact sur l’attention, porte d’entrée de la formation du caractère ?
- Quel rythme impose-t-il à mon temps (vitesse, urgence, fragmentation) ? Il nous faut examiner le rythme qu’il impose, car il façonne les habitudes et la maturité spirituelle.
- Quels fruits de l’Esprit vois-je croître grâce à cet usage ? S’ils manquent, que dois-je ajuster ?
Conclusion
Au bout du compte, la technologie est un don à recevoir, non un dieu à servir ni un sauveur à attendre. Elle amplifie nos désirs, soulage un peu la chute, éprouve nos cœurs et forme nos habitudes. Accueillons-la avec gratitude, fixons des limites, cherchons la redevabilité de l’Église et jugeons nos usages aux fruits de l’Esprit. Que nos outils restent des moyens ordonnés à l’amour de Dieu et du prochain. Notre espérance demeure en Jésus-Christ, non dans nos machines.
Ressources similaires
webinaire
Bien ou mal? L’éthique biblique dans un monde compliqué
Découvre le replay du webinaire du Dr. Vincent Rébeillé-Borgella et de Florent Varak enregistré le 27 janvier 2017.


Orateurs
F. Varak et V. Rébeillé-Borgella