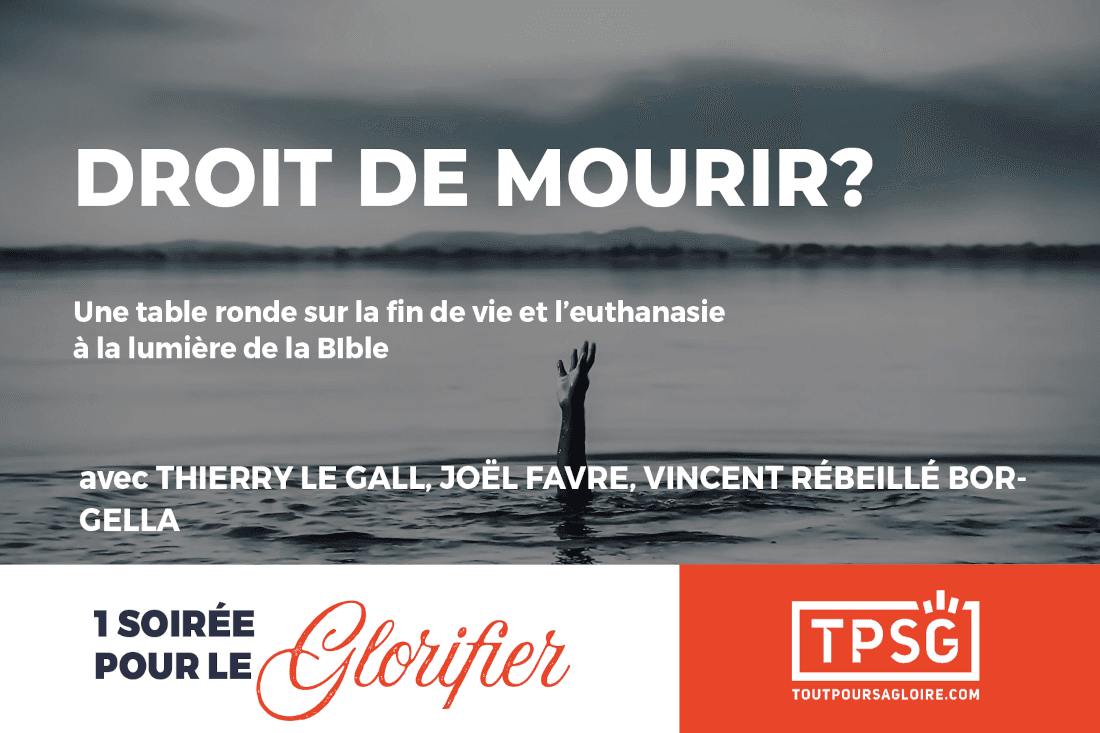Fin de vie: tenir compte du besoin spirituel est indispensable pour bien mourir
Mort/État intermédiaireFin de vie et euthanasieLa France est un pays qui a du mal à aborder la question des fins de vie. Paradoxe, puisque la certitude que l’on va mourir un jour est la seule qui soit commune à tous les humains de tout lieu et de tout temps. Cela témoigne d’une incapacité à accepter notre finitude qui signe sans ambages la fin de la toute-puissance humaine. Ce qui se passe au moment de mourir et après la mort reste un mystère.
Pour certains, la volonté, voire le désir de maîtriser sa mort, consiste à maîtriser le moment de mourir et en aucun cas son déroulement, ni ce qui suit.
Quelque part, les expériences de morts imminentes peuvent apaiser, quand elles sont positives. Mais toutes ne le sont pas forcément, et ces cas-là sont beaucoup moins médiatisés. Un environnement effrayant et le feu de l’enfer remplacent le long couloir angélique et sa lumière blanche apaisante. C’est moins vendeur.
Cette difficulté à aborder les fins de vie est responsable de ce qu’on appelle, en France, le "mal mourir". Pour la majorité des infirmières hospitalières, les fins de vies ne se passent pas dans des conditions acceptables. Les causes sont multiples. L’une des plus importantes, est que dans le pays de Descartes, on centre le soin essentiellement sur le corps, comme si l’être humain n’était qu’un assemblage de différents organes, et que soigner chacun d’entre eux, éventuellement en coordination, suffisait. Cela explique probablement le retard du développement des soins palliatifs de notre pays, car en 2023, plus de vingt départements ne disposent pas d’une unité d’hospitalisation de soins palliatifs. Or, la démarche de soins palliatifs est une prise en charge globale de l’individu.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé en 1946 comme “un état de bien-être complet physique, mental et social ne consistant pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité”.
Les promoteurs anglais des soins palliatifs ont constaté que les personnes confrontées à la fin de leur vie ont souvent une souffrance dont il est possible de décrire quatre dimensions: la souffrance physique, psychique, socio-relationnelle et spirituelle.
Suite à ces travaux, l’OMS a complété la définition de la santé par la Charte de Bangkok en 2005, ajoutant ainsi une quatrième dimension à la définition de la santé:
L’Organisation des Nations Unies reconnaît:
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain sans discrimination. La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme essentiel et offre un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de la vie, qui recouvre également le bien-être mental et spirituel.
Dans notre pays qui se veut laïc, parfois à l’excès, sans doute faut-il préciser la différence entre le religieux et le spirituel. La religion est un ensemble de croyances et de rites qui prétendent amener une personne à une juste relation avec un ou plusieurs dieux. La spiritualité, quant à elle, met l’accent sur les choses et le monde de l’esprit, en opposition ou en complément des choses physiques ou terrestres. Elle repose sur une quête de sens, de valeurs fondamentales et d’identité profonde dans un système de croyances. La spiritualité s’apparente également à une recherche de transcendance dans une quête de réponses à propos de ce qui est infini. En somme, la spiritualité est un besoin universel et fondamental de la condition humaine, dont le sentiment miraculeux d’appartenir au monde est probablement l’un des fondements. La religion est une façon de répondre à cette quête.
Dans ma pratique professionnelle, il a été exceptionnel que les personnes à qui j’ai annoncé, avec un maximum de prudence et d’attention, l’absence de thérapeutique ou leur mort prochaine, n’aient pas, après un certain temps, posé les questions du pourquoi et du sens de la vie et de la mort. “Pourquoi vais-je mourir? Pourquoi moi, maintenant? C’est quoi mourir? Qu’ai-je fait de ma vie? Qu’est-ce que la vie? Que se passe-t-il après la mort?” Ces questions, ceux qui accompagnent les mourants peuvent y être confrontés.
Encore faut-il être disposé à les entendre ou même les autoriser. Cela nécessite de passer du temps avec la personne, et parfois de rester dans le silence, pour lui permettre d’intérioriser cette nouvelle réalité à son rythme, de mettre des mots aux questionnements qui surgissent, et de pouvoir ensuite en parler à un interlocuteur qui soit capable d’entendre et d’écouter. Ne pas laisser à la personne en fin de vie la possibilité de s’exprimer au sujet de ses questionnements métaphysiques ou spirituels, ne pas lui trouver un interlocuteur capable de l’accompagner dans ses réflexions, n’est-ce pas là une négligence de ses besoins spirituels et une participation à la souffrance déjà évoquée?
Ces besoins ont pu être détaillés:
- Être et rester sujet. C’est-à-dire, ne pas être réduit à une pathologie ou un numéro de chambre.
- Conserver ou consolider un réseau de solidarité. La mort de l’individu commence souvent par être une mort sociale.
- S’exprimer au sujet du sens de sa vie.
- Se confronter à la question de l’après mort et d’un au-delà.
Ces besoins sont communs à tous les hommes. J’ai même connu des patients en bonne santé qui voulaient maîtriser le moment de leur mort par un geste de suicide assisté ou d’euthanasie. Arrivés au terme de leur vie, ils se sont posé les mêmes questions et certains se sont tournés vers un ministre de la religion.
Cette absence de prise en compte des besoins spirituels, associée à une prise en charge insuffisante de la souffrance corporelle, psychique et sociale, aboutit à un tableau de souffrance totale. Mais si on prend en compte ces trois types de souffrances, sans tenir compte de la souffrance spirituelle, la personne sera encore en souffrance.
Une mauvaise prise en charge de la souffrance spirituelle participe grandement à ce “mal mourir” que nous avons déjà évoqué. On a fait de gros progrès dans la prise en charge de la souffrance physique, et aussi psychologique, mais celle-ci nécessite probablement des améliorations, en termes de ressources humaines.
La souffrance sociale est plus difficile à prendre en compte, car elle ne dépend pas des soignants, mais de l'entourage. En effet, chacun s'inscrit dans un réseau social qui permet la reconnaissance et l’existence. Souvent, lorsqu’une personne est gravement malade ou en fin de vie, il est généralement plus difficile pour la famille, les voisins, et les collègues d’aller à sa rencontre, de peur de ne pas savoir quoi dire, et sans doute aussi par peur d’être directement confronté à sa propre mort.
La prise en compte de la souffrance spirituelle nécessite deux éléments.
Le premier est la formation à la prise en charge globale de la personne et de sa souffrance, qui est largement insuffisante en France, car nous avons vu que les soins sont essentiellement tournés vers la prise en charge du corps. Apprendre aux soignants à permettre l’expression de la souffrance spirituelle, éventuellement par des questions adaptées, puis savoir quelles ressources mobiliser pour chacune des personnes, devrait être de la compétence de tous les soignants français.
Le deuxième élément est la ressource en personnes susceptibles d’aider celui ou celle qui va mourir à trouver des réponses à son questionnement spirituel. Il est donc nécessaire, pour que soit réellement prise en compte la souffrance spirituelle, d’augmenter le nombre d’aumôniers dans les établissements de santé, qui assureront ce soin spirituel.
Un obstacle à la reconnaissance et à la prise en charge des soins spirituels est la difficulté à accepter cette dimension de l’être humain, aussi bien chez les décideurs que chez les soignants. Un soignant qui a lui-même peur de la mort a forcément plus de difficultés à aborder la question avec le patient. Comme on l’a vu, il est impossible de ne pas s’impliquer personnellement lorsque l’on est soi-même confronté à la question. C’est pourquoi, la généralisation de la culture palliative, avec la reconnaissance de dimension spirituelle, et la reconnaissance par la société du besoin de soins spirituels par des professionnels, sont des éléments essentiels pour une prise en charge satisfaisante des patients en fin de vie.
La réponse à ce qui se passe après la mort, se heurte à la foi des soignants. Les soignants chrétiens, qu’ils soient tournés vers le somatique ou vers le spirituel, sont mieux armés. Nous savons que Jésus de Nazareth, le Messie, le fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés, et que nous n’avons plus à redouter le jugement final. Nous savons qu'il a vaincu la mort, puisqu’il est ressuscité, et qu’il nous a donné accès, par sa mort et sa résurrection, à la vie éternelle auprès de Dieu. Notre Seigneur a vaincu la mort pour nous. Il nous invite à ne pas avoir peur et à être en paix face à la mort. Certes, nous ne savons pas ce qui se passe au moment où notre âme et notre esprit quittent notre corps, mais nous devons nous confier dans sa présence à ce moment-là. Cette tranquillité permet d’accompagner les gens en fin de vie, puisqu’il n’est jamais trop tard pour annoncer l’Évangile. Je l’ai fait même à des personnes dans un coma ou semi-coma, ne sachant pas ce qu’elles en percevaient, en les confiant à Dieu dans la prière.
Le mal mourir dans notre société est dû à l’absence de prise en compte de la souffrance globale ou totale de la personne, et en particulier des besoins spirituels. La légalisation de l’euthanasie et de suicide assisté semble être, pour certains, la meilleure réponse à ce mal mourir.
Lorsque l’on anticipe la fin de vie par un geste actif, cela revient à vivre une vie inaccomplie dans laquelle les besoins spirituels ne seront pas totalement exprimés, car la situation n’est pas tout à fait la même lorsque la mort n’est pas donnée. Cela n’est pas sans impact sur l’entourage. La mort de mon prochain me concerne aussi.
Respecter le rythme naturel de la mort permet aussi de défaire des nœuds qui pèsent sur le vécu spirituel. J’ai vu, aux derniers instants de la vie, des réconciliations qui ont pu avoir lieu parce que chacun des partis concernés savaient que la fin était proche. Cette possibilité relationnelle de renouer des liens abîmés ou disparus, nécessite un temps spécifique à chaque situation.
Il n’est pas certain, en cas de mort provoquée, que le temps se déroule de la même façon. La volonté de maîtriser la vie jusqu’à la mort ne risque-t-elle pas d’enlever la spontanéité d’un processus normal, et donc quelque part sa vérité?
Lorsque l’on voit comment dérivent les pratiques dans les pays qui ont légalisé euthanasie et suicide assisté, il est à craindre que cela apparaisse dans les pays qui feraient le même choix. Nous serions dans une utilisation fonctionnelle qui pourrait devenir utilitariste, et non plus un désir de maîtriser la vie, avec une amputation de cette dernière période de la vie et ses conséquences quant à la question du sens de la vie, qui ne concerne pas seulement la personne qui va mourir, mais qui aura aussi impact direct sur les proches.
Le mot "euthanasie" veut dire étymologiquement: bien mourir. Chacun veut bien mourir. Personne ne veut mal mourir. Pour relever ce défi, il faut que la société comprenne l’importance des besoins spirituels en fin de vie, de leur réalité et de leur prise en charge. Notre expérience nous fait dire que c’est dans cette reconnaissance et la prise en charge des besoins spirituels que le bien mourir est possible. Quand la société se donnera les besoins matériels et humains d’accès pour tous à des soins palliatifs à domicile et à l’hôpital et donnera une culture palliative à l’ensemble des soignants, nous sommes persuadés que la question de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté se posera plus.
Pour aller plus loin
- Découvrez le replay de notre webinaire "Droit de mourir? Une table ronde sur la fin de vie et l'euthanasie" avec Thierry Le Gall, Vincent Rébeillé-Borgella, Joël Favre.
- Découvrez le livre Un médecin face à la peur de la mort, de Vincent Rébeillé-Borgella