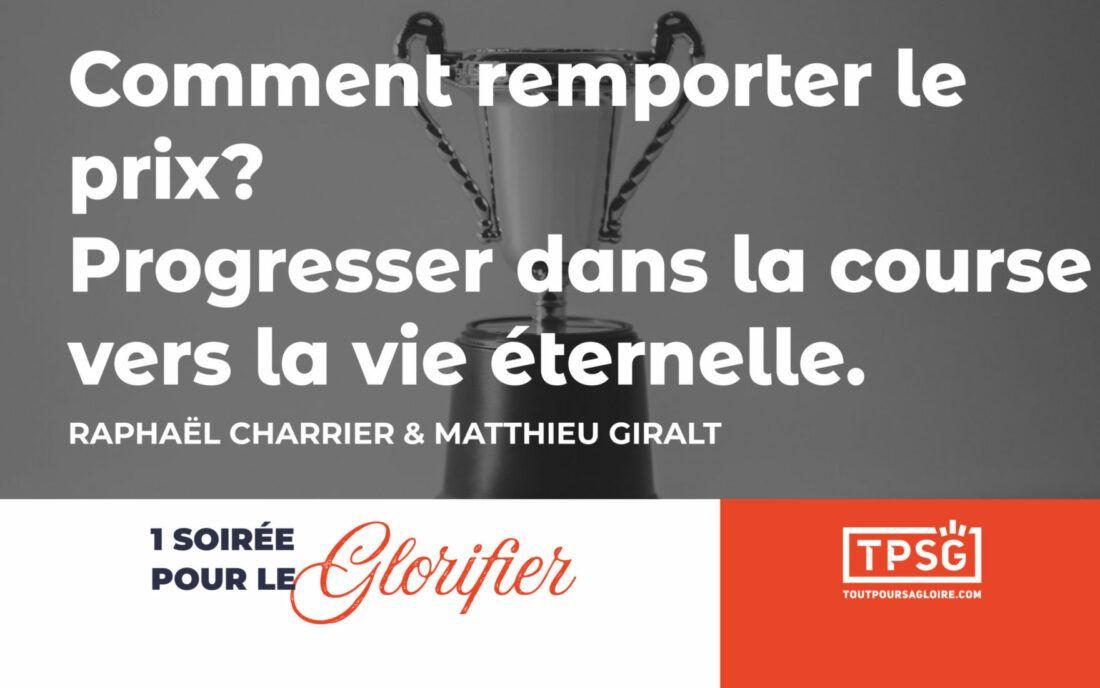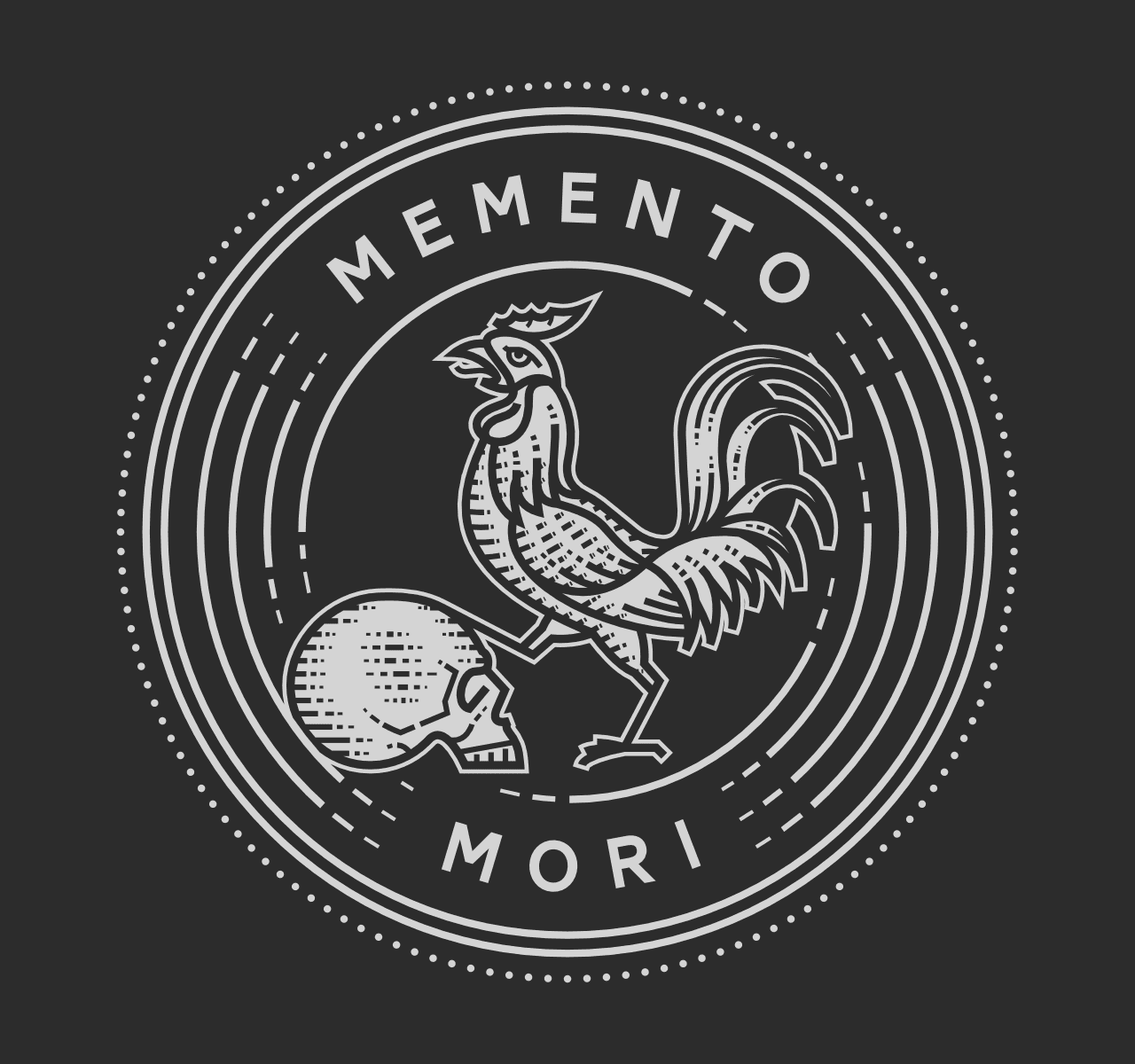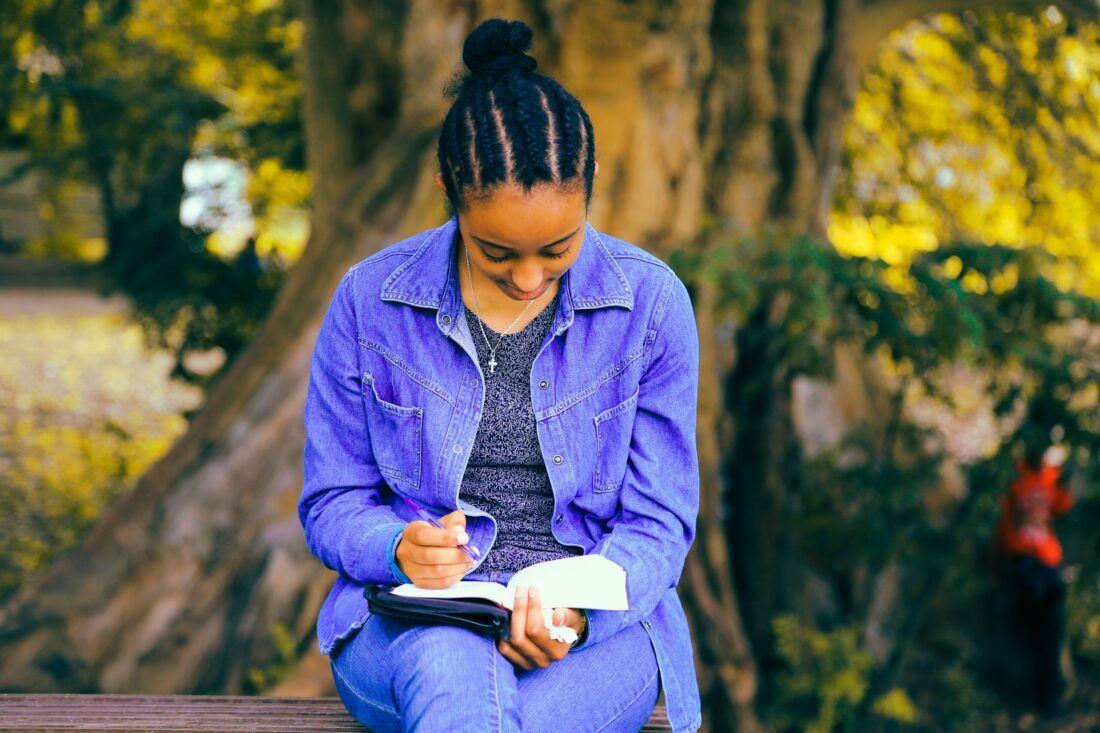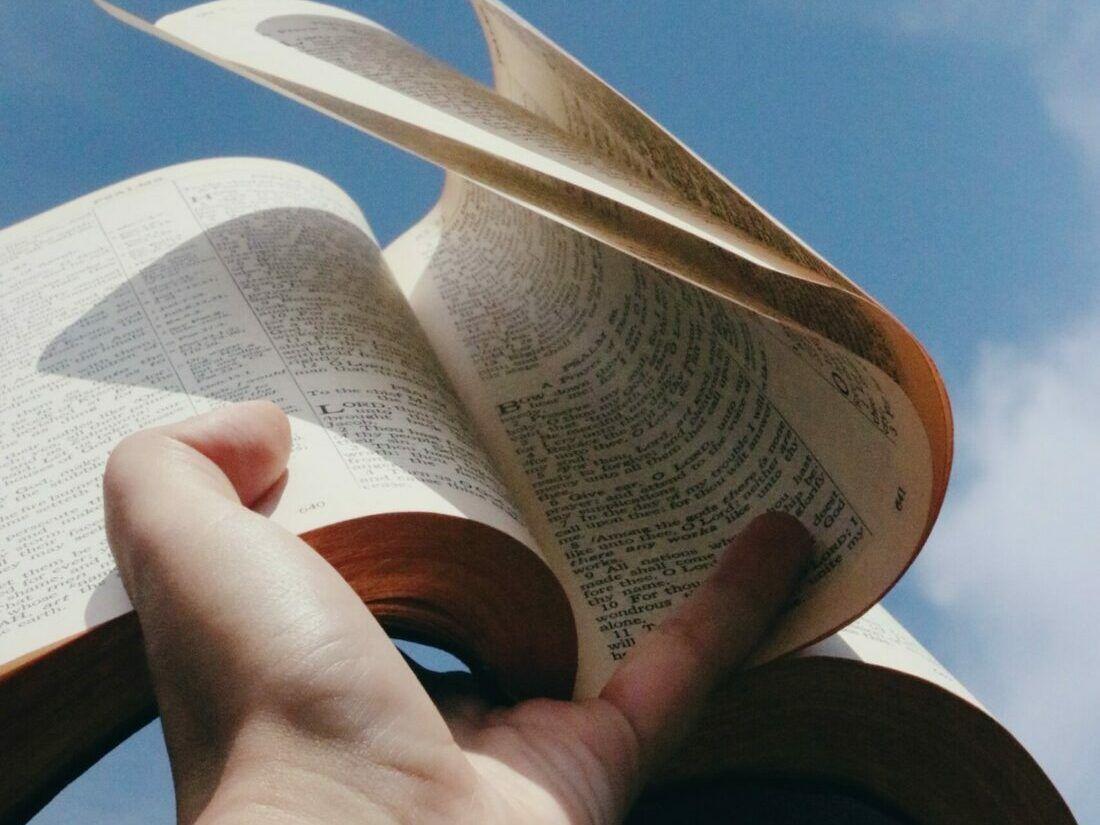L'Esprit saint et les dons spirituels
Le Saint-EspritDoctrine du SalutVie chrétienneLe christianisme est marqué par la présence pérenne et qualifiante de l'Esprit saint dans la vie des disciples. Sans l'Esprit, il n'y a pas de vie en Christ, pas de salut, pas d'Église, pas de service conséquent. Les théologiens parlent de l'Esprit saint comme de "l'applicateur" des bénéfices de Christ, de l'œuvre de Christ dans ses enfants. Sa présence et son influence sont fondamentales et essentielles pour devenir chrétien et vivre en tant que tel.
Paul demande à des hommes religieux, disciples de Jean-Baptiste: “Avez-vous reçu l'Esprit saint quand vous avez cru?” (Ac 19.2). Cette question prouve à quel point la présence de l'Esprit est le marqueur d'une foi chrétienne authentique. Sa venue, maintes fois annoncée dans l'Ancien Testament comme dans les évangiles, s'accomplit à la Pentecôte, événement fondateur historique de l'Église, ouvrant la voie au salut et au service du Seigneur1.
Il est naturel, dès lors, de se demander:
- à quel moment l'Esprit entre-t-il chez le croyant?
- existe-t-il des étapes ou des niveaux de réception de l'Esprit?
- comment savoir si l'Esprit saint habite en une personne?
- faut-il exiger un don de l'Esprit pour être convaincu de sa présence?
- enfin, existe-t-il un lien entre le baptême de l'Esprit et le baptême d'eau? L’imposition des mains joue-t-elle un rôle direct et systématique ou est-elle symbolique et exceptionnelle?
Les réponses à ces questions sont variées et définissent les contours de diverses dénominations.
Nous abordons en cela la première différence significative avec la mouvance charismatique (dans son expression majoritaire) dont la conviction est illustrée par diverses confessions de foi (je les cite dans le livre).
Ces unions d'Églises membres du CNEF voient dans la régénération et le baptême de l'Esprit deux expériences distinctes.
La seconde est perçue comme une promesse postérieure à la conversion marquée par des signes, notamment le parler en langues. Il y aurait deux catégories de sauvés: ceux qui ne sont "que" justifiés et ceux qui seraient justifiés "et" baptisés de l'Esprit. C'est une distinction radicale, ontologique qui touche la nature même de l'Église. Cette affirmation a des implications théologiques massives, car elle admet deux catégories qualitativement distinctes au sein des sauvés: les justifiés et les justifiés-baptisés-de-l'Esprit.
S'il y a certes des degrés différents de maturité chez les enfants du Seigneur, pouvons-nous les différencier aussi radicalement? Cela semble surprenant au regard de la plénitude de l'œuvre de Christ chez celui qui croit: "vous avez tout pleinement en lui [Christ]", défend l'apôtre Paul (Col 2.10). Avoir Christ, c'est avoir tout!
Je note que plusieurs théologiens charismatiques ne font pas cette différenciation. Wayne Grudem, par exemple, explique que…
...dans la pensée de Paul, le baptême dans le Saint-Esprit avait lieu au moment de la conversion [citation de 1Co 12.13]. Pour cette raison, le "baptême dans le Saint-Esprit" doit faire référence à l'activité du Saint-Esprit au début de la vie chrétienne lorsqu'il nous communique une vie nouvelle spirituelle (par la régénération), nous purifie et marque une rupture nette avec la domination et l'amour du péché (la phase initiale de sanctification). Le "baptême dans le Saint-Esprit" désigne donc tout ce que fait le Saint-Esprit au début de notre vie chrétienne, ce qui écarte toute possibilité de référence à une expérience postérieure à la conversion, comme le voudraient les pentecôtistes2.
Il n'est pas seul. Le théologien pentecôtiste Gordon Fee commente le "baptême de l'Esprit" mentionné dans 1 Corinthiens 12.13, et conclut que "Paul fait référence à leur expérience commune de la conversion et il le fait dans les termes de son élément crucial, la réception de l'Esprit3". Le pasteur pentecôtiste Ivan Satyavrata, après une belle analyse des données bibliques et une recension des positions de plusieurs théologiens, refuse de "peser le pour et le contre, ni [de se] prononcer sur cette question du timing du baptême de l'Esprit4".
Ces propos mesurés cachent le problème doctrinal qu'il faut résoudre: le baptême du Saint-Esprit est-il une seconde expérience? Doit-on le rechercher après sa conversion? Et si nous sommes tous baptisés dans un même Esprit à la conversion, quelle est la nature de cette seconde expérience? Un don spirituel peut-il servir de preuve d'un tel baptême?
Dans ce chapitre, nous allons examiner les promesses des évangiles, le récit des Actes et l'enseignement des épîtres pour établir que le baptême de l'Esprit est l'expérience de la conversion et que les langues n'en sont pas la preuve.
Résumé de ma position
L'Esprit de Dieu réalise et accompagne tout ce qui est lié à la conversion, à la vie et au service chrétiens. Avant la conversion, l'Esprit dirige les rencontres (Ac 8.29-39), et convainc de péché, de justice et de jugement (Jn 16.8-11). Avec la conversion, l'Esprit accomplit la régénération (Tt 3.5-6), garantit notre héritage de son sceau, l'Esprit (Ép 1.13-14), et intègre le croyant au Corps du Christ par le baptême de l'Esprit (1Co 12.13). Associé à la conversion, avec un tempo variable, l'Esprit accorde au croyant au moins un don spirituel (cf. 1Co 12.7, Rm 12.3-8, 1P 4.10-11) et transforme son caractère, suscitant "le fruit de l'Esprit" (Ga 5.22-25). L'Esprit intercède pour chaque enfant de Dieu (Rm 8.26, Ép 6.18) et lui donne d'expérimenter une plénitude d'intensité variable (Ac 4.31, Ép 5.10-21).
Tout cela commence par le "baptême du Saint-Esprit" qui correspond à la régénération (1Co 12.13, cf. Tt 3.5-6). Par le baptême de l'Esprit, le croyant est "immergé", incorporé dans le Corps du Christ, l'Église de Jésus. Il ne s'agit pas d'une deuxième expérience "supplémentaire" à poursuivre, mais d'une réalité dont profitent tous les disciples authentiques de Jésus-Christ.
Les preuves de la présence de l'Esprit saint seront multiples. Certes, les dons de l'Esprit peuvent être des indicateurs de sa présence, mais cette "preuve" est probablement d'importance seconde, puisque les dons peuvent être contrefaits. Paul déplore le service de faux prophètes déguisés en anges de lumière (2Co 11.13) et rappelle que les dons de l'Esprit sont différents des pratiques païennes (1Co 12.1-3). L'amour, à l'inverse, est difficilement imitable et constitue en cela une meilleure preuve de la présence de l'Esprit. D'ailleurs, tous les textes traitant des dons spirituels sont entourés d'une exhortation à aimer, comme pour accentuer l'importance de servir les autres plutôt que de posséder un don (1Co 13 étant le plus célèbre, mais on peut aussi citer Rm 12.9; Ép 4.1s; 1P 4.7-9).
Je note par ailleurs qu'un caractère marqué par "l'amour, la joie, la paix, [etc.]" est le fruit de l'Esprit. J'avoue regretter que les discussions sur l'Esprit se focalisent trop souvent sur les dons et moins sur le fruit de l'Esprit! Le désir d'obéissance à la Parole est révélateur de la présence de l'Esprit (1Jn 3.16, 24). L'Esprit est avant tout le Saint-Esprit. Sa présence nous pousse à la repentance, à dépendre de lui pour marcher dans la sainteté.
Le don des langues sera abordé au chapitre suivant. Il tient un rôle prépondérant en tant qu'indicateur de la transition d'Israël à l'Église, mais il n'est au mieux qu'un don parmi d'autres et ne saurait servir d'attestation de la présence de l'Esprit: Paul insiste lourdement sur le fait que chacun reçoit un don différent (1Co 12.7, 8-11, 27-30).
Les quatre listes de dons spirituels (1Co 12.8-10; cf. 1Co 12.14-30, Rm 12.4-8, Ép 4.11-12, 1P 4.10-11) montrent la diversité des services possibles au sein du Corps de Christ. Certains dons semblent avoir une composante historique révolue (il n'y a plus d'apôtre au sens des douze – cf. Ap 21.14 – mais il reste des apôtres "envoyés des Églises", 2Co 8.23), et certains dons semblent occuper une place pérenne jusqu'au retour du Christ, comme la prophétie et la connaissance (1Co 13.8).
Les dons sont pour le bénéfice des autres (1Co 12.7; 14.26, Ép 4.12, 1P 4.10) et s'exercent dans l'amour (cf. 1Co 13.4-7). Surtout, l'Esprit dispense souverainement ses dons comme il le veut (1Co 12.7, 11, 18, 28), et aucun don n'est intrinsèquement supérieur en valeur (1Co 12.23) – leur valeur relative dépend de leur contribution à l'édification, à l'expression de l'amour (cf. 1Co 12.31). Leur importance se mesure surtout à ce qu'ils apportent. Enfin, le même don ne sera jamais donné à tous (1Co 12.11, voir la répétition de "à un autre" dans la liste de 1 Corinthiens 12). Ainsi, personne ne peut exiger de l'Esprit qu'il octroie un don, y compris le parler en langues, comme preuve de sa présence.