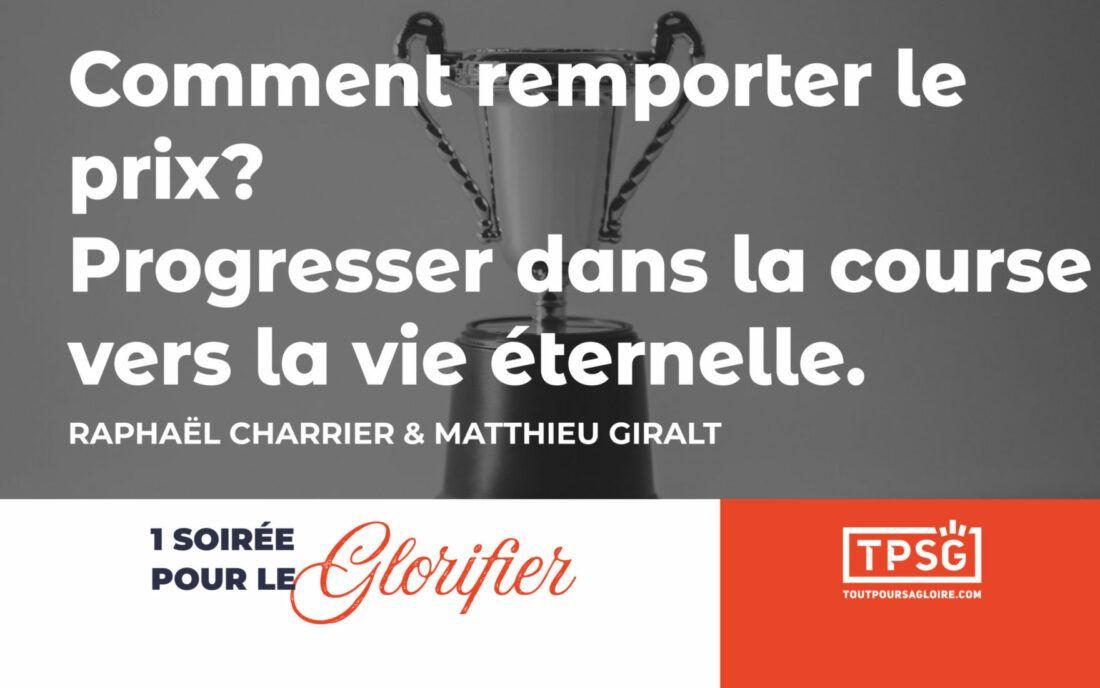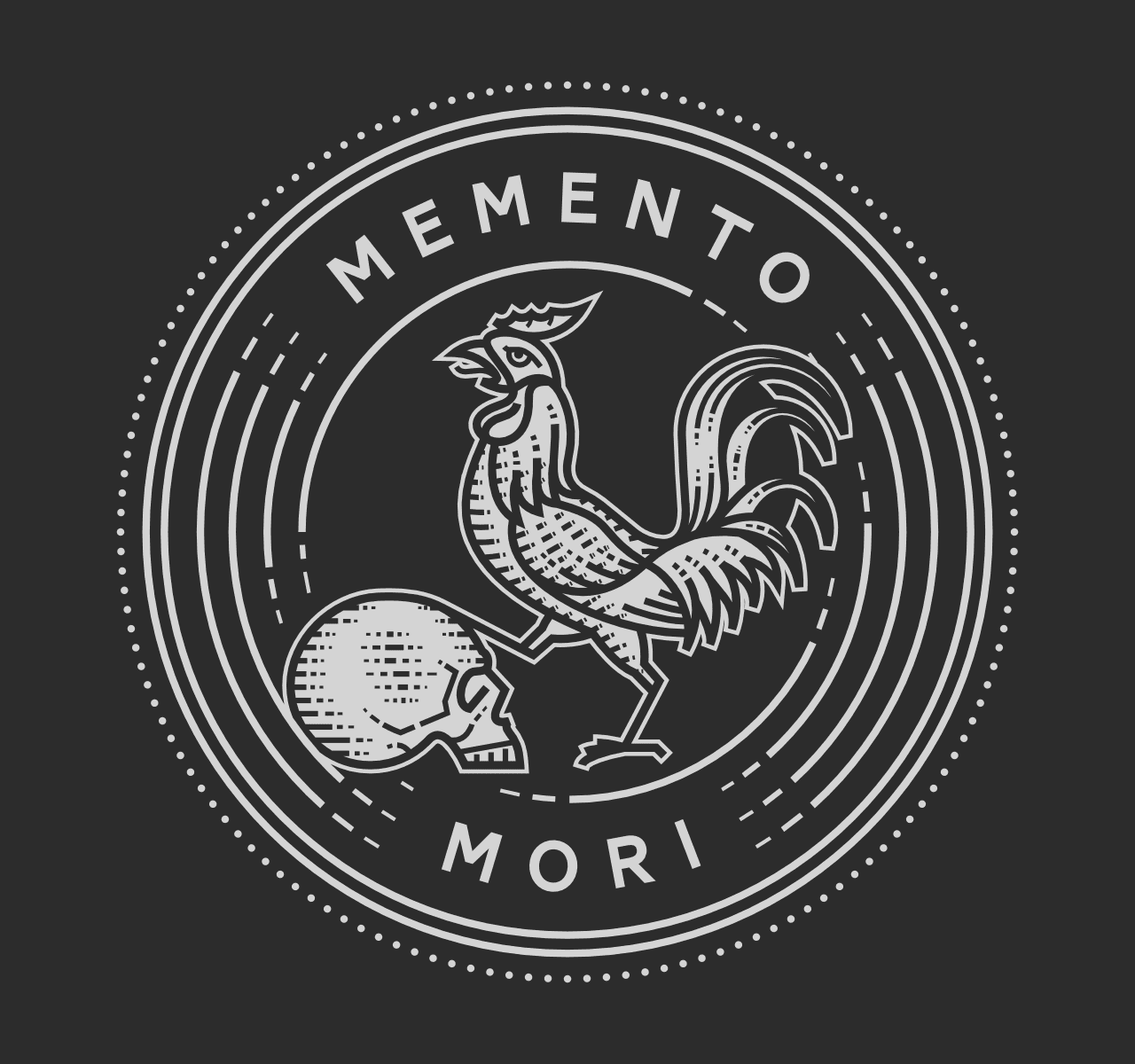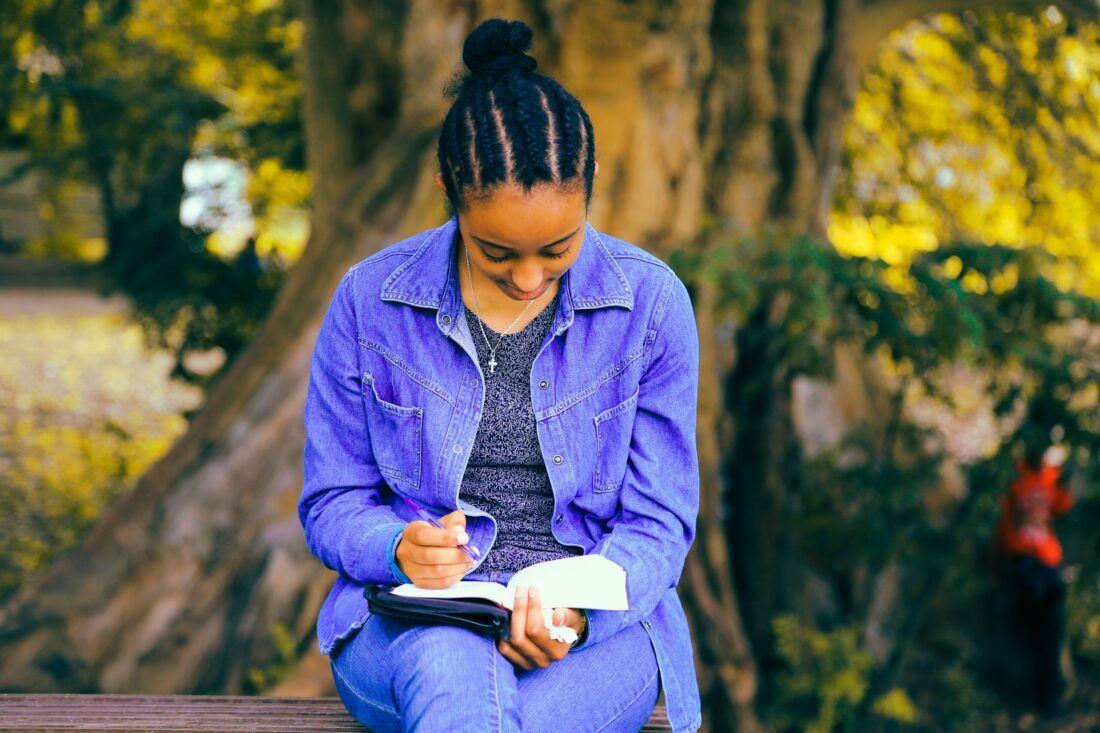Xénoglossie ou glossolalie dans le pentecôtisme primitif
Le Saint-EspritVie chrétienneÉglise primitiveLe pentecôtisme primitif pensait avoir trouvé un accélérateur extraordinaire de la mission: les hommes et les femmes "baptisés de l'Esprit" pouvaient proclamer l'Évangile dans les langues des peuples non-atteints sans avoir à les apprendre.
Quelles étaient exactement les attentes initiales du parler en langues? Une langue mystique? Une langue terrestre? Une prophétie? Une parole missionnaire? C’est que nous examinons dans ce post.
Un peu d'histoire
La naissance du pentecôtisme et du phénomène des langues est fascinante et bien documentée. John Sherrill (Ils parlent en d'autres langues) en parle chaleureusement en la connectant à sa propre expérience. Vinson Synan, historien pentecôtiste, offre un récit détaillé (et parfois troublant) dans The holiness-pentecostal tradition: charismatic movements in the twentieth century [la tradition pentecôtiste de la sainteté: les mouvements charismatiques du vingtième siècle].
Voici comment cet historien pentecôtiste rapporte l'émergence des langues:
En décembre 1900, Parham avait guidé ses étudiants à travers une étude des principaux principes du mouvement de sainteté, notamment la sanctification et la guérison divine. Lorsqu'ils arrivèrent au deuxième chapitre des Actes, ils étudièrent les événements qui se déroulèrent le jour de la Pentecôte à Jérusalem, notamment le parler en langues. À ce stade, Parham dut s'absenter de l'école pendant trois jours pour donner une conférence. Avant de partir, il demanda à ses élèves d'étudier leur Bible afin de trouver des preuves scripturaires de la réception du baptême du Saint-Esprit. À son retour, il demanda aux élèves de présenter les conclusions de leur étude et, à sa "grande surprise", ils répondirent tous à l'unanimité que la preuve était "le parler en langues".
[...]
Apparemment convaincus que cette conclusion était une interprétation correcte des Écritures, Parham et ses étudiants ont organisé une veillée le 31 décembre 1900, qui devait se poursuivre jusqu'au nouvel an. Au cours de cette veillée, une étudiante nommée Agnes N. Ozman a demandé à Parham de lui imposer les mains sur la tête et de prier pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit avec pour preuve le don des langues. C'était après minuit, le premier jour du XXᵉ siècle, lorsque Mlle Ozman aurait commencé à “parler en chinois” tandis qu'un “halo semblait entourer sa tête et son visage”. À la suite de cette expérience, Ozman fut incapable de parler anglais pendant trois jours, et lorsqu'elle tenta de communiquer par écrit, elle écrivait invariablement en caractères chinois. Cet événement est généralement considéré comme le début du mouvement pentecôtiste moderne en Amérique.
Vinson Synan, pages 90-91
Mais cette langue était-elle vraiment une langue terrestre?
Glossolalie ou xénoglossie?
On parle de glossolalie pour décrire l'expression biblique grecque: laleo glossais (parler en langues). Une langue généralement comprise comme mystique, d'un autre genre, qui échapperait donc aux règles linguistiques des langages humains. Mon ami Rémi Gomez, théologien et pasteur charismatique, soutient que les langues sont d'une autre nature que les langues terrestres.
On parle de xénoglossie pour rendre compte d'Actes 2 et affirmer que les langues sont tout simplement des langues étrangères, la langue des "barbares", pour reprendre l'expression de 1 Corinthiens 14.
En tout cas, au début du pentecôtisme, l'attente initiale était clairement missionnaire: un homme ou une femme parle en une langue terrestre qu'il n'a pas apprise pour annoncer l'Évangile.
Mais cette approche s'est heurtée à la réalité du terrain:
Le premier homme blanc à vivre cette expérience à Azusa fut un certain A. G. Garr, pasteur d'une mission de sainteté à Los Angeles. Après son "baptême", Garr et sa femme se rendirent en Inde où ils espéraient prêcher aux indigènes dans leur propre langue. Cependant, cette tentative se solda par un échec. Après leur fiasco en Inde, les Garr se rendirent à Hong Kong où ils créèrent une mission et apprirent le chinois de manière plus conventionnelle. Ce fut la tentative la plus remarquable pour mettre en pratique l'enseignement de Parham concernant l'utilisation des langues dans le cadre missionnaire, et elle se solda par un échec.
Vinson Synan, page 101
Échec, et reconsidération du don…
Une Intelligence Artificielle retrace l'évolution du concept
Mon ami Romain Girardi, doctorant en théologie à Genève, a demandé à Gemini 2.5 pro (Deep Research) de faire un rapport détaillé sur l'évolution de la doctrine (xénoglossie/glossolalie) au début du pentecôtisme.
Le résultat est un podcast de 7 minutes qui répond à cette question avec une précision remarquable. Je vous laisse le découvrir.
Pour référence, vous trouverez en bas de l’article le plan de recherche utilisé par l'IA.
Cette synthèse du rôle des langues dans les débuts du pentecôtisme est fascinante! Et le rendu de Gemini est stupéfiant…
Qu'en disent les théologiens français?
Deux théologiens français de poids, Henri Blocher et Alain Nisus, concluent tous deux leur analyse sur ce point: le parler en langues dans la Bible était bien une langue terrestre.
Conclusion
L'histoire du pentecôtisme primitif révèle une transformation doctrinale majeure: le passage d'une xénoglossie missionnaire (parler des langues terrestres non apprises pour l'évangélisation) à une glossolalie dévotionnelle (langage mystique pour la communion avec Dieu). Cette évolution, provoquée par l'échec concret des premiers missionnaires et les critiques externes, montre comment un mouvement religieux peut adapter sa théologie face à la réalité.
Bonne réflexion!
Annexe: plan de recherche utilisé par l'IA
- Définir et différencier les concepts de xénoglossie (parler une langue étrangère non apprise) et de glossolalie (parler en langues inintelligibles) dans le contexte théologique chrétien.
- Rechercher les croyances et pratiques relatives au "parler en langues" dans les mouvements de sanctification et autres groupes pré-pentecôtistes à la fin du 19ᵉ siècle pour établir le contexte historique.
- Analyser les événements du Réveil d'Azusa Street (1906) et le rôle de figures clés comme Charles Parham et William J. Seymour, en se concentrant sur la compréhension initiale du phénomène, largement perçu comme de la xénoglossie destinée à l'évangélisation missionnaire.
- Documenter le glissement doctrinal progressif de la xénoglossie vers la glossolalie au sein du pentecôtisme naissant. Examiner les raisons de ce changement, telles que les retours d'expérience des missionnaires et le manque de preuves vérifiables de xénoglossie.
- Analyser des écrits théologiques et des publications des premières années du mouvement (par exemple, le journal "The apostolic faith") qui montrent la redéfinition du don des langues, passant d'un outil missionnaire à un langage de prière pour l'édification personnelle.
- Examiner comment les premières dénominations pentecôtistes (comme les Assemblées de Dieu) ont formalisé leur doctrine sur le parler en langues en tant que "preuve physique initiale" du baptême dans le Saint-Esprit.
- Identifier et résumer les critiques, tant internes qu'externes au mouvement, adressées à la doctrine pentecôtiste des langues durant ses premières décennies.
- Synthétiser l'ensemble de l'évolution, en mettant en évidence le passage d'une interprétation littérale et pragmatique (xénoglossie missionnaire) à une compréhension plus spirituelle et expérientielle (glossolalie) et son impact sur l'identité et l'expansion du pentecôtisme.